Mario Tobino, «Le libere donne di Magliano» (1953)
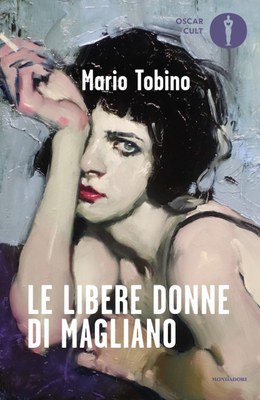
Couverture du roman de Mario Tobino, Le libere donne di Magliano,
(éd. Mondadori 2023).
Présentation de l'auteur
Psychiatre, écrivain, poète, antifasciste et partisan, Mario Tobino (1910 - 1991) est une personnalité particulièrement intéressante du XXème siècle italien. D’abord poète d’inspiration hermétique dans les années 1930 – il fréquente Eugenio Montale et Elio Vittorini –, c’est plutôt par la prose et après la guerre qu’il se fait connaître. Ses récits inspirés de son expérience de la guerre et de la résistance ont été particulièrement remarqués : Il deserto della Libia (1952), adapté au cinéma par Dino Risi (Scemo di guerra, 1985) puis par Mario Monicelli (Le rose nel deserto, 2006), ou encore Il Clandestino, Premio Strega 1962. Le filon autobiographique est également exploité dans Le brace dei Biassoli (1956), touchante évocation de la jeunesse de la mère de l’auteur dans un village ligure au début du siècle dernier.
Mario Tobino a également documenté très largement son activité de médecin, produisant des œuvres littéraires qui sont autant de témoignages fondamentaux pour comprendre l’histoire de la psychiatrie en Italie au XXème siècle. De la quarantaine d’années – de 1943 à 1990 – passée au sein de l’hôpital psychiatrique de Maggiano, à côté de Lucques, il tire les récits Le libere donne di Magliano (1953), Per le antiche scale (1972), Gli ulitimi giorni di Magliano (1982), Il manicomio di Pechino (1982), qui donnent une image de ce que furent les asiles italiens avant leur fermeture suite à la loi Basaglia de 1978. Le libere donne di Magliano sont une évocation à la fois réaliste et poétique – les noms sont modifiés et la chronologie est floue – des dix premières années de sa carrière. Le récit se concentre essentiellement sur le travail de Tobino dans le département féminin de l’hôpital.
Une écriture flamboyante
Mario Tobino était poète autant que prosateur et c’est ce qui frappe le lecteur dès les premières pages de Le Libere donne di Magliano. Le récit n’est pas constitué en chapitres, mais en paragraphes plus ou moins longs, certains brefs comme des aphorismes : « Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli.» (p. 9).
Ces remarques très simples et fulgurantes, tout comme les évocations du passage des saisons ou de la nature qui entoure l’asile, contrastent avec de longs paragraphes beaucoup plus tortueux et heurtés, marqués par une syntaxe très complexe manifestement héritée de l’hermétisme poétique :
La Berlucchi stamattina ha 37,2.
Ha il volto bianco di una Medusa, l’aspetto di un’attrice tragica che serenamente e con ineluttabilità è costretta dalla sua natura a comportarsi così. Quando, per un attimo, si accorge che gli altri non la comprendono si dipinge di una profonda meraviglia che ha qualcosa di marino, come a una sirena qualcuno dicesse seriamente che non è bella e lei si svolge a guardare chi ha pronunciato sì tali parole. (p. 18)
Ici, une banale information médicale – le récit prend ainsi parfois la forme d’un carnet de bord – est immédiatement suivie d’un long développement riche en métaphores mythologiques, qui ne sont pas de simples évocations poétiques mais servent à cerner la nature du mal dont souffre la patiente.
La folie, tout comme la création artistique, est une lentille à travers laquelle les malades regardent le monde. C’est d’ailleurs elle-même, la Pazzia, personnifiée, qui est la « padrona del manicomio » (p. 23). C’est elle qui transforme les personnes au point d’en faire une matière littéraire et lorsque Tobino décrit les malades, on sent qu’il fut un grand lecteur de Dante :
[…] donne anziane sdentate, gli occhi cisposi e strabici, che tenacemente circondano col braccio ragazze dementi, imbecilli che scolano saliva dalle labbra pendenti; bruttissime, goffe, zoppe, i capelli degli spillaccheri, la voce una emissione gutturale […]. (p. 129)
Accumulations d’adjectifs, images horrifiques et jeu sur l’expressivité du lexique – ici le toscanisme spillaccheri – rendent compte de la réalité prosaïque du manicomio, montrée sans euphémisme, tout en révélant l’aspect très fécond sur le plan littéraire d’un tel sujet.
L’humanité du manicomio
Le manicomio est montré dans sa réalité la plus crue, et pourtant Mario Tobino souligne l’humanité des malades et, dans une certaine mesure, de leur traitement : « L’alienato nella cella è libero, sbandiera, non tralasciandone alcun grano, la sua pazzia, la cella suo regno dove dichiara sé stesso, che è il compito della persona umana » (p. 34).
Cette liberté – qui est également celle du titre de l’œuvre – est évidemment très paradoxale, mais c’est un point important : l’asile est le lieu où le malade peut exprimer sa folie, c’est-à-dire son humanité, son identité, parfois « la sua reale natura » (p. 100), ce qui est impossible dans le monde du dehors. De même, chaque malade est considéré comme une personne bien particulière, différente des autres, même si le mal est le même.
Les méthodes elles-mêmes, si décriées lorsque l’asile est devenu le lieu par excellence de la contention déshumanisante, sont décrites de manière à en faire ressortir la logique. Ainsi, lorsque les malades se mettent en danger ou mettent les autres malades en danger, il n’y a pas d’autre solution que de les transférer dans le service des « agitate ». Ce service est certes présenté comme un véritable girone dantesque, mais tout y est pensé pour laisser aux malades la possibilité d’exprimer leur « delirio ». Ainsi, lorsque la crise est impossible à contenir, les femmes délirantes sont placées nues dans une cellule tapissée d’une algue marine qui isole un peu du froid, amortit les chutes et absorbe les fluides corporels. C’est une vision d’horreur et c’est très rudimentaire, mais c’est une solution pragmatique, la seule ressource à disposition du médecin des années 1940.
L’humanité du récit vient aussi du fait que Mario Tobino est lui-même enfermé. Les saisons passent, les infirmières, les sœurs et les malades vont et viennent, mais lui reste à l’hôpital, qui est à la fois son lieu de travail et son lieu de vie. Lorsque ses amis lettrés viennent lui rendre visite, c’est dans son petit appartement au sein du manicomio, et le repas est servi par une malade un peu amoureuse de lui – confusion qui nous semble aujourd’hui difficilement acceptable. Sa vie est indissociable de celle des malades.
Sono nella mia piccola stanza nella quale respiro da circa dieci anni. In tutte quelle altre stanze che compongono questo enorme caseggiato respirano i delirî di 1040 matti. Quasi tutti vivono in camicia, Don Chisciotti senza che nessuno li ami, né possono camminare su un ronzino al chiaro di luna; i loro delirî battono sulle povere mute pareti intanto che intorno a loro fuma debolmente puzza di sudore. (p. 6)
On voit ici aussi bien la confusion entre maladie et imagination, que l’enfermement du médecin/écrivain parmi ses malades. Ce monde clôt, pauvre et malodorant est aussi le sien, et lui aussi s’en échappe par l’imagination.
Des connaissances encore très limitées
À la lecture des Libere donne di Magliano, un autre aspect qui saute aux yeux du lecteur contemporain, et contribue à donner une vision moins inhumaine de l’asile, est la pauvreté des moyens – techniques et théoriques – à la portée des médecins. La décennie du récit est exactement celle qui a précédé la découverte des médicaments psychotropes : les moyens thérapeutiques sont donc quasiment inexistants. La connaissance de la maladie elle-même est très limitée, ce que Mario Tobino, jamais pontifiant, reconnaît constamment :
Cosa significa essere malati? perché si è matti? Una malattia della quale non si sa l’origine né il meccanismo, né perché finisce o perché continua.
E questa malattia, che non si sa se è una malattia, la nostra superbia ha denominato pazzia. (p. 99)
Beaucoup d’interrogations mais peu de réponses, et aussi peu de mots. Le mot pazzia lui-même est très insatisfaisant, à la fois stigmatisant et vague. Les termes par lesquels les maladies sont désignés paraissent tous très imprécis :
La Berlucchi è una malata disperatamente « depressa », piange cioè, lacrima limpide lacrime dicendo che sua è la colpa di tutto e che la uccidano perché è la minima pena. (p. 10)
Le diagnostic « depressa » est entre guillemets, comme si le mot n’était pas assez clair pour définir le mal, et c’est la poésie (« lacrima limpide lacrime ») qui vient au secours du médecin/écrivain pour définir sa patiente et montrer sa souffrance, sans jugement ni ironie.
La cause des maladies – qui pour certaines est encore peu claire aujourd’hui – n’est entrevue que par intuition. Parfois, la maladie est simplement dans la « nature » des patientes. À d’autres moments, Mario Tobino voit bien que le même symptôme chez deux personnes différentes peut être le fruit de deux histoires différentes, et il invoque vaguement l’éducation, la mère (sic), ou l’enfance. Le lien avec le contexte social, et la frontière entre le caractère et la maladies ne sont pas vraiment plus clairs : Mario Tobino se demande par exemple si une patiente, internée par son mari, est « delirante di gelosia o è semplicemente una gelosa impulsiva » (p. 62). Parfois enfin, on sent que les préjugés patriarcaux sont encore tellement enracinés – même chez un lettré progressiste comme Tobino – qu’ils sont un frein à la compréhension de la maladie et de ses causes. Ainsi, lorsqu’il évoque les causes possibles de la folie d’une jeune patiente :
[…] quasi certamente la Lella, vergine della verginità, vestale di bende intatte, fu testimone improvvisa di un atto bestiale di sua madre che fino a quel momento era la immacolata mamma e dentro di lei successe una delle più divine e umane fratture […]. (p. 112)
On voit ici combien ce qui reste de l’idéalisation de la virginité et de la diabolisation de la sexualité empêche de formuler un diagnostic précis. Par ailleurs, la pudeur qui ne permet pas de préciser la nature de l’« atto bestiale » que la mère n’a sans doute pas accompli toute seule, invisibilise probablement les violences sexuelles qui peuvent être à l’origine de traumatisme. Pour une autre patiente, dont sont décrits longuement les sévices et humiliations infligés par son mari, Tobino conclut : « La Fratesi è ora qui ricoverata per malinconia, ciò non toglie che tutto questo sia vero » (p. 30). Le médecin reconnaît humblement l’insuffisance du diagnostic et les limites de sa science, dans une société patriarcale où les femmes n’ont aucune autonomie.
La sexualisation des malades
Le manicomio décrit par Tobino n’est donc pas le lieu d’enfermement arbitraire et inhumain qu’on se représente habituellement, mais plutôt un endroit, limité et imparfait, où les malades sont traitées avec humanité, et sans doute aussi bien que les connaissances scientifiques et les moyens techniques de l’époque le permettaient. Cependant, le lecteur contemporain est susceptible d’être gêné par la sexualisation des malades par le regard du médecin/écrivain, rendant certaines pages à la limite du soutenable :
Mi ricordo la bellissima ragazza di Livorno, […] una vergine gettata all’improvviso nei cieli infernali della mania, una ragazza di diciotto anni, maestà di bellezza; alta, bruna, il corpo duro-michelangiolesco, bella e furente nella chioma nera e nell’espressione del volto, il petto sodo e gonfio, il ventre liscio, le cosce robuste, affusolate le gambe. Arrivò in manicomio con tale agitazione che si dovette subito rinchiuderla in cella, dove nuda fece dell’alga dei raggi sessuali e semidivini. (p. 43)
Ainsi, à de nombreuses reprises, les corps des malades, en proie au délire et non conscientes, sont érotisés. La forme des corps nus, la couleur de la peau, les types de beauté et même les sexes nus aperçus à travers la fente de la serrure sont presque systématiquement mentionnés. On sent que Tobino veut montrer la folie dans toute sa crudité, sans pour autant porter atteinte à la dignité des malades, mais ce regard masculin conscient sur une nudité féminine souffrante et inconsciente est parfois difficilement supportable pour notre sensibilité contemporaine. La crise délirante, quand elle revêt – souvent – un caractère sexuel, semble d’autant plus impressionnante qu’elle advient dans une société très contrôlée et pudibonde, et c’est très probablement ce que Mario Tobino chercher à dénoncer, mais l’écrivain semble parfois se complaire un peu trop dans le récit cru et flamboyant de ce contraste.
Exploitations pédagogiques possibles
Si l’on exclut évidemment ces pages peu adaptées à un lectorat jeune et encore peu formé à la question des représentations de genre, certains passages du texte de Tobino constituent une lecture susceptible d’intéresser des lycéens, dans le cadre d’une séquence en lien avec l’axe « Diversité et Inclusion » du cycle terminal. Nombreux sont les documents et textes littéraires à mettre en regard de celui-ci, du film La Meglio Gioventù aux poésies d’Alda Merini ou d’Amelia Rosselli – qui envoya d’ailleurs en 1955 à Mario Tobino une proposition de mariage qui resta sans réponse.
Les aphorismes les plus simples peuvent être isolés pour servir de matière à la réflexion, mais des passages plus complexes et littéraires sont tout aussi intéressants dans la mesure où il allient l’intérêt du fond et de la forme : servir la cause de la psychiatrie grâce au pouvoir évocateur de la poésie était d’ailleurs l’objectif déclaré de Mario Tobino. Si l’on souhaite évoquer la réforme Basaglia en classe, l’étude d’un extrait de Le libere donne di Magliano aura le mérite de ne pas montrer les asiles italiens du XXème siècle sous un jour caricatural. La préface à l’édition de 1963, « Dieci anni dopo », présente en appendice de l’édition Mondadori 2023, peut également être soumise aux élèves d’aujourd’hui :
Per i sani è giunto il momento di fare il loro dovere verso i folli. E, per aiutarli, è semplicemente necessario aumentare il numero dei medici, il numeri degli infermieri specializzati, è necessario costruire piccoli ospedali per modo che ogni malato sia una persona e non un numero pressoché anonimo, è necessario e obbligatorio innanzitutto non dare soltanto il denaro ma partecipare, sorvegliare, criticare, appassionarsi a ogni passaggio di questa meravigliosa impresa contro la pazzia, la più misteriosa che esista nel mondo. (p. 142)
Même si le lyrisme et la poésie ont un grand pouvoir évocateur, cette réflexion plus directe offre également un bon point de départ pour mettre en lumière l’actualité de la question de la santé mentale et montrer que la fermeture des manicomi n’a pas suffi à régler le problème.
Pour citer cette ressource :
Sarah Vandamme, Mario Tobino, Le libere donne di Magliano (1953), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), janvier 2025. Consulté le 20/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/bibliotheque/mario-tobino-le-libere-donne-di-magliano-1953



 Activer le mode zen
Activer le mode zen