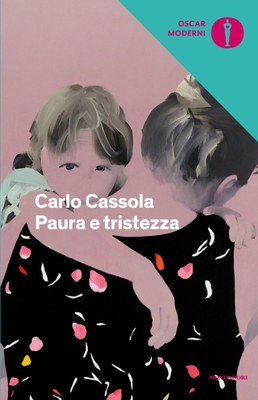Carlo Cassola, «Paura e tristezza» (1970)
Présentation du roman
Le roman s’ouvre sur un paysage printanier, au début du siècle dernier. Un groupe de trois jeunes sculpteurs sur albâtre a quitté le centre de Volterra pour prendre l’air dans le faubourg de San Giusto, caractérisé par ses impressionnantes falaises, les Balze.
Un giovedì pomeriggio tre alabastrai facevano merenda alle Balze. S’erano trovati al caffè di piazza, e dopo una partita avevano deciso che era una giornata troppo bella per passarla chiusi in bottega. A San Giusto avevano comprato un fiasco di vino, un pane casalingo e una cartata di prosciutto. (p. 5 de l'édition Mondadori 2017)
Ils prennent une collation au bord du précipice, plaisantent et échangent quelques mots avec une petite fille timide qui semble affamée et accepte volontiers un morceau de pain. Voilà la première fausse piste de cet étonnant roman : ces trois personnages, que l’on présente au lecteur avec leur nom, leur aspect et leur caractère, n’apparaîtront plus jamais et c’est la petite fille, Anna, que le lecteur suivra depuis cet après-midi de son enfance jusqu’à l’âge adulte. Fille d’une lavandière qui l’élève de façon un peu rude, elle vit misérablement dans une maison minuscule où elle partage avec sa mère de maigres revenus et un petit matelas garni de feuilles de maïs. Mais son malheur n’est pas tant sa grande misère que le fait d’être née de père inconnu, bâtarde, dans une société qui tolère difficilement les filles mères. Jeune adolescente pendant la Grande Guerre, contrainte de quitter l’école malgré ses excellents résultats, elle passe quelques belles saisons à aider une parente paysanne à bêcher et cueillir les olives sur ses terres, puis, jeune fille, elle quitte San Giusto pour se rendre en ville au service d’une vieille comtesse un peu bigote. Malgré cette bonne fortune et sa beauté qui ne passe pas inaperçue, Anna ne parvient pas à s’éloigner complètement du précipice où elle a passé ses premières années, et semble condamnée au malheur et à la tristesse. À la tristesse sans doute plus qu’à la peur car la certitude d’avoir un triste destin ne la quitte pas et la rend résignée et résiliente.
Le roman de l’intime
Les lecteurs de Carlo Cassola retrouvent avec Paura e tristezza des éléments très caractéristiques de son style. Comme dans Il cacciatore, La ragazza di Bube ou Fausto e Anna – prénom récurrent dans son œuvre – l’intimité des personnages est décrite de façon aussi pointilleuse et sensible que la nature dans laquelle ils sont immergés, et les cycles de leurs vies miment le passage des saisons :
Dava dolcezza e tristezza insieme vedere le balze e i boschi accendersi per qualche minuto e poi diventare spenti e muti. Anna aveva quasi il presentimento che anche per lei sarebbe stato così, a una breve stagione felice sarebbe seguita una vita senza speranza. (p. 206)
À partir de l’apparition d’Anna, la narration ne quittera plus jamais une focalisation interne si subtile que la voix du narrateur se fait complètement oublier, mimant celle de sa protagoniste. Par exemple, bacìo et solatìo, termes utilisés par les paysans pour désigner les versants auxquels leurs champs sont exposés, reviennent souvent et deviennent presque des formules magiques tant ils plaisent à Anna. Les visages, les matières, les lumières sont finement observés par Anna. La géographie du roman se met tout entière à son échelle : les faubourgs de son enfance semblent très loin du centre de Volterra, et plus loin encore de la villa où elle passe l’été avec la comtesse, et pourtant à diverses reprises ces distances sont parcourues à pied par différents personnages. De Volterra, son amoureux Guido qui connaît toutes les églises et leurs chefs-d’œuvre s’étonne qu’elle ne connaisse que quelques rues et places.
Le lecteur est ainsi immergé dans le quotidien d’Anna et dans son intimité, et la lecture devient presque hypnotique. Passées les premières pages où l’on attend que les évènements narrés soient en lien les uns avec les autres, on comprend que la construction est beaucoup plus diffuse, plus impressionniste. Se succèdent donc des micro-évènements, des sensations infimes : Anna se lave les cheveux et les sèche au soleil, ramasse des châtaignes, s’ennuie le dimanche, se couche pour la première fois sur un vrai matelas, etc. Chacun de ces évènements devient passionnant, car on sent qu’ils sont tous déterminants malgré leur banalité. À l’inverse, les moments qui pourraient sembler les plus fondateurs ou dramatiques sont souvent traités par l’ellipse, rendant la lecture toujours un peu inconfortable, et étonnamment haletante. Carlo Cassola explique ainsi ce procédé narratif :
Mentre il romanza tradizionale, che narra la vicenda in cui gli elementi sono tutti concatenati tra loro, è al di fuori della vita: perché quelli che sono i drammi, i nodi delle vicende umane si sciolgono e si risolvano in quello che è lo scorrere del quotidiano. Ognuno di noi può vivere il dramma più atroce però continua a fare le stesse cose che fa ogni giorno. Una delle scoperta della letteratura contemporanea è propria questa. ((Entretien cité dans l’introduction à l’édition Mondadori 2017, p.VII.))
Cette vision pessimiste n’est cependant jamais sinistre. D’une part, parce que le destin terne et banal d’Anna est narré sans cynisme ni misérabilisme, et d’autre part parce que ces infimes détails du quotidien sont souvent chargés de poésie et de beauté. Malgré sa mélancolie, Anna sait distinguer cette poésie des choses banales :
"C’è pieno di cose invisibili" pensò Anna. Le tornò in mente il tempo lontano in cui era a casa: la mattina, quando un raggio entrava in camera, si vedeva un turbinio di granelli di polvere…
Ci volevano speciali condizioni di luce per vederli. Era un po’ come nella vita, che delle cose ci se ne accorgeva solo in certi momenti… (p. 307)
Derrière cette simple réflexion de jeune fille, on reconnaît l’intention de l’auteur qui est précisément de mettre en lumière la beauté de l’infime, des petits grains de poussière.
Un roman politique ?
Cet intimismo fut reproché à Cassola, notamment par Alberto Asor Rosa qui dans Scrittori e popolo l’opposa au politico et à l’impegno ((Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo, Einaudi, 1965. Cité dans l’introduction à l’édition de 2017, p. X-XI.)). Selon les critères de l’époque, le politique semble en effet absent de Paura e tristezza. Anna semble vivre dans un monde rural intemporel et les grands évènements historiques ne sont d’ailleurs évoqués qu’à travers le prisme de son quotidien. Ainsi, la Grande Guerre correspond pour elle à une période joyeuse où, les hommes étant absents, elle peut se rendre utile sur les terres de sa tante Ersilia, et flirter avec un jeune réfugié vénitien. L’ombre du fascisme est à peine esquissée à la fin, lorsque l’on voit les sculpteurs sur albâtre au chômage travailler dans des carrières rouvertes par le gouvernement – dont Anna semble douter de l’utilité, d’ailleurs. Aucun personnage ne tient de discours que l’on pourrait qualifier de politique, et aucun antagonisme de cette nature ne peut être décelé entre les personnages.
Notre regard contemporain peut cependant lire un message politique plus subtil, qui passe précisément par la peinture du quotidien et de l’intime. Nul besoin de grandes déclarations politiques quand la difficulté et l’inégalité des situations est montrée de façon aussi évidente au lecteur, avec une précision que l’on pourrait qualifier de sociologique. De la ville aux faubourgs, d’une ferme à l’autre, d’un versant de la colline à l’autre, la vie n’est pas tout à fait la même. Les métiers, les salaires, les habitations sont montrés très exactement, sur plusieurs années et à différents âges de la vie et dans ce monde profondément inégalitaire Anna sait que ses chances de s’en sortir sont minces. Voilà une conception du roman politique qui correspond sans doute plus à notre sensibilité contemporaine.
Tout aussi politique est le regard que porte Cassola sur la condition féminine. Critiqué et incompris par certains mouvements féministes de son époque ((Dans I padri della fallocultura, en 1974, Liliana Carusa et Bibi Tomasi lui reprochent de montrer des femmes passives et stéréotypées.)), l’auteur apparaît au contraire aujourd’hui comme un romancier capable d’une dénonciation à la fois fine et implacable du patriarcat. Anna est généreuse, intelligente et courageuse, mais son malheur est d’être née femme et bâtarde dans un monde encore extrêmement rigide et traditionnel. Le patriarcat inhibe les désirs – Anna suffoque quand un garçon pourtant tendre et aimant fait mine de l’embrasser sur les bouche – et fait vivre les femmes dans la peur. Anna le dit simplement, avec ses mots, dans un flux de pensée rapporté sans aucune distance par le narrateur, signe évident que l’auteur partage sans ironie les propos de sa protagoniste :
Era una disgrazia, nascere femmina. Era quella la disgrazia: mica essere povere. La contessa era ricca, ma anche lei, che bene aveva avuto? Un marito che l’aveva sposata per interesse; che le avrebbe mangiato tutto il patrimonio se non fosse morto in tempo. I mariti sono tutti nello stesso modo: bevono, giocano, picchiano la moglie… e non ci si può far niente, bisogna rassegnarsi. Una donna, non si può aspettare altro destino…
E se una non l’accettasse? Se la facesse finita subito?
Si la condition féminine s’est largement améliorée entre le temps de la narration et le temps de l’écriture, et surtout depuis que Cassola a écrit ces lignes, l’intention et le discours restent poignants et passionnants aujourd’hui.
Exploitation pédagogique
C’est sur cette thématique de l’émancipation féminine et de la critique du patriarcat que l’on pourrait fonder une exploitation pédagogique de ce roman. De nombreuses pages très simples – puisque ce sont les mots d’une jeune fille fine mais peu cultivée – décrivent la condition féminine au début du siècle dernier. Ce thème, mêlé à la notion d’intimité, entre dans le cadre des axes "Diversité et inclusion" et "Espace public, espace privé" du cycle terminal. On peut tout à fait imaginer une séquence qui mettrait en parallèle une page du roman avec le film C’è ancora domani de Paola Cortellesi sorti en 2023. On pourrait aussi rechercher pour l’étudier l’une des nombreuses chansonnettes ou comptines qu'Anna fredonne dans le roman, et dont elle se rend compte qu’elles ne parlent que du pouvoir des hommes sur les femmes, et des dangers que ces dernières encourent.
Notes
Pour citer cette ressource :
Sarah Vandamme, Carlo Cassola, Paura e tristezza (1970), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mai 2024. Consulté le 29/01/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/bibliotheque/carlo-cassola-paura-e-tristezza-1970



 Activer le mode zen
Activer le mode zen