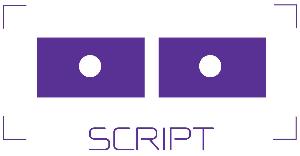L’espace post-apartheid dans les longs métrages de fiction sud-africains, une étude panoramique
Mon intervention est une présentation introductive ((Il s’agit ici de la transcription d’un cours introductif. Pour toute citation, je renvoie donc les lecteurs à la version complète de ma thèse.)), destinée principalement aux étudiants de master présents lors de cette journée d’étude. J’y pose les bases de la question de la représentation de l’espace post-apartheid dans les films sud-africains, sujet de ma thèse de doctorat (« L’espace post-apartheid dans le cinéma sud-africain : état des lieux de la fiction (2000-2010) », soutenue en 2013 à Aix-Marseille Université. Ce sujet s’inscrit dans l’objectif de cette journée : une étude de la situation géopolitique de l’Afrique du Sud à partir de son cinéma - enjeu central de mon travail de recherche depuis le master. Je vais donc évoquer une dizaine de films pour dégager des grandes lignes de la représentation de l’espace post-apartheid à l’écran.
Après une longue section introductive, je m’attacherai d’abord à la représentation du territoire national, en opposant notamment espace urbain et espace rural, puis je me concentrerai sur celle des villes sud-africaines et de leurs divisions persistantes.
Introduction
Genèse et pertinence du sujet
Je travaille sur le cinéma sud-africain depuis 2006. Initialement intriguée par l’image médiatisée d’une Afrique du Sud réconciliée, pacifiée, en apparente rupture totale avec son passé, j’ai d’abord étudié la représentation de la « nation arc-en-ciel » dans le cinéma sud-africain, puis l’évolution des rapports intercommunautaires (entre Blancs, Métisses et Noirs ou entre Afrikaners et Sud-Africains anglophones) à l’écran au 20ème siècle. Dans mes analyses filmiques, j’ai vu émerger une forte dimension spatiale des films des années 2000. Ainsi, les quêtes identitaires se traduisent souvent spatialement, par le passage d’un espace à un autre, la multiplication des allers-retours et la volonté de franchir les frontières héritées de l’apartheid. Mes conclusions ont rapidement mené à cette idée : la réinvention de l’Afrique du Sud, en réalité comme à l’écran, se joue spatialement.
L’espace en Afrique du Sud
Cette primauté de l’espace n’a en fait rien d’étonnant si l’on réfléchit à ce qu’était l’apartheid. L’apartheid était un système de ségrégation et de hiérarchisation entre des groupes de population définis principalement ((Mais non exclusivement, la langue ou d’autres facteurs culturels étant aussi pris en compte, quoique manipulés.)) selon des phénotypes comme la couleur de peau ou la texture des cheveux. Les bases de la ségrégation ont été posées avant l’apartheid, dans les colonies boers/afrikaners et britanniques, entre le 17ème et le 19ème siècle et développées dans le premier État sud-africain, un dominion britannique créé en 1910, l’Union. Pourtant, à partir de 1948, l’apartheid renforce et systématise cette logique et la pousse à l’extrême. La population est classée en groupes dits raciaux, puis assignée à des zones de résidence spécifiques ((Voir notamment Population Registration Act 1950 et Group Areas Act 1950.)). Cette classification détermine aussi les droits sociaux et politiques des Sud-Africains. Cet apartheid « politique » est fondé sur un apartheid « économique » visant à l’exploitation d’une main d’oeuvre noire bon marché et privée de droits politiques.
Géographiquement, l’apartheid se traduisait par un contrôle systématique des mouvements des populations noires et métisses et par trois niveaux de ségrégation qui réservaient, à chaque échelle, des espaces pour les Blancs et des espaces, moins avantageux, pour les Noirs, Métisses et Indiens.
- Le Grand Apartheid, mis en oeuvre à l’échelle nationale
- L’Urban Apartheid, division à l’échelle des villes.
- Le Petty Apartheid, division des infrastructures (toilettes publiques, bancs, parcs, fontaines d’eau potable, etc.)
L’apartheid, qui signifie « état de séparation », « fait d’être séparé » était donc intrinsèquement spatial et géographique.
Entre 1989 et 1991, la législation d’apartheid est abolie et la liberté de mouvement rétablie. Mais la structure d’une ville, ou l’implantation de la population dans la campagne, ne changent pas d’elles-mêmes en 20 ans. Les Sud-Africains n’ont pas tout rasé pour tout reconstruire et se voient donc léguer un espace anciennement ségrégué et inégalitaire. À l’écran également, la tension entre héritage de l’apartheid et renouveau est vive.
Le nouveau cinéma sud-africain
Les premiers films tournés sur le territoire qui est aujourd’hui l’Afrique du Sud l’ont été dès 1896, juste un an après les premières projections du cinématographe des Frères Lumières. Après un âge de gloire du cinéma colonial dans les années 1920, l’industrie cinématographique d’apartheid a été mise en place dans les années 1950. Le cinéma était un reflet de la politique d’apartheid, un outil de promotion de l’afrikaans (langue des colons d’ascendance hollandaise présents depuis le 17ème sur le territoire) et des logiques de séparations des groupes « ethniques » (définis comme « race » ou « tribe » en anglais). L’état exerçait un contrôle par les subventions, la censure et le contrôle de la distribution. Le cinéma était donc, à quelques exceptions près, un véhicule de l’idéologie de l’apartheid.
Après l’avènement de la démocratie en avril 1994, pendant 4 ans, des recherches et enquêtes ont été menées en vue de construire un nouveau cinéma sud-africain, plus proche des réalités du pays. Cela a abouti à une industrie radicalement différente, qui a pour objectif la rentabilité économique, la visibilité internationale et le succès local. Au niveau des représentations, le but officiel est de produire des films qui reflètent les réalités du pays.
J’ai choisi dans mes recherches de me concentrer sur le cinéma sud-africain plutôt que sur les films étrangers traitant de l’Afrique du Sud (Invictus (Clint Eastwood, 2009) ou Cry Freedom (Richard Attenborough, 1987) par exemple). De nombreux films sont des coproductions mais, pour déterminer la « sud-africanité » des films, il faut que la proportion de Sud-Africains dans l’équipe technique et l’équipe artistique soit suffisamment importante. Pour information, la production locale était de 19 films en 2012 et 25 en 2013 ((Voir le site de la National Film and Video Foundation : www.nfvf.co.za)).
Je m’intéresse à la période des années 2000 car la production de cette époque est le résultat de la politique de restructuration de l’industrie du film post 1994, notamment par le biais de la création de la National Film and Video Foundation en 1999.
1. Représentations du territoire national
1.1 Le « grand apartheid »
J’ai choisi cette image parce qu’elle montre bien la faible proportion du territoire consacrée aux bantoustans (états-provinces semi-indépendants où les populations noires disposaient d’une pseudo-souveraineté politique), d’une part, et le morcellement du territoire (exemple: le Ciskei et le Transkei partageaient de nombreux traits culturels et linguistiques). Dans leur ensemble, environ 13% du territoire étaient accordés à 75% de la population. Quels étaient les objectifs de cette politique ?
D’abord, l’unification des populations blanches, effaçant les tensions entre Afrikaners et Britanniques, et le développement économique et industriel blanc (avec la mainmise sur les mines, notamment). En revanche, au sein de la population noire, la création de groupes distincts présentés comme « tribaux » avec l’attribution de territoires séparés visait à diviser pour mieux régner.
Ensuite, les bantoustans et leur statut plus ou moins autonome permettait à la fois au gouvernement d’apartheid :
- de contrôler les chefs à la tête des bantoustans, à la solde du régime pour l’immense majorité,
- de donner l’illusion d’un « développement séparé » égalitaire tandis que les bantoustans ne disposaient que d’un très faible accès aux ressources, services et infrastructures,
- et de priver les Noirs de leur légitimité sur le territoire et de leur représentation indirecte à Pretoria, ceux-ci n’y avaient plus qu’un droit de passage en tant que main d’oeuvre.
Aujourd’hui, l’héritage du Grand Apartheid se manifeste par les inégalités d’accès aux services (santé et éducation en particulier) et à l’emploi, en d’autres termes, par un isolement persistant. Les anciens bantoustans sont les zones les plus sinistrées aujourd’hui encore.
1.2 Et au cinéma ?
Cette division du territoire se manifeste surtout par l’omniprésence du récit de l’exode rural: un jeune homme d’un bantoustan vient à la ville pour trouver du travail.
![[title-image]1332154755429[/title-image] Jim Comes to Joburg (Donald Swanson, 1949) [Cry, the Beloved Country (Zoltan Korda, 1951)] Come Back, Africa (Lionel Rogosin, 1959)](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive7_1416303176939-jpg)
Dans ces trois films du début de l’apartheid, une focalisation s’opère sur les moyens de transports, qui signalent l’éloignement depuis la campagne jusqu’à la ville. C’est le train qui structure les rapports entre ville et campagne à l’écran.
La ville est, dans les trois films, un lieu de perdition. Diabolisée dans Cry, the Beloved Country, où elle pervertit les personnages noirs qui s’y rendent (sans pervertir particulièrement les personnages blancs), elle est dangereuse, remplie de criminels, dans Jim Comes to Joburg et Come Back, Africa.
En revanche, la portée idéologique des films diffère. Jim Comes to Joburg est un récit faussement naïf, dans lequel Jim, sorte de Candide sud-africain, rêve à son bantoustan en écoutant des chants traditionnels. Ceci vise, vous l’aurez compris, à alimenter la justification de la politique des bantoustans en représentant une soi-disant nostalgie du noir exilé à la ville pour sa campagne traditionnelle et idyllique.
Seul Come Back, Africa présente l’arrivée à la ville comme une conséquence de l’apartheid (il n’y a pas d’emploi dans les bantoustans). La tragédie ne procède pas de la faiblesse des personnages mais de l’injustice du système. Le film, tourné clandestinement, hors contrôle du régime, présente d’ailleurs les conditions de vie dans les townships comme très difficiles et révèlent ainsi que l’abandon par le gouvernement (cf. photo).
1.3 Divisions du territoire post-apartheid et opposition ville/campagne
Nous retrouvons dans l’époque contemporaine cette opposition entre campagne et ville. Si la plupart des films choisissent l’un ou l’autre des contextes, certains montrent encore des migrations internes.
Ainsi, Max and Mona retrace l’histoire d’un jeune homme venu d’un minuscule village du nord du pays pour étudier à Johannesburg. Le personnage présente des similitudes avec celui de Jim. A peine arrivé en ville, il se fait voler ses effets personnels et sa naïveté est à toute épreuve.
Quant à Yesterday, ce drame retrace la dernière année de vie d’une femme sidéenne qui vit dans un petit village rural sud-africain. Elle se rend à Johannesburg pour aller informer son mari, mineur, de sa maladie.
![[title-image]1332154755430[/title-image] Max and Mona](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive8_1416303571650-jpg)
Le cinéma sud-africain oppose la campagne en termes de tradition vs. modernité mais également, pour Yesterday, entre campagne peuplée de femmes et environnement urbain de la mine peuplé d’hommes.
Le réalisateur cherche ainsi à souligner que les effets destructeurs des migrations de travail sur les familles persistent. L’opposition des couleurs marque le contraste, la différence, la rupture entre les deux environnements. Dans Yesterday, cependant, la campagne est tout aussi hostile que la mine.
La ville, clairement identifiée comme Johannesburg dans les deux cas, s’oppose aussi à la campagne car celle-ci est indéterminée. Si la ville est spécifique, la campagne est générique. Les deux films susmentionnés, Max and Mona et Yesterday, s’ouvrent sur des séquences où un personnage est tout à fait isolé dans un paysage vide, dépourvu de présence humaine mais aussi de tout marqueur de cette présence.
Le commentaire du réalisateur dans le DVD de Yesterday confirme d’ailleurs qu’il s’agit là d’une volonté de l’auteur de représenter le « milieu de nulle part » (« middle of nowhere »), impression qu’il a renforcée par un mixage son et un cadrage excluant les bars, la musique house et autres éléments qui ne collaient pas avec cette vision essentialisante de la campagne.
Un autre film du même réalisateur, Jakhalsdans (2010) à destination de la communauté blanche afrikaner, propose une tout autre vision de la campagne comme milieu de nulle part. Le personnage principal est ici une femme blanche, Mara, qui vient s’installer dans un milieu rural isolé. La campagne qu’elle traverse est marquée par la présence humaine. Elle roule sur des routes bien goudronnées, et nous voyons des retenues d’eau, des moulins à vent, des puits, des allées plantées, des poteaux de rugby. La campagne identifiée comme lieu de vie « blanc » chez Roodt est maîtrisée par l’homme. Je ne développe pas ici ces différences, très problématiques, qui doivent faire l’objet d’études complémentaires.
Si nous gardons en mémoire ces oppositions entre ville et campagne, quelle image globale de l’Afrique du Sud pouvons-nous identifier à l’écran ?
1.4 Cartographie du territoire sud-africain
La séquence que je vais vous présenter est extraite de White Wedding et est à ma connaissance l’une des seules représentations visuelles du territoire sud-africain dans son ensemble qui figure dans le cinéma sud-africain des années 2000. Il s’agit de la séquence introductive du film, moitié road-movie, moitié comédie romantique. Selon moi, c’est cette séquence qui donne l’exemple le plus clair d’une géographie vécue de l’Afrique du Sud.
![[title-image]1332154755433[/title-image] Poullenec](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive13_1416304200597-jpg)
Le plan initial présente le globe terrestre, sur lequel s’opère un zoom qui se resserre autour de la province du Gauteng tandis qu’apparaît en surimpression la localisation de Johannesburg. Lorsque le nom de la ville s’ajoute, on entend retentir des sirènes de police, puis la skyline (le profil de la ville) apparaît.
La séquence retourne alors à la carte et utilise le même procédé pour présenter Durban, accompagnée de bruits de klaxon et d’une vue sur le front de mer (à droite).
![[title-image]1332154755436[/title-image] White Wedding](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive11_1416304542875-jpg)
Ensuite, nous revenons à la carte sur laquelle apparaît Cape Town, au sud du pays. Sur fond de musique de jazz lente et chaloupée, nous voyons apparaître la chaine de montagnes des Douze Apôtres baignée dans la lumière du coucher de soleil (à droite).
![[title-image]1332154755437[/title-image] White Wedding](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive12_1416304639921-jpg)
Le film associe à chaque espace un personnage et une scène (que je n’ai pas le temps de détailler trop avant ici). À Johannesburg, le stress, le crime et la méfiance. A Durban, la plage, la fête et l’insouciance. À l’Eastern Cape, la liberté et le voyage (avec le soutien du ministère du tourisme sud-africain?). Au Cap, le calme, le luxe et le snobisme. A Gugulethu, enfin, la famille et les traditions.
Selon moi, cette séquence est particulièrement important parce que
1. Le film est une production sud-africaine et le choix des lieux révèle quels espaces sont perçus comme cardinaux,
et 2. Il permet de différencier les villes entre elles, alors que, dans l’immense majorité des cas, les films présentent soit un espace particulier soit une opposition ville/campagne. D’ailleurs, à l’échelle des villes aussi, il faut aussi examiner les conséquences de l’apartheid et les divisions persistantes.
2. Frontières et traversées dans la ville post-apartheid
2.1 L’apartheid urbain
La géographie d’apartheid est particulièrement persistante dans les villes, dans la réalité ou à l’écran. N.B. Il s’agit là d’une ville-type, schématique, et non d’une ville en particulier. Concepts :
- la séparation des zones résidentielles pour Noirs, pour Blancs, pour Métisses ou Indiens.
- les zones-tampons créées entre les zones résidentielles pour éviter le contact entre les populations. Il s’agissait de terrains vagues d’une centaine de mètres de large au minimum.
- les townships, souvent appelés à tort bidonvilles en français. Le township est une cité-dortoir construite par le gouvernement d’apartheid, avec des habitations identiques, alignées, avec des rues portant des numéros plutôt que des noms (ex : «native yard number 42»). Le township participe à son origine d’une ferme volonté de contrôle des populations, les voies de circulation étant toujours assez large pour laisser passer un tank. Les townships étaient fermés, leurs rares voies d’accès gardées par les forces de police et militaires, qui contrôlaient les populations noires, ou métisses (les deux populations étant séparées), et leur imposaient un couvre-feu. Progressivement livrés à eux-mêmes pour ce qui est de l’habitat, des infrastructures et de l’accès aux services de base, ils ont été le lieu principal des affrontements avec la police dans les années 1980.
Les townships avaient notamment pour but :
- d’assurer la mainmise blanche sur l’économie puisqu’il était interdit d’entreprendre dans les townships
- de réserver le centre-ville à la population blanche
- de cacher la réalité du quotidien des Noirs aux Blancs
Leur abandon a donné lieu au développement de quartiers de bidonvilles, aujourd’hui refuge pour les Sud-Africains les plus pauvres et pour les immigrants africains, quartiers en expansion et aujourd’hui encore d’extrême pauvreté. Ces quartiers de bidonvilles alternent avec quartiers résidentiels relativement aisés, voire très aisés : à Soweto en particulier, certaines propriétés localisées dans le township atteignent un degré de luxe assez élevé.
Les « suburbs » sont des quartiers ou banlieues résidentiels aisés, à l’intérieur ou en périphérie des villes. Aujourd’hui, à l’échelle du pays, la majorité de la population y est encore blanche, mais pas la totalité. Je conserve le terme anglais qui connote un milieu très aisé, à l’opposé du terme « banlieue » en français.
Le township et le suburb sont considérés comme les deux pôles de l’espace urbain dans de nombreux films, pôles diamétralement opposés en matière de représentation
2.2 Opposition entre township et suburb et traversée des frontières
Cette opposition est l’un des ressorts structurants de nombre de films sud-africains. Déjà dans Come Back, Africa (1959), le personnage principal était confronté à l’injustice criante du traitement réservé aux employés noirs par les employeurs blancs dans les suburbs, et à l’inégalité frappante entre ces quartiers et les townships.
En 1988, Mapantsula, autre film anti-apartheid tourné clandestinement (par Oliver Schmitz), explique l’éveil d’un petit gangster à la lutte politique en montrant ses allers-retours entre le township noir où il vit et le suburb blanc où travaille sa petite amie. Ce sont ces constats incessants de l’inégalité des conditions de vie qui l’amènent à progressivement rejoindre les mouvements anti-apartheid. L’espace structure ici la narration, comme dans de nombreux films post-apartheid.
En effet, ces allées et venues, traversées de frontières autrefois presque opaques, entre township et suburb sont un motif récurrent dans de nombreux films des années 2000. Parmi eux, Hijack Stories (Oliver Schmitz, 2000), The Wooden Camera (Ntshaveni WaLuruli 2003) ou encore Tsotsi (Gavin Hood 2005).
Je vais m’appuyer sur le film le plus schématique quant aux rapports entre espaces urbains, The Wooden Camera. Le film raconte l’histoire de l’amitié naissante entre Madiba, un jeune garçon noir pauvre, du township de Khayelitsha, près du Cap, et Estelle, jeune fille blanche très aisée, qui vit à Constantia, l’un des suburbs les plus huppés de la ville. Les deux adolescents, curieux de voir le monde et de s’affranchir des logiques d’apartheid rabâchées par leurs parents, quittent sans arrêt leur quartier d’origine pour se retrouver. Madiba prend le train de banlieue, Estelle son vélo.
Nous voyons ici les premières images de chaque espace : ouvert/fermé, collectif/privé. Ceci est confirmé par les scènes de vie familiale. Madiba, apprenti vidéaste (il a récupéré la caméra d’un défunt), filme à travers les fenêtres, les portes. Depuis l’intérieur, il filme l’extérieur, et vice versa. L’espace du township apparaît donc perméable, ouvert, facile à traverser. En revanche, la maison d’Estelle est entourée de grilles et celle-ci passe son temps, en tant qu’adolescente agacée, à claquer autant de portes que possible. Mais c’est donc bien qu’il y a beaucoup de portes à claquer, et de barrières à franchir…
![[title-image]1332154755444[/title-image] Wooden Camera 2](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive19_1416306967700-jpg)
L’amitié des deux adolescents se tisse par une série de périples l’un dans l’univers de l’autre. Cependant ces traversées échouent toujours à cause des parents. Ce n’est qu’en quittant la ville (on ne sait pas pour où) que les deux amis parviennent à construire une destinée commune. Pour eux, les divisions héritées de l’apartheid sont insurmontables : il faut trouver un autre espace où tout reconstruire et vivre ensemble. Le film est une métaphore de la réconciliation nationale. Sa conclusion (quel espace faut-il quitter ? l’Afrique du Sud ?) est donc un peu ambiguë mais son message est clair : il faut persister à franchir les frontières héritées de l’apartheid, pour rencontrer l’autre, pour investir d’autres espaces et construire ensemble une nouvelle identité, affranchie du passé.
Dans Hijack Stories, l’opposition se fait entre Rosebank, un suburb interne à Johannesburg et Soweto, le plus grand groupe de townships de l’Afrique du Sud. Les chassés-croisés se font entre Sox (né à Soweto et qui a grandi à Rosebank) et Zama, son ami de petite enfance qui, lui, est resté vivre à Soweto. Sox doit apprendre à jouer le gangster pour une audition. Il est acteur. Zama, lui, est un gangster tout ce qu’il y a de plus réel. À force d’allers et retours, Sox s’interroge sur son identité d’homme noir, lui qui a grandi dans un quartier blanc. Son identité véritable lui semble de plus en plus être celle du ghetto, jusqu’à ce qu’il se retrouve, à la fin du film, à la place de Zama, qui passe l’audition et remporte le rôle. Le faux gangster devient le vrai gangster, le vrai gangster devient l’acteur. Les espaces, en même temps que les identités, ont été échangés.
Tsotsi raconte l’histoire d’un petit criminel, adolescent, qui vole une voiture dans laquelle se trouve un bébé. Au contact du nourrisson, il reprend contact avec une conduite morale et avec son identité oubliée. Le bébé vient d’une famille aisée, Tsotsi le sait car il a volé la voiture devant leur domicile. Il y retourne donc plusieurs fois, et va jusqu’à ramener des biberons et des couches quand il cambriole le domicile en question. Si les riches comme les pauvres sont noirs dans le film, on retrouve ici encore la séparation township/suburb, pauvreté contre opulence. Ces allers-retours permettent à Tsotsi de s’interroger sur son enfance oubliée et peu à peu de renouer avec son identité.
Dans les trois cas, la quête identitaire des personnages est associée à des trajets dans l’espace urbain, répétés, depuis un pôle vers un autre, depuis le township vers le suburb, et vice versa.
Conclusions
C’est donc dans ces dessins, dans ces trajectoires que se joue l’une des dynamiques principales du cinéma post-apartheid. Si l’apartheid était une forme d’ordre rigide, alors il faut créer le désordre, bouleverser, rudoyer les frontières, pour finalement tenter de les aplanir, de les effacer. La répétition de ce motif dans les années 2000 montre cependant une obsession pour ces frontières, jamais vraiment surmontées, qui réapparaissent régulièrement dans un nouveau film, à chaque fois comme la clé de la construction identitaire sud-africaine.
J’aimerais à ce sujet faire référence à District 9, film de science-fiction dans lequel un vaisseau spatial échoue au-dessus de Johannesburg. Concernant les frontières héritées de l’apartheid que nous avons évoquées, au sein de l’espace public et entre les espaces résidentiels, leur utilisation détournée dans le film montre qu’elles sont encore cruciales dans la manière d’appréhender et de comprendre l’espace sud-africain. Elles sont déplacées depuis un régime raciste vers une discrimination inter-espèces. Les extra-terrestres à bord sont appelés « crevettes » et arrivent en telle mauvaise condition qu’ils sont parqués dans des camps dont ils ne parviennent pas à repartir en vingt ans, puis dans un District 9 qui, de toute évidence, est un quartier de bidonvilles dans un township (en l’occurrence Chiawelo, près de Johannesburg). La discrimination dont sont victimes les crevettes (et certains dialogues) les assimile en fait aux Noirs victimes de l’apartheid, comparaison d’ailleurs problématique étant donnée l’image peu flatteuse qui est présentée des extra-terrestres.
![[title-image]1332154755447[/title-image] district9](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive20_1416309813167-jpg)
Le film est profondément sud-africain en ce qu’il choisit cet ancrage dans le réel pour opérer le décrochage fantastique. District 9 se déroule pourtant dans une Afrique du Sud réconciliée, post-apartheid, ou Noirs et Blancs cohabitent… mais Blomkamp, en choisissant de fonder la dystopie sur l’apartheid, semble ici conscient du fait que l’ancien régime structure encore profondément l’espace sud-africain, qu’il soit réel ou, comme ici, imaginaire.
Bibliographie
BOTHA, Martin, South African Cinema 1896-2010, Bristol : Intellect, 2012
CHRISTOPHER A.J., The Atlas of Changing South Africa (The Atlas of Apartheid, seconde édition), New York : Routledge, 2001
ELLAPEN, Jordache A., « The Cinematic Township: Cinematic Representations of the ‘Township Space’ and who can Claim the Rights to Representation in Post-Apartheid South African Cinema », Journal of African Cultural Studies vol. 19(1), Juin 2007, 113-137
HOUSSAY-HOLZSCHUCH, Myriam, « Ségrégation, déségrégation, reségrégation dans les villes sud-africaines : Le cas de Cape Town », Historiens et Géographes vol. 379, 31-38
KRUGER, Loren, « Filming the Edgy City: Cinematic Narrative and Urban Form in Postapartheid Johannesburg », Research in African Literatures vol. 37 (2), été 2006
LEMON, Anthony (dir.), The Geography of Change in South Africa, Chichester : Wiley, 1995
MAINGARD, Jacqueline, South African National Cinema, Londres : Routledge, 2007
Marx, Lesley, « Black and Blue in the City of Gold » in NUTTALL, Sarah et MICHAEL Cheryl-Ann (dir.): Senses of Culture: South African Culture Studies, Oxford : Oxford University Press, 2000
TOMASELLI, Keyan, Encountering Modernity: Twentieth Century South African Cinemas, Pretoria : UNISA Press, 2006
Filmographie
Jim Comes to Jo’burg/African Jim (Donald Swanson, 1949)
Cry, the Beloved Country (Zoltan Korda, 1951)
Come Back, Africa (Lionel Rogosin, 1959)
Mapantsula (Oliver Schmitz, 1988)
Hijack Stories (Oliver Schmitz, 2000)
The Wooden Camera (Ntshaveni WaLuruli, 2003)
Max and Mona (Teddy Mattera, 2004)
Yesterday (Darrell Roodt, 2004)
Tsotsi (Gavin Hood, 2005)
District 9 (Neill Blomkamp, 2009)
White Wedding (Jann Turner, 2009)
Jakhalsdans (Darrell Roodt, 2010)

Cette ressource est issue d'une communication donnée lors du colloque SCRIPT « Cinéma d'Afrique du Sud », qui s’est déroulé les 8, 9 et 10 Octobre 2014 à l'Université d'Evry et aux Cinoches de Ris Orangis à l'initiative de Brigitte Gauthier, directrice du laboratoire de recherche SLAM (Synergies Langues Arts Musique).
Pour citer cette ressource :
Annael Le Poullennec, L’espace post-apartheid dans les longs métrages de fiction sud-africains, une étude panoramique, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2014. Consulté le 10/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/arts/cinema/l-espace-post-apartheid-dans-les-longs-metrages-de-fiction-sud-africains-une-etude-panoramique



 Activer le mode zen
Activer le mode zen![[title-image]1332154755428[/title-image] (source adaptée de Anthony Lemon, The Geography of Change in South Africa, 1995)](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive6_1416302453726-jpg)
![[title-image]1332154755431[/title-image] Yesterday](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive9_1416303699174-jpg)
![[title-image]1332154755432[/title-image] Yesterday](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive10_1416303918628-jpg)
![[title-image]1332154755438[/title-image] Division](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive15_1416306117662-jpg)
![[title-image]1332154755443[/title-image] Wooden camera](https://cle.ens-lyon.fr/anglais/images/diapositive18_1416306880097-jpg)