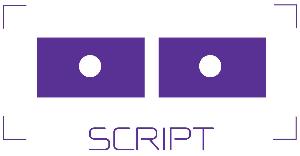Présentation de «Come Back Africa» (Lionel Rogosin, 1959, US 82 minutes)
Vidéo de l'entretien
https://video.ens-lyon.fr/eduscol-cdl/2014/2014-10-08_ANG_Peyriere.mp4
Après avoir réalisé un film sur les sans-abris aux Etats-Unis, Lionel Rogosin part avec une équipe de tournage en Afrique du Sud en déclarant aux autorités locales qu’il veut produire un documentaire sur la musique. Filmé clandestinement par un réalisateur américain blanc dans Sophiatown, un township noir de Johannesburg, Come Back Africa nous montre la vie des communautés noires sous l’apartheid. Entre brimades et défiance, le film de Lionel Rogosin expose les relations blancs/noirs dans l’Afrique du Sud des années 50. Les militants y jouent leur propre rôle dans un scénario de fiction qui nous invite à découvrir le ghetto au travers du regard d’un nouvel arrivant, Zacharia. Les images ont pu sortir d'Afrique du Sud pour être montées aux Etats-Unis puis diffusées dans le monde entier ; c’est un film politique, le premier à dénoncer l’Apartheid.
Transcription de l'intégralité de l'entretien
Julien Buseyne : Pendant les scènes tournées dans la rue, on voit clairement des séquences qui ne sont absolument pas jouées, des scènes de la vie de tous les jours. Par contre, j’ai du mal à savoir si, lorsque Rogosin tourne en rue avec ses acteurs amateurs, les activités en fond de rue sont normales, ou si elles aussi sont mises en scène ?
Monique Peyriere : Il y a les deux. C’est une question assez fondamentale, parce qu’elle permet de revenir à la structure du film et à son mode de production. Quand Lionel Rogosin arrive en 58, en Afrique du Sud, il a depuis quelques années une idée très précise : filmer très précisément ce qui pour lui est un choc énorme, c’est-à-dire la mise en place de l’apartheid dix ans auparavant. Cela le bouleverse, suppose-t-on, parce qu’il constitue une sorte de rappel aux conditions extrêmes vécues pendant l’extermination des juifs d’Europe sous le nazisme, ce qui constitue un apartheid poussé à l’extrême. Il va donc chercher à filmer ce qui est absolument impossible à filmer pour un étranger blanc et juif en Afrique du Sud, c’est-à-dire le point de vue des noirs sur l’apartheid. Comment le vivent-ils alors qu’ils sont parqués et que pour avoir un travail, ils doivent détenir un carnet où sont consignés leurs faits et gestes ainsi que leurs fréquentations, ce que montre très bien le film. Il y a donc comme une intrusion de cette société au plus profond de l’intimité de la communauté noire. Bien entendu, rien dans la réalisation de ce film n’est facile. Tout d’abord, trouver l’argent pour filmer en Afrique du Sud est difficile. Lionel Rogosin vient d’une famille riche, mais il refuse d’être dépendant de sa famille. C’est aussi compliqué de trouver une équipe de tournage, puisqu’il s’agit de filmer de manière clandestine. Il faut donc trouver des professionnels prêts à travailler dans des conditions dangereuses. Cela implique aussi de travailler avec une équipe extrêmement réduite : deux opérateurs suisses et un opérateur israélien d’accord pour ne pas travailler dans les conditions normales de l’époque, et inventer un cinéma à l’instant de sa fabrication. Rogosin se retrouve donc dans les conditions de tournage d’un documentaire, puisque, précisément, il n’y a pas d’équipe ni de studio et qu’il ne dispose pas de véritables acteurs, etc. En plus de ces conditions, il y a les gens qui jouent dans le film. Encore une fois, clandestinement puisque les autorités peuvent découvrir la nature du tournage à tout moment et l’interdire, ainsi que réquisitionner les pellicules. Il est donc très important que les personnes qui participent au tournage ne le dénoncent pas aux autorités. Il s’agit de jouer essentiellement les personnages noirs, qui habitent le township de Sofiatown. Les acteurs sont des militants engagés dans la lutte anti-apartheid qui se connaissent. Rogosin entre en contact et crée des liens de travail avec eux. Il les rencontre, habite sur place, y vit avec sa femme et son fils. Sa manière d’être présent participe des raisons qui poussent les gens à accepter de travailler dans les conditions décrites, de jouer leur propre rôle malgré la clandestinité et les risques qu’elle fait encourir à tout le monde. Ensuite, il y a le problème des blancs. Il n’est pas question de faire appel aux Afrikaners, ou bien à ceux qui promeuvent et maintiennent l’apartheid, et ce sont des blancs investis et engagés dans la lutte anti-apartheid qui acceptent de jouer le rôle des oppresseurs blancs. C’est ainsi que le casting va se monter au fur et à mesure, dans la plus grande clandestinité possible. Cela influence beaucoup l’esthétique du film. Dans les interviews que Rogosin a données, en particulier dans le film dédiée à Come Back Africa que son fils a réalisé, il dit toujours qu’il a été mu par deux filiations importantes pour lui : celle de Nanouk de Flaherty d’une part, et d’une autre part les films de fiction de la mouvance du néo-réalisme, en particulier Le Voleur de bicyclettes de Vittorio de Sica.
JB : Je ne connais pas du tout la première référence.
MP : Nanouk, est un des fondements du film documentaire. Il se déroule en 1923-24. Flaherty est allé dans le Grand Nord filmer une famille d’esquimaux.
JB : Oui, je pense l’avoir vu. Nous parlons bien des années 20 ou 30 ?
MP : Oui, c’est en 1924.
JB : J’en ai vu des extraits en anthropologie, on le montre aussi parfois aux étudiants en communication.
MP : Voilà, ça fait partie d’un bagage. C’est aussi un très grand film qui possède un versant ethnologique : on part au loin filmer et porter trace d’une vie qu’on ne connaît pas. Et c’est aussi ce que fait Rogosin, quand il arrive à Johannesburg. Il va filmer ce qui n’est jamais filmé : la vie dans le township de Sofiatown. Vous parliez très justement des scènes de rue. Ces scènes documentées viennent par deux bouts. Le premier : pour avoir l’autorisation de filmer, Rogosin va donner des justifications aux autorités. L’une d’elle, c’est justement de filmer la musique que font les noirs dans la rue. Il peut alors prendre sa caméra et, on le voit, [filmer la rue]. C’est pourquoi les personnages sont absents d’un certain nombre de plans. Cela confère à l’œuvre une esthétique tout à fait intéressante, l’absence des personnages donnant à ces plans une sorte de vérité, de cinéma-vérité, entre guillemets, de la vie de l’époque, de la vie telle qu’elle se vivait. C’est-à-dire que le hors-champ du film devient tout aussi important que son histoire. Il y a l’histoire de Zacharia et il y a aussi tout ce hors-champ qui vient, grâce au montage, lui donner une respiration, et vient aussi donner quelque chose de la vie telle qu’elle pouvait se vivre. Il y a la vie telle qu’elle se raconte dans la fiction et il y a la vie telle qu’elle était vécue alors : dans les plans, on voit la foule qui déambule, les enfants qui jouent, les voitures… On a aussi des architectures d’opposition entre d’un côté ce qui se passe dans la ville urbaine et de l’autre côté ce qui se passe dans le township. On assiste donc à un montage très alterné qui montre à chaque fois une vie différente d’un lieu à un l’autre. Dans les plans où la foule est présente, elle véhicule une ambiance. Sofiatown ayant été détruite deux ans après le tournage, ces plans-là ont valeur de documentaire parce que, précisément, c’est une trace de ce qui a à jamais disparu.
JB : J’en reviens à la démarche. En fait, j’ai l’impression que la première partie de District 9, le film dont je vais parler demain, est une transposition de Come back Africa, car l’histoire est, pour résumer, un retournement du film de science-fiction impliquant des extra-terrestres, où les extra-terrestres sont les victimes des êtres humains. Un vaisseau spatial s’arrête au-dessus de Johannesburg, on y découvre un million de créatures insectoïdes désorganisées et malades. On les parque dans un ancien township où elles subissent le même genre de violence que les noirs subissaient de la part des blancs. Mais dans ce film, ils arrivent en 1982, et ces créatures sont les oubliées de la fin de l’apartheid. On y voit donc une continuation des habitudes de la société sud-africaine, où des êtres qu’on déclare inférieurs sont maltraités, sans se poser plus de question, sans chercher à les éduquer ou créer des ponts avec eux.
MP : C’est intéressant parce que ça fait une sorte de mise en abîme du cinéma par lui-même, et ça c’est assez passionnant. D’autant plus si l’on sait que ce film là [Come Back Africa] est sorti en Afrique du Sud pour la première fois en 1980. Donc ça correspond…
JB : Je ne connaissais pas la concordance des dates mais elle est intéressante, et ce qui l’est d’autant plus, c’est que justement Neil Blomkamp utilise le cinéma-vérité pour tourner son film, caméra sur l’épaule, au plus près des corps, les visages ne sont même pas entièrement cadrés… Ça bouge dans tous les sens, on est vraiment au cœur d’une violence viscérale et dégoulinante qui ne fait qu’exprimer une violence envers un groupe de soumis. Et tout ce que vous me dites, en fait, me fait penser que Neil Blomkamp a dû voir Come Back Africa, et ça a dû le marquer. Profondément.
MP : Je pense que même à l’heure actuelle, c’est toujours un film très revendiqué, même s’il a été tourné il y a 60 ans et s’il s’est passé beaucoup de choses entretemps. Il est revendiqué en tant que trace mémorielle, c’est sûr, mais il est aussi revendiqué parce que c’est la première fois que Myriam Makena chante à l’écran. Elle était très connue à l’époque au sein de la communauté noire, mais elle n’était pas connue en dehors avant d’entreprendre une carrière internationale par la suite, avant de devenir la personne engagée que l’on sait. Si je me souviens bien des propos du fils de Lionel Rogosin à propos de cette séquence, à l’époque, elle chantait dans la rue, elle était connue, mais elle avait une peur bleue de tout ce qui était caméra. Elle était d’une grande timidité, et tout le monde se disait « c’est incroyable » parce que lorsqu’elle entre dans cette séquence, elle donne l’impression d’être une personne anonyme et banale, quelqu’un parmi d’autre, mais quand elle commence à chanter tout à coup, elle capte la lumière de la caméra, elle capte tous les rayons et devient un astre. L’émotion est toujours présente, et ce n’est pas le simple fait de la filmer. Elle va au devant de l’écran, ou plutôt au devant de la caméra. On sent qu’elle éclot.
JB : Tout à fait. C’est la séquence qui m’a le plus marqué dans le film.
MP : C’est la séquence-culte. C’est celle qui remporte tous les suffrages sur Youtube [tout le monde rit] et sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c’est le succès assuré.
JB : Je comprends pourquoi, c’est d’autant plus frappant…
MP : Revenons à cette séquence. Généralement, dans Youtube ou les réseaux sociaux, on ne voit que la séquence ou elle arrive [et chante], or c’est la séquence entière qui est importante parce qu’elle n’est pas construite par une opposition, mais par un glissement de la pensée politique vers le chant. C’est un mouvement extrêmement fluide à l’intérieur de la séquence. C’est une mise en scène. On a l’impression que c’est un bar clandestin, un shibin, mais c’est en fait une sorte de studio, un bar reconstitué. C’était compliqué d’aller filmer dans un vrai shibin, un vrai bar clandestin, les risques étaient vraiment trop grands et il fallait que la caméra puisse tourner tout autour, mais on sent bien que les acteurs jouent réellement leurs propres rôles puisque les discussions qu’ils amènent sont véritablement les discussions dont on sait, pense, se doute, et dont il y a confirmation, que c’est ainsi qu’ils passaient leurs soirées : en train de boire, de discuter politique et d’échanger sur des sujets profonds. Et là encore, cette façon de faire, cette idée, une des premières séquences à avoir été filmée, tout cela est profondément lié au mode de fabrication du film. Quand Rogosin a voulu mettre en place son tournage, il a d’abord rencontré les militants anti-apartheid, et c’est par une co-écriture avec eux qu’ïl a décidé des séquences du film. C’est parce que c’est une co-écriture et une co-fabrication qu’un blanc, étranger, arrive à travailler avec des militants anti-apartheid noirs sur l’écriture même du film, et pas simplement sur un témoignage, alors qu’à l’époque aucun noir ne pouvait faire du cinéma. Il n’y avait pas de technicien noir, pas d’écrivain noir, pas de caméraman noir.
JB : C’est d’autant plus surprenant qu’il pouvait y avoir des avocats et des médecins noirs. Nelson Mandela a fait une carrière d’avocat dans ces années-là.
MP : Oui, parce que là, même dans le film, on voit que les enfants doivent pouvoir devenir médecin et etc. Donc je suppose que oui.
JB : Mais pas dans le cinéma ?
MP : En fait, si j’ai bien compris, le régime afrikaner était extrêmement soucieux de contrôler son image, de contrôler ce qui pouvait être dit sur lui. Il mène donc une sorte de guerre de communication. D’ailleurs, juste avant ce film-là, Sidney Poitier avait tourné un documentaire contre l’apartheid, qui avait été interdit. Tout ce qui était permis, c’était de filmer des séquences traditionnelles, mais pas de s’en prendre à la dimension étatique du racisme.
JB : Donc pas de témoignage des restrictions sur le travail et le logement.
MP : Oui, le travail et le logement, mais peut-être la thématique la plus importante du film est-elle l’humiliation ? On y retrouve un peu des Lettres persanes. Zacharie arrive de la campagne et découvre ce qui se passe dans le township et Johannesburg. Il découvre aussi les blancs très concrètement, comme le montrent toutes les séquences où il entre en relation avec telle et telle personne, que ce soit dans les mines, dans le privé, sur la route. On le suit dans toutes les situations où il peut se confronter directement à des blancs. Et c’est toujours cette confrontation là qui est importante. Ce n’est pas un documentaire sur la vie des noirs dans le township, c’est un film qui s’intéresse à cette friction, à cette relation de soumission, de violence inouïe sur la personne. Si vous faites attention, on voit très peu de bagarres. On voit des bagarres de noirs entre eux, mais la violence physique en tant que telle n’est pas très exposée, alors qu’on assiste à de la violence symbolique dans chaque séquence, c’est -à-dire des humiliations, subies par des femmes et des hommes. En même temps, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c’est qu’il ne se résume pas à un catalogue de situations, et qu’il ne tombe pas dans la caricature. Zacharia joue son rôle de paysan qui arrive à la ville et qui découvre de manière extrêmement naïve, avec beaucoup d’ingénuité, ce qu’il doit faire. Il agit comme s’il n’était pas déjà pris dans un corset idéologique. Il découvre la façon dont les choses se passent. Il va au devant, ce qui nous permet, en tant que spectateurs, de nous identifier à ce regard là, un regard de découverte, de curiosité. À chaque fois, un peu comme dans un conte, il lui arrive quelque chose, et à chaque fois, il trouve une voie de sortie car quelqu’un lui vient en aide. Il y a donc sans arrêt quelque chose qui vient ouvrir le destin, puis qui le referme. En le suivant, nous mûrissons avec lui. Nous encaissons les coups, mais à chaque fois il repart, sauf à la fin du film où sa femme meurt.
Clifford Armion : Est-ce que les acteurs ont fait l’objet de représailles ou de tentatives de représailles après la diffusion ?
MP : D’après ce dont je me souviens, certains sont parvenus à sortir [du pays]. Myriam Makena a réussi à fuir l’Afrique du Sud, et aussi deux des militants. D’autres sont restés, parce que parmi ces militants politiques se trouvaient des musiciens. Le film rend compte de cette effervescence, à la fois politique et littéraire, dans la séquence à laquelle on revient toujours, avec Makena. Ce n’est pas si évident de filmer des noirs qui échangent sur la religion ou la condition noire, qui ne sont pas forcément d’accord avec les représentations des uns et des autres, qui se demandent quels sont les bons entre les progressistes et les plus radicaux, ou si les mauvais garçons sont les bons noirs ou pas. Il y a toute une discussion extrêmement tendue, que je trouve d’ailleurs très contemporaine. On pourrait l’étudier et la transposer aux États-Unis ou en France. On pourrait voir quels sont les arguments radicaux, les progressistes. [Le débat sur] les bons blancs [est intéressant]. Est-ce que ce sont ceux qui donnent du thé ou est-ce que ce sont ceux qui mettent leurs employés dehors ? Toutes ces ambiguïtés sont parfaitement portées par le film, qui esquive les stéréotypes. Ce sont des échanges, les personnages continuent à mener leur vie, sauf les blancs [qui ne font que transiter]. D’après ceux qui les jouaient, il y avait des blancs bien pires que ceux interprétés dans le film alors qu’ils nous apparaissent un peu caricaturaux. Nous sommes aussi spectateurs de la diversité, de ce qui fait la vie d’une société, sa possibilité d’échanger. En est témoin la petite tirade à la fin [de la scène de débat] quand celui qui prend la parole parle d’un espoir de communauté et d’échange, car leur communauté autour de la table pourrait représenter la possibilité d’une communauté beaucoup plus grande, avec ses échanges, ses divergences, mais aussi sa possibilité d’apparaître.
JB : J’ai noté, justement, cette ambiguïté dans la dispute entre le mari et la femme lorsqu’il [Zacharia] lave la vaisselle. Il essaie de la raisonner, mais ne va pas non plus voler au secours de son employé noir. On imagine bien qu’il a des priorités. De même, lorsqu’il est embauché à l’hôtel et se fait renvoyer, on sent que son employeur veut le garder, mais qu’il le renvoie tout de même pour éviter de beaucoup plus gros problèmes. C’est un film qui joue dans les nuances des représentations.
MP : Oui. Je suis tout à fait d’accord. Il y a des nuances. Cela joue sur le noir et blanc, ce magnifique noir et blanc, et pourtant tout est en nuance à l’intérieur. Quand on s’approche, on s’approche de manière extrêmement humaine des visages.
JB : Tout à fait. En fait, il procède très peu par symbole. Il procède par situation. Chaque situation a sa propre logique, et il y a un fil directeur qui les relie, et qui permet de créer un récit global.
MP : Ça, c’est le récit fictionnel. Il nous permet de nous identifier au personnage principal et à ses découvertes au fur et à mesure, et, comme je le disais tout à l’heure, il y a un phénomène de conte tout à fait caractéristique. Mais, encore une fois, c’est le hors-champ de ce récit qui devient intéressant, avec la confrontation des deux, avec toutes ces scènes documentées où il n’y a pas du tout de personnages et où la ville vit, le township vit, les enfants sont là et ne sont pas forcément pris dans une histoire, ils sont présents parce qu’il y a une vraie vie. C’est très certainement ce à quoi faisait attention Rogosin, en relation avec son goût extrêmement prononcé pour le néo-réalisme italien. Dans Le Voleur de bicyclette, on suit à la fois le personnage et la ville, qui a ses propres pulsations. On a l’impression que la fiction vient se loger, vient se lover à l’intérieur de quelque chose qu’on reconnaît comme étant la vie quotidienne et nous permet de ne jamais être contraint dans une histoire. Le cinéma permet cette échappée à condition qu’il y ait du hors-champ.
Hélène Fleury : Moi, je voudrais me pencher sur les conditions de la diffusion du film. Est-ce qu’il y a eu une rétribution pour les acteurs. Je crois qu’au début, vous avez dit que le film avait été diffusé en Afrique du Sud en 1980 seulement. Alors est-ce qu’il y a eu une rétribution pour les acteurs immédiatement, et comment le film a été accueilli hors Afrique du Sud, globalement ? Quel a été son impact ?
MP : Comme je le disais tout à l’heure, c’était une situation rocambolesque puisque c’était un film tourné en clandestinité, en inventant toutes sortes de prétextes pour pouvoir filmer. À un moment donné, c’est devenu très délicat. Rogosin a réussi à faire sortir ses images, ce qui était un véritable exploit, qu’un monteur a commencé à monter aux États-Unis. Il a laissé une partie de son équipe sur place, car il manquait des plans et certaines choses devaient être achevées. Mais, une fois arrivé aux États-Unis, Rogosin a commencé à vouloir faire la promotion de son film car il avait besoin d’argent, et a commencé à raconter des choses qui contredisaient les propos qu’il avait tenus aux autorités sud-africaines. Évidemment, elles ont compris que le contenu du film n’avait rien à voir avec un documentaire sur la musique sud-africaine, de la communauté noire et du township. À un moment donné, il a carrément prétendu qu’ils allaient faire un film de fiction sur la guerre des Boers. Les autorités ont alors réalisées que tout n’était qu’invention et les membres de l’équipe restés sur place furent mis dans un avion. Ce film est devenu important lorsque cette supercherie fut éventée, et il fut présenté d’abord au festival de Venise où il reçut un prix très important, puis il circula en Europe et aux États-Unis. En plus, Myriam Makena venait de quitter l’Afrique du Sud et elle a accompagné la promotion du film. Elle ne l’a pas accompagné jusqu’au bout pour des raisons personnelles. Par la suite, Rogosin a utilisé son argent pour acheter un cinéma à New-York, dans lequel il a très régulièrement diffusé ses films, dont Come Back Africa qui est devenu (et qui est toujours, vous le voyez) une sorte de film culte. En noir et blanc, en grand écran avec une bonne copie, ce film parvient toujours à capter l’attention du public. J’ignore s’il a continué à être beaucoup vu, toujours est-il que le fils de Lionel Rogosin, lui-même documentariste et cinéaste, a fait un documentaire sur ce film et a aussi récupéré toutes les bobines des films de son père et les a confiées à la cinémathèque de Bologne, qui les a restaurées et en a fait des copies formidables. C’est ainsi qu’on peut avoir ces noir et blanc extraordinaires maintenant, y compris sur une copie de DVD, ce qui n’est pas si facile. Carlotta a récemment sorti en France un certain nombre de coffrets Rogosin, dont les films sont sous-titrés en français, qui sont depuis déjà pas mal de temps épuisés [NDR : Depuis, Carlotta en a produit de nouveaux], et on espère donc qu’ils en ressortiront. Pour le premier film réalisé par Rogosin, On the Bowery, un film sur les clochards de New-York qui se déroule sous un pont, il est allé filmer dans la rue des personnes sans voix, que l’on ne voyait pas, dont on n’avait pas les mots. Dans Come Back Africa, parfois, vous avez dû le remarquer, on a parfois l’impression que les dialogues sont un peu empesés. Il y a des hésitations, en particulier autour des scènes de fiction, qui donnent l’impression de manquer de fluidité. C’est en partie parce que les dialogues sont en anglais alors que la parole, la langue de tous les jours, n’est évidemment pas l’anglais, car l’anglais est la parole des blancs. Il a fallu mettre en scène cette parole là, mais de temps en temps, dans certaines séquences, on entend d’autres langues, dont la langue zoulou. Si on fait attention, on trouve aussi cette différence à l’intérieur même du film. Les traducteurs parleraient de coexistence de ces modes de langage. L’importance de la langue est aussi restituée. Il y a la langue de l’humiliation et puis il y a ces moments qui donnent ces côtés encore vivants dont je parlais tout à l’heure. Ce n’est pas simplement la rue, etc, ce sont aussi les mots, les langages, qui ne sont pas forcément sous-titrés et en tout cas qui ne sont pas forcément dits en anglais, et qui échappent donc à l’histoire, qui échappent au côté fictionnel du récit.
JB : Ce que j’ai trouvé intéressant dans les parties filmées dans la rue, dans les parties documentaires pour ainsi dire, c’est la mixité des rues. Lorsqu’on est dans les quartiers du centre-ville, on voit les noirs et les blancs qui se mêlent, écoutent de la musique ensemble, et ensuite, quand on a les scènes dans lesquelles on montre comment la violence sociale qui s’exerce à l’encontre des noirs, on se rend bien compte, en fait, que cette mixité est complètement effacée par la gradation entre dominants et dominés qui se manifeste jusque dans les moments où ils sont mêlés, c’est très brutal, en fait. C’est sur du velours, ça se passe sans violence – physique –, mais la violence sociale qui est déployée dans ces scènes est énorme.
MP : Oui, je pense que [le montrer] est une des objectifs du film. Dans les scènes de rue, les noirs sont certes présents dans la ville des blancs, mais il ne s’agit pas de mixité. Chacun à son territoire, je veux dire le territoire de ceux qui font de la musique etc… Disons que la rue permet une sorte de vis-à-vis. Chacun essaye de s’éviter.
S : Ils essayent de traiter des problèmes entre ethnie, si j’ai bien compris. Ils parlent des sutsi. Ça avait l’air d’être un thème récurrent et c’est toujours montré de façon assez… Enfin ils sont toujours vus soit dans l’ombre, soit de loin. On ne les voit presque jamais, ils sont cités. La première fois on les voit apparaître devant la caméra dans l’ombre, on ne les voit pas…
MP : La question du racisme d’état devient, dans le film, une interrogation sur les personnes qui sont à même de lutter contre ce racisme d’état, cette violence, symbolique ou non, et ces humiliations. Est-ce que c’est Zacharie ? Il n’est pas une victime, il lui arrive des tas de choses, et à chaque fois il réagit, à chaque fois il va trouver de l’aide, souvent au sein de sa communauté. Jusqu’à la fin, où sa femme est assassinée non pas par un blanc, mais justement par un bad boy. Les bad boys, ce sont les méchants noirs, mais les méchants noirs qui tuent d’abord un autre noir avant de s’en prendre aux blancs. Alors est-ce que ce sont eux les porteurs de la possibilité de rendre la pareille aux blancs… de sortir de cette violence ? Est-ce que le militant est avant tout celui qui doit tolérer tout le monde ou est-ce que c’est celui qui décide que de toutes façons il faut semer le chaos parce que c’est l’ensemble des structures sociales qui sont violentes. Je pense que les discussions autour de la figure du bad boy, juste avant le chant de Myriam Makena, sont centrales. Rappelez-vous des paroles d’un militant : « mais, en fait, il faut le comprendre, il a mené telle vie et à chaque fois il a fait de mauvais choix, et à chaque fois quelqu’un lui dit “mais nous on n’a pas fait ce choix-là”. Mais lui il l’a fait et chaque fois il va de plus en plus loin dans la violence, et la violence contre ses proches et pas [contre les blancs]». Savoir si ce débat est politique ou non devient central. Et donc la question de savoir si ça c’est du politique ou si ça n’en est pas devient centrale. C’est vraiment tout à fait contemporain. Que ce soit international ou que ce soit là où nous sommes, en Île de France.

Cette ressource est issue d'une communication donnée lors du colloque SCRIPT « Cinéma d'Afrique du Sud », qui s’est déroulé les 8, 9 et 10 Octobre 2014 à l'Université d'Evry et aux Cinoches de Ris Orangis à l'initiative de Brigitte Gauthier, directrice du laboratoire de recherche SLAM (Synergies Langues Arts Musique).
Pour citer cette ressource :
Monique Peyrière, Julien Buseyne, Présentation de Come Back Africa (Lionel Rogosin, 1959, US 82 minutes), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2014. Consulté le 19/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/arts/cinema/presentation-de-come-back-africa-lionel-rogosin-1959-us-82-minutes-



 Activer le mode zen
Activer le mode zen