«2666» de Roberto Bolaño
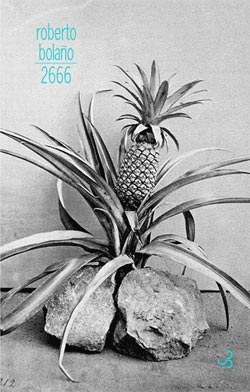 Il est des livres épuisants. Le poids de l'ouvrage n'est pas en cause, encore qu'il faille s'entendre sur ce « poids », poids physique et poids de la légende. Les deux pèsent. Pèsent « grave ». Pas en cause non plus, sans doute, les sentiments, l'émotion suscités par la lecture. On se perd dans la légende. On sait, on nous l'a assez répété, que Bolaño, malade, mourant, aurait voulu que les publications des cinq parties de l'ensemble soient dissociées ; que l'ouvrage est inachevé mais complet ; qu'on ignore ce qu'il y manque mais qu'il semble n'y rien manquer. On a construit un mythe autour de ce livre, et il n'est nullement question ici de revenir sur ce mythe, roman magistral, premier grand roman du XXIe siècle, étude du Mal en vraie grandeur, mélange des genres. Autant d'affirmations infirmées çà et là, autant de polémiques que de « critiques ». Les guillemets ont ici leur importance. Renonçons à donner une idée d'ensemble de l'ouvrage, dont la quatrième de couverture de l'édition Bourgois nous assène que « 2666 offre un parcours abyssal à travers une culture et une civilisation en déroute », précisant que « l'entreprise de Bolaño est ambitieuse ». Maîtrisons notre ambition face à ce texte, et regardons simplement les pages 971 à 976 de cette édition.
Il est des livres épuisants. Le poids de l'ouvrage n'est pas en cause, encore qu'il faille s'entendre sur ce « poids », poids physique et poids de la légende. Les deux pèsent. Pèsent « grave ». Pas en cause non plus, sans doute, les sentiments, l'émotion suscités par la lecture. On se perd dans la légende. On sait, on nous l'a assez répété, que Bolaño, malade, mourant, aurait voulu que les publications des cinq parties de l'ensemble soient dissociées ; que l'ouvrage est inachevé mais complet ; qu'on ignore ce qu'il y manque mais qu'il semble n'y rien manquer. On a construit un mythe autour de ce livre, et il n'est nullement question ici de revenir sur ce mythe, roman magistral, premier grand roman du XXIe siècle, étude du Mal en vraie grandeur, mélange des genres. Autant d'affirmations infirmées çà et là, autant de polémiques que de « critiques ». Les guillemets ont ici leur importance. Renonçons à donner une idée d'ensemble de l'ouvrage, dont la quatrième de couverture de l'édition Bourgois nous assène que « 2666 offre un parcours abyssal à travers une culture et une civilisation en déroute », précisant que « l'entreprise de Bolaño est ambitieuse ». Maîtrisons notre ambition face à ce texte, et regardons simplement les pages 971 à 976 de cette édition. 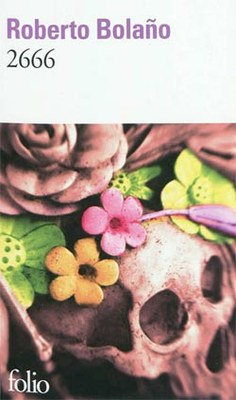 Archimboldi, écrivain invisible, nobélisable, qui est un des fils rouges du livre - on a voulu y voir un démarquage de la figure de Pynchon - se retrouve dans une clinique psychiatrique où « avaient trouvé asile tous les écrivains disparus d'Europe ». La description de cette clinique est à l'évidence métaphorique. « Les écrivains disparus se trouvaient dans la salle à manger, en train de dîner et de regarder la télévision, qui à cette heure-là donnait les informations. Ils étaient nombreux, et presque tous français, ce qui étonna Archimboldi, qui n'aurait pas imaginé qu'il puisse exister autant d'écrivains disparus en France ». Le lecteur tressaille, sursaute, bondit. Dans les 971 pages précédentes, on a exploré les recoins les plus sombres du monde ; on est passé par Londres, Paris et Madrid où l'on a pu prendre la mesure de la pantalonnade des colloques universitaires ; on était à Santa Teresa, au Mexique, dans l'enfer des maquiladoras ; on a égrené la lente et terrible litanie des femmes assassinées ; on a... et puis on a encore... Et voilà que tout d'un coup six pages sur mille vingt-quatre émergent de l'ensemble. Six pages qui vibrent, six pages qui pourraient être sans peine sorties de l'ouvrage et considérées comme une nouvelle, comme une fable. Six pages qui, sous couvert de farce, nous poignardent. Les chambres de la clinique dans laquelle se trouve Archimboldi sont « ascétiques, avec un petit lit, une table, une chaise, une télévision, une armoire, un réfrigérateur de petite dimension et une salle de bain avec douche ». Les chambres sont toutes identiques, l'écrivain le constate lorsqu'il se rend chez l'essayiste qui l'a attiré dans ce lieu. Dans la chambre de l'essayiste, cependant, sur la table de chevet, il y a « une pomme posée sur un plateau blanc ». La pomme sur le plateau, dans un ouvrage foisonnant dont on nous dit qu'il parle du Mal, voilà qui éveille un petit écho d'homme chassé du paradis. « La nuit, cette pomme sent, dit l'essayiste. Lorsque j'éteins. Elle sent autant que le sonnet des voyelles. Mais tout fait naufrage, à la fin, dit l'essayiste. Naufrage dans la douleur. Toute l'éloquence vient de la souffrance. - Je comprends, dit Archimboldi, même s'il n'y comprenait goutte ». On pourrait - on devrait - en rire. On est terrassé. Terrassé tout autant par l'incompréhension de l'écrivain-modèle, de l'écrivain-phare, que par l'évidence de l'image de cette pomme - que l'on imagine aisément peinte par Magritte - dont l'odeur est celle de la poésie rimbaldienne. Archimboldi est arrivé dans cette clinique psychiatrique en taxi, « taxi délabré, conduit par un chauffeur qui parlait tout seul ». L'écrivain, agacé, intime au chauffeur de se taire. Lorsqu'il s'échappe de la clinique, Archimboldi retrouve le même taxi sur la place de la gare : « le chauffeur n'était pas là, mais en passant à côté de la voiture Archimboldi vit une masse sur le siège arrière qui s'agitait et de temps en temps criait ». Remontons huit cent quatre-vingt trois pages en arrière, et souvenons-nous : ce premier mouvement de l'ouvrage, intitulé « la partie des critiques », met en scène quatre universitaires qui tous travaillent sur l'œuvre d'Archimboldi, le Français Pelletier, l'Espagnol Espinoza, l'Italien Morini et l'Anglaise Norton. Petit monde étroit, monomaniaque, se donnant des airs d'émancipation et de modernité en faisant ménage à trois et laissant éclater une violence terrifiante face à un chauffeur de taxi pakistanais qui a le tort de s'égarer dans « le labyrinthe de Londres » et traite plus ou moins ouvertement Norton de pute. Pelletier et Espinoza massacrent le Pakistanais sous les yeux de Norton. Cette scène est placée sous le signe de la littérature. La dispute éclate à propos du terme de « labyrinthe », que les universitaires associent immédiatement à Borgès, puis le chauffeur est massacré, entre autres, aux cris de « tiens ça c'est pour Salman Rushdie ». Le chauffeur de taxi. Pour l'écrivain comme pour les chercheurs qui sans relâche fouillent son œuvre et cherchent à le débusquer, il est la figure expiatoire de... d'on ne sait quoi, au fond. Ce dont on est sûr, en tant que lecteur, c'est qu'il s'agit de littérature. Là où l'on se prend à hésiter, c'est sur l'image de cette littérature. Que l'on cogne sur le chauffeur à cause de Borgès, ou que l'on soit agacé par la logorrhée d'un autre chauffeur qui vous emmène à l'asile des écrivains disparus, critiques et auteur restent énigmatiques. Et le lecteur dubitatif. Roberto Bolaño, 2666, traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio, Bourgois, 2008, 1024 p. (réédition Folio, 2011).
Archimboldi, écrivain invisible, nobélisable, qui est un des fils rouges du livre - on a voulu y voir un démarquage de la figure de Pynchon - se retrouve dans une clinique psychiatrique où « avaient trouvé asile tous les écrivains disparus d'Europe ». La description de cette clinique est à l'évidence métaphorique. « Les écrivains disparus se trouvaient dans la salle à manger, en train de dîner et de regarder la télévision, qui à cette heure-là donnait les informations. Ils étaient nombreux, et presque tous français, ce qui étonna Archimboldi, qui n'aurait pas imaginé qu'il puisse exister autant d'écrivains disparus en France ». Le lecteur tressaille, sursaute, bondit. Dans les 971 pages précédentes, on a exploré les recoins les plus sombres du monde ; on est passé par Londres, Paris et Madrid où l'on a pu prendre la mesure de la pantalonnade des colloques universitaires ; on était à Santa Teresa, au Mexique, dans l'enfer des maquiladoras ; on a égrené la lente et terrible litanie des femmes assassinées ; on a... et puis on a encore... Et voilà que tout d'un coup six pages sur mille vingt-quatre émergent de l'ensemble. Six pages qui vibrent, six pages qui pourraient être sans peine sorties de l'ouvrage et considérées comme une nouvelle, comme une fable. Six pages qui, sous couvert de farce, nous poignardent. Les chambres de la clinique dans laquelle se trouve Archimboldi sont « ascétiques, avec un petit lit, une table, une chaise, une télévision, une armoire, un réfrigérateur de petite dimension et une salle de bain avec douche ». Les chambres sont toutes identiques, l'écrivain le constate lorsqu'il se rend chez l'essayiste qui l'a attiré dans ce lieu. Dans la chambre de l'essayiste, cependant, sur la table de chevet, il y a « une pomme posée sur un plateau blanc ». La pomme sur le plateau, dans un ouvrage foisonnant dont on nous dit qu'il parle du Mal, voilà qui éveille un petit écho d'homme chassé du paradis. « La nuit, cette pomme sent, dit l'essayiste. Lorsque j'éteins. Elle sent autant que le sonnet des voyelles. Mais tout fait naufrage, à la fin, dit l'essayiste. Naufrage dans la douleur. Toute l'éloquence vient de la souffrance. - Je comprends, dit Archimboldi, même s'il n'y comprenait goutte ». On pourrait - on devrait - en rire. On est terrassé. Terrassé tout autant par l'incompréhension de l'écrivain-modèle, de l'écrivain-phare, que par l'évidence de l'image de cette pomme - que l'on imagine aisément peinte par Magritte - dont l'odeur est celle de la poésie rimbaldienne. Archimboldi est arrivé dans cette clinique psychiatrique en taxi, « taxi délabré, conduit par un chauffeur qui parlait tout seul ». L'écrivain, agacé, intime au chauffeur de se taire. Lorsqu'il s'échappe de la clinique, Archimboldi retrouve le même taxi sur la place de la gare : « le chauffeur n'était pas là, mais en passant à côté de la voiture Archimboldi vit une masse sur le siège arrière qui s'agitait et de temps en temps criait ». Remontons huit cent quatre-vingt trois pages en arrière, et souvenons-nous : ce premier mouvement de l'ouvrage, intitulé « la partie des critiques », met en scène quatre universitaires qui tous travaillent sur l'œuvre d'Archimboldi, le Français Pelletier, l'Espagnol Espinoza, l'Italien Morini et l'Anglaise Norton. Petit monde étroit, monomaniaque, se donnant des airs d'émancipation et de modernité en faisant ménage à trois et laissant éclater une violence terrifiante face à un chauffeur de taxi pakistanais qui a le tort de s'égarer dans « le labyrinthe de Londres » et traite plus ou moins ouvertement Norton de pute. Pelletier et Espinoza massacrent le Pakistanais sous les yeux de Norton. Cette scène est placée sous le signe de la littérature. La dispute éclate à propos du terme de « labyrinthe », que les universitaires associent immédiatement à Borgès, puis le chauffeur est massacré, entre autres, aux cris de « tiens ça c'est pour Salman Rushdie ». Le chauffeur de taxi. Pour l'écrivain comme pour les chercheurs qui sans relâche fouillent son œuvre et cherchent à le débusquer, il est la figure expiatoire de... d'on ne sait quoi, au fond. Ce dont on est sûr, en tant que lecteur, c'est qu'il s'agit de littérature. Là où l'on se prend à hésiter, c'est sur l'image de cette littérature. Que l'on cogne sur le chauffeur à cause de Borgès, ou que l'on soit agacé par la logorrhée d'un autre chauffeur qui vous emmène à l'asile des écrivains disparus, critiques et auteur restent énigmatiques. Et le lecteur dubitatif. Roberto Bolaño, 2666, traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio, Bourgois, 2008, 1024 p. (réédition Folio, 2011).
Publication
Première publication de cet article in La Cause Littéraire, mars 2011.2666 sur le web
Esquisses par François Monti 2666 : «des gens qui commencent par faire la fête et finissent par s'entretuer», par Olivier Lamm "...nous, nous sommes ici, et jamais nous ne serons plus proches de lui." - à propos de 2666 de Roberto Bolaño, par Antonio Werli et la remarquable analyse de Juan Asensio : 2666 de Roberto Bolaño en castellano: Pervivencia del autor en la obra 2666 de Roberto Bolaño (tésis), Nubia Becker Eguiluz La representación de la mujer emancipada, en la novela 2666 de Roberto Bolaño, Felipe Díaz Tejo
Sur Les Détectives sauvages
L'auberge espagnole de Roberto Bolaño (Eric Bonnargent sur L'Anagnoste)Sur Le Troisième Reich
Roberto Bolaño - Le troisième Reich - On ne badine pas avec la mort (Analyse magistrale d'Eric Bonnargent sur l'Anagnoste)Sur Le Secret du mal
Quelques fragments du texte et une analyse d'Eric Bonnargent (sur L'Anagnoste)Sur "Entre paranthèses"
Présentation du recueil d'articles et de discours de Roberto Bolaño par Alberto Bajarano (revue des Ressources)Pour citer cette ressource :
Christine Bini, 2666 de Roberto Bolaño, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2011. Consulté le 18/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/les-classiques-de-la-litterature-latino-americaine/six-pages-de-2666-la-pomme-et-le-taxi



 Activer le mode zen
Activer le mode zen