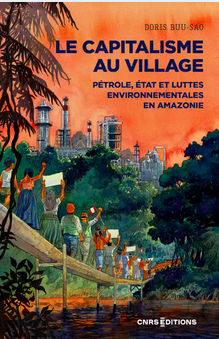«Le capitalisme au village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie» de Doris Buu-Sao (2023)
Lundi 24 mars 2025, le séminaire Re/Lire les Sciences sociales, organisé par le Département des Sciences Sociales de l'ENS de Lyon, a accueilli, à l'ENS de Lyon, Doris Buu-Sao, maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université de Lille pour échanger autour de son ouvrage Le Capitalisme au Village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie paru en 2023 aux éditions du CNRS.
La séance a été animée par Éléonore Broyer, Nathalie Thai, Clara Migozzi , élèves à l'ENS de Lyon et Véronique Gillier, Doctorante en histoire (Triangle UMR 5206) et Chargée de cours à l'ENS de Lyon.
La discussion a été menée par Jules Girardet, chargé de partenariat international avec la région méso-amérique pour l’association CCFD-Terre Solidaire.
Introduction de Doris Buu-Sao
|
Couverture du livre de Doris Buu-Sao, Le capitalisme au village.
CNRS Éditions, Paris, 2023.
|
En introduction de sa présentation, Doris Buu-Sao revient sur la couverture de son ouvrage, réalisée par le dessinateur Damien Cuvillier. On y voit des adultes et des enfants de dos qui avancent vers un site pétrolier qu’on devine à l’arrière-plan, habillés de vêtements à allure autochtone d’une part, d’uniformes des chantiers pétroliers d’autre part, brandissant des panneaux dont l’inscription demeure cachée au lecteur, mais aussi des drapeaux péruviens. On devine alors que les revendications – entre lutte environnementale et nationalisme de frontière – et les statuts mobilisés – autochtone d’une part et travailleur pétrolier de l’autre – sont multiples et que les relations à l’industrie pétrolière ne sont pas seulement marquées par la confrontation, la soumission et la dépossession, mais aussi par les relations de salariat et de cohabitation.
Elle précise ensuite que le terrain de son travail de recherche est celui du Loreto, la plus grande région amazonienne du Pérou, traversé par le fleuve Pastaza dont les rives sont habitées par la communauté native quechua d’Andoas, en contact direct avec un site pétrolier éponyme exploité par Pluspetrol. Pour commencer à peindre un portrait des relations autour de ce site, elle revient d’abord sur les deux figures légales complémentaires qui sous-tendent l’ensemble. Premièrement, le statut légal de communauté native confère à ses détenteurs un titre de propriété sur le sol du territoire désigné, mais non sur le sous-sol, ouvrant la voie à l’extraction par des entreprises privées. Deuxièmement, pour une communauté native, il est possible de fonder une entreprises communale, légalement prochs de la coopérative et exécutant des contrats rémunérés par Pluspetrol. Afin de comprendre comment le capitalisme extractif s'installe concrètement en Amazonie en se faisant une place dans les communautés, Doris Buu-Sao a mené une enquête multi-située pendant quinze mois, à la fois dans les villages au bord de la rivière et auprès de la Fédération quechua dont les leaders évoluent davantage en milieu urbain. Elle a alors observé qu’à Andoas, les logiques capitalistes s’installent certes par la force – juridique, armée et économique – mais que leur maintien repose aussi sur une appropriation par le bas, dont les travailleurs des entreprises communales sont le moteur central.
Présentation de l'ouvrage
La présentation s’est déclinée en quatre temps qui correspondent à la progression linéaire de l'ouvrage.
Détours méthodologiques
Avant de débuter la présentation des différentes parties de l’ouvrage, Doris Buu-Sao rappelle l’argument liant toutes les parties entre elles : son but était de montrer comment le capitalisme extractif se déploie en Amazonie péruvienne et se fait une place parmi les sociétés qui sont contraintes de s’en accommoder. Pour ce faire, l’autrice fait le choix de structurer sa recherche à partir de reconstructions de différents moments à la fois du quotidien et des mobilisations. À son arrivée sur le terrain en 2012, la Fédération quechua organisait sa première mobilisation pour dénoncer l’impact écologique de l’extraction pétrolière. Si Doris Buu-Sao a d’abord été associée à ces mobilisations – bien que de manière indirecte, dans son rôle d’assesseure de Fédération – elle a progressivement pris ses distances avec le monde contestataire afin de pouvoir dresser un tableau plus complet de l’environnement politique et social de ces mobilisations.
L’extractivisme ((La notion d’« extractivisme » désigne un mode de gouvernement de la nature qui accorde la priorité à l’extraction des ressources naturelles, mise au service de l’accumulation capitaliste mais aussi du « développement » des sociétés (Buu-Sao, 2020).)) pétrolier en Amazonie péruvienne : un outil de contrôle et de construction du territoire
Doris Buu-Sao explique que les premiers chapitres servent à montrer que sur le temps long, les fantasmes de l’exploration et de l’exploitation de l’Amazonie s’inscrivent dans des projets de contrôle du territoire et de domestication de populations présentées comme sauvages. Il s’agit alors d’appréhender l’extraction du pétrole au Pérou dans ce cadre colonial. Dans les années 1970, les débuts de la privatisation de l’exploitation pétrolière en Amazonie coïncident avec la création de la catégorie de « communauté native », un statut juridique qui reconnaît la propriété collective d’un territoire donné à un groupe de personnes considérées comme descendants de tribus précolombiennes de l’Amazonie. Cela initie un processus de sédentarisation de populations nomades qui s’installent à proximité des sites, y voyant un débouché pour leurs activités de chasse et d’agriculture : elles peuvent vendre leur surplus aux employés de la compagnie et ainsi gagner de leur argent et améliorer leurs conditions de vie. Cette cohabitation débouche sur une décennie de confrontation à partir du tournant du millénaire. Ces confrontations sont initiées par les mobilisations des communautés, au cœur desquelles on trouve la revendication de leur appartenance aux peuples d’Amazonie péruvienne. Après quatre décennies d’exploitation pétrolière, elles exigent réparation mais aussi considération de la part d’un État qui a trop souvent refusé de reconnaître leurs droits élémentaires au profit du développement de l’économie extractive. Doris Buu-Sao met alors en avant que, pour faire face aux conflits, Pluspetrol se dote de bureaux de relations communautaires et les entreprises communales prennent en charge un programme de restauration et de compensation des méfaits de l’exploitation, comme la pollution massive des sols et de l’eau. L’apaisement des relations avec les populations « indigènes » ((« Au Pérou, « indigène » est d'usage plus courant que ses synonymes « autochtone » « indien.ne », « natif.ve » ou « originaire » ; c'est aussi celui qui exprime le plus l'Histoire coloniale de la catégorie » (Buu-Sao, 2023, 12).)) passe alors par la construction d’infrastructures publiques, la prestation de services médicaux et principalement par l’accès à l’emploi.
Logiques des mobilisations indigènes et profils contestataires
Malgré ce contexte peu propice à la contestation par le bas, Doris Buu-Sao constate que les mobilisations autochtones se multiplient. Comment expliquer qu’il y ait malgré tout un engagement militant ? Pour répondre à cette question, elle retrace la trajectoire individuelle de la politisation des leaders indigènes et observe que certains profils sont plus disposés que d’autres à assumer cette posture de médiateur et de représentant auprès de l’administration péruvienne. Ainsi, parce qu’ils sont issus de ces communautés natives et qu’ils entretiennent des liens familiaux et amicaux avec leurs membres, les leaders quechua manifestent tous un fort attachement à celles-ci. De plus, ils poursuivent une carrière au cours de laquelle ils ont appris à interagir avec les ONGs, au sein des sociétés urbaines, et ainsi à relayer la parole des communautés indigènes. Un potentiel collectif de subversion émerge alors au moment où les « assesseurs » salariés de ces ONGs apportent des ressources matérielles et leur savoir-faire à la mobilisation, ce qui permet de la rendre compréhensible par les médias, l’opinion publique et les politiciens – une condition indispensable pour ouvrir le dialogue entre les populations indigènes et l’administration péruvienne.
Institutionnalisation et professionnalisation de la gestion des conflits
Ultérieurement, elle rappelle qu’en 2011, une loi — qui fait suite à une promesse de campagne présidentielle — marque la reconnaissance officielle du droit des peuples autochtones à être consultés avant toute décision administrative les concernant. Ce droit à la consultation préalable est mobilisé pour la première fois dans le contexte de l’expiration (en août 2025) de la concession pétrolière accordée à Pluspetrol sur le lot 1-AB. Perúpetro ((Perúpetro est une société de droit privé qui représente l’État péruvien. Elle est chargée de promouvoir, négocier, signer et superviser les contrats d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures au Pérou.)) est alors forcée de mettre en œuvre une consultation préalable des communautés natives en vue de la signature d’un contrat avec une nouvelle compagnie. Cette mesure est présentée avant tout comme un outil étatique pour établir un dialogue « maîtrisé ». Cette ambition se traduit par une scénarisation des échanges, au cours de laquelle les hauts fonctionnaires s’approprient les discours des organisations autochtones afin de renvoyer une image pacifiée du conflit. En réponse, les leaders autochtones développent leurs propres stratégies pour résister à cette volonté d’apaisement : ils essaient de dicter les règles du jeu en élevant la voix, en mobilisant les émotions et en perturbant le déroulement prévu. Les institutions sont néanmoins parvenues à imposer leur rythme et leur géographie au déroulement du conflit : les rencontres se tiennent en milieu urbain, selon un agenda administratif, contraignant les représentants autochtones à s’adapter à ce nouvel ordre de la contestation.
Recontextualiser les logiques de l’engagement depuis la base
La présentation de l’ouvrage se clôt par ce dernier point. La base peut être définie par la population autochtone dont l’engagement ne se traduit pas par une action associative ou institutionnelle. Doris Buu-Sao revient sur les manières dont les mobilisations peuvent transformer les modalités de leur insertion dans les dynamiques extractivistes. Pour en comprendre les ressorts, elle a complété l’observation de terrain par une analyse généalogique, visant à situer les acteurs dans des lignées familiales et matrimoniales différenciées. Certaines d’entre elles se distinguent par leurs affiliations religieuses — notamment à l’évangélisme nord-américain — qui tend à rapprocher ces groupes de la Fédération quechua tout en les éloignant des entreprises communautaires, ainsi que par leurs modes d’engagement politique. Par la suite, Doris Buu-Sao insiste sur le fait que l’ancrage territorial joue également un rôle structurant : l’amont du fleuve, zone directement affectée par l’extraction, contraste avec l’aval, berceau historique de la Fédération quechua d’où émergent la majorité des leaders autochtones. La question se pose alors de comprendre ce qui motive les mobilisations en amont. Les entreprises communautaires y exercent une influence notable sur l’organisation économique et sociale du village, notamment à travers une division sexuée du travail. Leur rôle politique s’affirme lors des épisodes de pollution, en particulier lors des déversements de pétrole, à l’occasion desquels elles peuvent être sollicitées pour collecter les preuves de contamination. En effet, à partir de 2012, l’État impose à Pluspetrol de prendre en charge la restauration des zones affectées, conférant aux entreprises communautaires un rôle clé dans la remédiation environnementale tout en générant des opportunités économiques par la création d’emplois locaux. Ainsi l’autrice déclare que, loin de constituer une opposition binaire à l’extractivisme, ces engagements témoignent de formes d’adaptation, de négociation, de contestation mais aussi parfois de dépendance vis-à-vis des dispositifs étatiques et industriels.
Discussion
Jules Girardet a ensuite proposé une discussion de l’intervention de Doris Buu-Sao. Membre de l’Organisation non-gouvernementale CCFD Terre solidaire, il travaille en Amazonie depuis plus d’une quinzaine d’années avec une association qu’il présente comme ayant pour but d’accompagner les organisations locales et les habitants et les habitantes dans leur(s) lutte(s), le tout en quittant le tropisme exotique occidental. L’ONG suit deux axes d’intervention, d’une part la lutte contre la prédation des ressources naturelles essentielles à l’économie, et le soutien à la construction d’un bien vivre (pan-) amazonien d’autre part.
La discussion de Jules Girardet s’organise autour de la reprise de quatre grands points abordés par Doris Buu-Sao. Il commence par revenir sur l’étude du rôle des ONG dans l’ouvrage, et notamment sur la professionnalisation du travail militant dans le cadre des mouvements indigènes, mouvements qui reposent par ailleurs sur un fort prisme identitaire. De fait, il explique que certaines ONG peuvent parfois adopter un comportement paternaliste, et que l’une des réflexions majeures de CCFD Terre solidaire se structure autour de l’accompagnement de ces mouvements alors même que les acteurs associatifs proviennent de sociétés occidentales, capitalistes et marchandes.
Jules Girardet évoque ensuite la question des identités plurielles observables sur le terrain : il analyse entre autres le fait que l’identité (de « natif », « autochtone », ou « indigène ») est aujourd’hui devenue un véritable levier de revendication politique vis-à-vis des institutions et de la « colonialité » des administrations, de l’État, et plus largement des structures politiques locales et internationales.
La troisième grande idée sur laquelle revient Jules Girardet est celle du « capitalisme par appropriation ». Pour rappel, ce concept central dans l’ouvrage de Doris Buu-Sao désigne l’appropriation des ressources – minières, hydriques, boisées – par les entreprises extractivistes, mais aussi l’intériorisation des logiques de marché par les populations autochtones, qui se manifeste à travers les entreprises communales. Cette notion de « capitalisme par appropriation » s’appuie sur ce que Jules Girardet nomme « l’idéal de la nouvelle frontière », qui correspond au nouveau paradigme agro-industriel de déforestation et de privatisation des terres par les entreprises afin d’étendre ce modèle capitaliste d’exploitation des terres, et ce généralement dans un but d’exporter la ressource. Cet idéal entraînerait une paupérisation des populations natives – par ailleurs considérées comme improductives –, ainsi qu’une destruction programmée de ce qui est pensé comme étant l’El Dorado inépuisable de l’Amazonie. Ce double imaginaire sert une justification de l’exploitation des ressources et d’une appropriation violente de celles-ci par les entreprises capitalistes. Jules Girardet explique que ces dynamiques sont communes aux différentes industries, qui entraînent ainsi une marchandisation des ressources tout comme des espaces, et instaurent une logique de domination des populations une fois que les codes marchands des entreprises ont été acceptés localement. Le défi majeur pour les ONG est alors d’instaurer un rapport de force équilibré entre les acteurs en présence.
Enfin, Jules Girardet s’interroge sur la place des églises néo-pentecôtistes dans l’intériorisation des logiques capitalistes et de marché. Selon lui, la multiplication des églises en Amazonie brésilienne fait des institutions religieuses de nouveaux accompagnateurs qui proposent un nouveau discours sur l’individu et le collectif, l’identité indigène et les ressources naturelles, sur le rapport du spirituel au divin. Jules Girardet s’adresse alors directement à Doris Buu-Sao et lui demande si elle a pu observer un changement de discours et de posture chez les personnes nouvellement converties au Pérou. À cette question, la chercheuse répond que cette multiplication n’est que très peu présente en Amazonie péruvienne, puisque la mission d’évangélisation s’est faite plus tôt, dans les années 1960-1970, grâce au Summer Institute of Linguistics, une organisation missionnaire évangélique nord-américaine qui s’est spécialisée dans la traduction de la Bible en langues indigènes. De fait, au Pérou, une proximité géographique et sociale s’est d’office installée entre les fondateurs des communautés natives – et plus tard de la Fondation quechua – et les évangélistes missionnaires nord-américains, qui ont servi d’intermédiaires avec les sociétés occidentales et urbaines. Toutefois, elle souligne avoir entendu lors d’entretiens que certaines personnes avaient, après conversion, assimilé la foi religieuse et la conversion à l’écologie, et avaient ainsi pris conscience de l’impact écologique de l’extraction pétrolière tout en mobilisant leurs croyances dans la lutte pour leur peuple et leurs enfants.
Échange avec le public
La recherche action participative émerge en Amérique latine dans les années 1960-1970, qu’est-ce que ce concept signifie pour vous ? Est-il pertinent dans le cadre de votre travail ?
Doris Buu-Sao affirme ne pas se revendiquer d’une recherche action participative, tout en soulignant que la démarche ethnographique qu’elle mène implique naturellement la participation des populations locales. La dimension de recherche action participative s’est présentée sur le terrain via les assesseurs d’ONG, qui, pour certains, avaient commencé des études de doctorat, et, dans ce cadre, s’interrogeaient sur la co-production du savoir et de la connaissance avec les populations autochtones. Pour Doris Buu-Sao, la recherche action des assesseurs devient un objet d’analyse : comment celle-ci contribue-t-elle aux logiques des mobilisations ? Doris Buu-Sao revient également sur les difficultés qu'implique une telle démarche : s’engager aux côtés des associations et de la Fédération quechua en tant qu’assesseure elle-même lui aurait fermé une partie centrale du terrain, celle des entreprises communales, et du rapport à l’emploi sur le site pétrolier, pourtant constitutif de l’expérience quotidienne des populations locales. Elle travaille actuellement à la traduction du livre en espagnol et espère pouvoir le présenter au Pérou et dans les communautés où elle a séjourné. Jules Girardet souligne l’enjeu de la vulgarisation des savoirs ainsi produits, notamment des moyens de les rendre accessibles aux populations concernées.
Quels sont les positionnements des populations autochtones sur la transition écologique ? Y-a-t-il un positionnement particulier de la jeunesse vis-à-vis de ces questions ?
Doris Buu-Sao explique qu’à l’échelle des politiques péruviennes, la transition énergétique est loin d’être une priorité. Un décret a été adopté récemment statuant que l’exploitation pétrolière est une nécessité publique, ce décret permettant de justifier l’exploitation croissante des gisements. Doris Buu-Sao soulève une interrogation sur les formes que prend actuellement le redéploiement industriel lié à la transition énergétique (mines de lithium et de terres rares, champs photovoltaïques dans d’autres parties du monde…). Elle fait l’hypothèse que ces redéploiements industriels modifieront les équilibres des écosystèmes, ainsi que l’occupation du territoire par les populations amazoniennes. En ce qui concerne la jeunesse, Doris Buu-Sao souligne le caractère de construction sociale de ce terme, qui désigne des réalités diverses. Ce terme a évolué à mesure que les familles autochtones aspirent à faire étudier leurs enfants à l’université. Ces étudiants développent avec leurs études une perspective différente, qui n’est pas forcément celle de la contestation radicale. Ces jeunes sont souvent les intermédiaires et les porteurs des projets d’entreprises communales. Le changement générationnel se traduit par une socialisation à l’économie marchande moins heurtée que dans le cas des aînés. Les leaders les plus contestataires ne sont pas forcément les plus jeunes. Pour Jules Girardet, c’est justement un des enjeux des organisations contestataires que d’arriver à intéresser la jeunesse indigène pour se renouveler.
Comment se construit la carrière des leaders autochtones, quelle est leur trajectoire de mobilisation ?
Doris Buu-Sao souligne qu’il est possible de parler de carrière militante. Elle prend l’exemple d’Andrés, président de la Fédération. Son action militante est sa principale activité économique. Son récit de vie est intimement lié à son action militante : sans véritable cadre familial, ce dernier se met à travailler très tôt pour un marchand qui sillonne le fleuve Pastaza de village en village. Le fait d’avoir fondé sa famille à Andoas, et non en ville comme il aurait pu le faire, est également un facteur important qui lui a permis de conserver un ancrage fort dans la communauté. Il se construit dans ce contexte, pourtant déconnecté du cadre contestataire, une réputation ensuite mise au service de son action à la Fédération quechua. Jules Girardet souligne également que le rôle d’intermédiaire des professeurs dans les communautés indigènes et leur plurilinguisme les dispose à une carrière militante. De même, les programmes « d’empowerment » menés dans certaines communautés locales permettent dans certains cas à leurs bénéficiaires de s’engager dans le militantisme, par exemple en tant que représentants de leurs communautés dans une ONG.
Quelle est la place des puissances étrangères dans l’exploitation pétrolière ?
La dimension géopolitique du terrain s’exprime surtout, explique Doris Buu-Sao, dans l’aide au développement et dans l’influence qu’ont les bailleurs de fonds internationaux sur la politique péruvienne. La Banque Mondiale et ses prêts conditionnés ont également joué un rôle structurant dans la façon dont l’économie extractive s’est développée au Pérou (libéralisation des marchés). De même l’Agence de développement nord-américaine a joué un rôle majeur dans la politique de prévention des conflits liés à l’extractivisme, via des programmes de formation des fonctionnaires péruviens. Ces conflits jouent sur la sécurité des investissements nord-américains. Ce sont surtout les investisseurs canadiens, australiens et chinois qui sont présents. L’absence d’impôts dans ce contexte favorise les mécanismes de clientélisme politique des autorités locales.
Quel est usage de la cartographie dans votre travail ?
À l’époque coloniale, un enjeu majeur fut de cartographier l’Amazonie, l’emplacement des ressources naturelles, des groupes de peuplement, afin de mieux les gouverner. La carte est aussi un enjeu de dispute au moment des négociations : la consultation n’est mise en place que dans l’aire d’influence directe des sites pétroliers, donc pour les communautés natives les plus proches. La cartographie de ces aires d’influence est donc un enjeu. Doris Buu-Sao affirme que son usage de la carte est surtout pédagogique. La cartographie participative mise en place par certains assesseurs des ONG est une forme de recherche action participative. Pour Jules Girardet, la carte est un instrument d’éducation populaire, qui permet de partir des savoirs natifs afin de répondre aux problématiques locales.
Quelle est l’actualité de la lutte ?
Doris Buu-Sao explique avoir récemment reçu des nouvelles d’Andrés : la mobilisation continue, malgré l’arrêt de l’extraction pétrolière pendant plusieurs années. Depuis que l’extraction a repris, la mobilisation récente est celle des entreprises communales, qui revendiquent d’être payées par la compagnie australienne qui gère le lot. Andrés s’est retrouvé à jouer un rôle similaire à celui d’un syndicat, en servant d’intermédiaire dans les relations de travail entre la communauté native et l’entreprise pétrolière.
Conclusion
Lors de cette conférence organisée dans le cadre du séminaire Re/Lire les sciences sociales, l’intervention de Doris Buu-Sao autour de son ouvrage Le Capitalisme au Village. Pétrole, État et lutte environnementale en Amazonie péruvienne a été l’occasion d’étudier les différents enjeux sociaux, politiques, ou encore environnementaux qui sous-tendent l’extraction pétrolière dans la région d’Andoas. Les deux présentations de Doris Buu-Sao et de Jules Girardet ont été très enrichissantes, puisqu’elles ont permis d’exposer au public – comme à nous – les grandes problématiques de l’ouvrage et leur traitement, mais aussi d’étudier celles-ci au regard du contexte plus global de l’exploitation des ressources en Amérique du Sud.
Notes
Bibliographie indicative
Ouvrages de Doris Buu-Sao
Buu-Sao, Doris. 2023. Le capitalisme au village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie. Paris : CNRS, séries : « Logiques du désordre », 319 p.
Buu-Sao, Doris. 2020. “Face au racisme environnemental Extractivisme et mobilisations indigènes en Amazonie péruvienne” in Politix, 131(3), 129-152.
Buu-Sao, Doris. 2019. « Prendre le parti de l’enquête. Positionnements ethnographiques en terrain conflictuel » in Genèses, n° 115.
Buu-Sao, Doris. 2015. « Devenir indien en milieu urbain. Les engagements d’une jeunesse amazonienne au prisme de son ancrage spatial », dans H. Combes, D. Garibay et C. Goirand (Dir.), Les lieux de la colère. Occuper l'espace pour contester, de Madrid à Sanaa, 143–167. Paris et Aix-en Provence : Éditions Karthala et Sciences Po Aix, coll. « Questions Transnationales ».
Ouvrages complémentaires
Astudillo Pizarro, Francisco et Salamanca Villamizar, Carlos. 2018. « Justice environnementale, méthodologies participatives et extractivisme en Amérique latine » (trad. A. G. Castro), dans Justice spatiale / Spatial Justice, n°12, juillet.
CCFD-Terre Solidaire. Site internet de l’Organisation non-gouvernementale : https://ccfd-terresolidaire.org/
Harvey, David. 2003. « The New Imperialism », Clarendon Lectures in Geography and Environmental Studies. Oxford : Oxford University Press.
Pour citer cette ressource :
Éléonore Broyer, Clara Migozzi, Nathalie Thai, Le capitalisme au village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie de Doris Buu-Sao (2023), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2025. Consulté le 21/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/perou/le-capitalisme-au-village



 Activer le mode zen
Activer le mode zen