Écrire l’effacement : Elena Ferrante et la construction d’un dire par soustraction
1. Effacée et toutefois présente
L’aventure d’Elena Ferrante commence avec la publication de L’amore molesto en 1992. Son entrée dans le monde littéraire coïncide avec un projet précis : s’effacer de la scène publique pour n’exister que dans la littérature. La publication de son premier roman s’accompagne, en effet, d’une lettre adressée à ses éditeurs (2016, 11-12). Aujourd’hui, à presque trente ans de distance, nous pouvons lire ce texte comme le véritable manifeste d’une auteure qui interprète la parole littéraire comme une possibilité d’existence. Il s’agit d’une déclaration d’intention où l’écrivaine trace le périmètre dans lequel elle choisit d’intervenir. C’est dans ce texte qu’elle annonce le choix de son pseudonyme – hommage, selon l’opinion de certains critiques, à Elsa Morante – qui traduit, en réalité, un souvenir de son arrière-grand-mère (Ferrante, 2016, 201). Elle précise sa volonté de ne pas participer aux prix littéraires et souligne son refus face à la possibilité d’apparaître sur la scène publique :
« Non parteciperò a dibattiti e convegni, se mi inviteranno. Non andrò a ritirare premi, se me ne vorranno dare. Non promuoverò il libro mai, soprattutto in televisione, né in Italia, né eventualemente all’estero. Interverrò solo attraverso la scrittura ». (2016, 11).

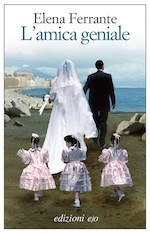
Cette lettre qui date du 21 septembre 1991 met en lumière combien la notion d’effacement ne peut être séparée de la personnalité littéraire de Ferrante. Toutefois, dans la perspective de l’auteure, la rature peut déborder de sa personne en arrivant à affecter l’idée même d’écriture. On écrit pour rester, pour laisser une trace et, si l’on n’écrit pas, on va disparaitre. Deux forces vont donc s’opposer. L’acte de résister au gommage passe par la tentation de laisser sa propre empreinte en s’accrochant à la parole. Une parole publiée et donc publique : accessible à tous. Cependant, ce geste de permanence s’oppose au choix de l’inexistence, au désir de la dissipation. Ferrante, dans sa construction d’écrivaine sans visage, traduit la volonté de « cancellare le tracce » (2011, 13). Elle adopte la posture de Lila, le personnage-ombre de L’amica geniale. Dans sa volonté de ne pas apparaître, elle laisse émerger un désir ambivalent, qui rime avec une forme d’anéantissement.
C’est dans ce contexte qu’il serait intéressant de se demander dans quelle mesure la notion d’effacement s’insinue dans l’œuvre de Ferrante et, plus particulièrement, dans son écriture. Pour le dire autrement : est-il possible d’« écrire l’effacement » en transformant un acte délibéré – celui de la disparition – en une forme, paradoxale, de survie littéraire ? Dans notre analyse nous chercherons à montrer comment l’auteure, en suivant l’enseignement d’Adriana Cavarero, semble construire, dans ses textes, une sorte de « soi narrable » (Cavarero, 2011, 48). En effet, pour la philosophe de la différence, l’identité de chaque individu peut, en réalité, être considérée comme une identité poreuse – narrable, justement – prête à être racontée. Dans son acception, A. Cavarero illustre comment ce récit potentiel reste, toutefois, caché aux sujets qui en sont porteurs. Il ne peut être révélé qu’à travers la narration d’un deuxième individu susceptible de faire émerger la vérité du premier. Plus particulièrement, la spécificité de cette narration-partagée consiste dans le fait que ce « soi narrable » – ce sujet, donc, prêt à être raconté – n’est pas le produit d’une vision nombriliste. Nous ne faisons pas référence, ici, à une auto-narration. À l’inverse, nous sommes plutôt confrontés à une identité relationnelle qui met en contact deux individus distincts : celui qui est porteur d’une histoire et celui qui est prêt à la raconter. La narration qui en résulte est, donc, doublement performative. D’un côté elle permet au sujet-narré de se percevoir, de se comprendre à travers une lecture extérieure. De l’autre, elle donne la possibilité à ce sujet-narrant d’accéder à une vérité sur sa propre personne qui ne peut émerger qu’en racontant les vicissitudes de quelqu’un d’autre. En ce qui nous concerne nous essayerons de développer ce concept pour montrer comment Ferrante arrive à structurer sa narration à travers la construction d’une identité (féminine) susceptible d’être dite – et donc racontée – justement à travers le paradoxe de sa propre soustraction.
2. Lila : un troisième livre pour raconter l’absence
Un dialogue, à la fin de L’Amica geniale, semble, plus que d’autres, illustrer le propos de Ferrante. Il s’agit d’une conversation entre Lila, l’amie disparue – l’amie narrée – et Lenù : la narratrice. C’est d’ailleurs l’un des rares passages où Lila s’exprime à la première personne concernant sa volonté de ne pas écrire. Lenù, le je narratif de L’amica geniale, sa meilleure amie, a pu sortir du rione, a pu construire sa vie, sa carrière d’écrivaine. Elle a étudié à la Normale di Pisa, elle a publié des livres, elle a eu du succès. Pourtant, elle reste touchée, angoissée même, par le talent de Lila, par ses capacités inexprimées. Elle a peur que son amie puisse publier un livre, ou simplement l’écrire. Car elle est certaine que cette parole inexprimée, cette voix étouffée par la rage, la rancune, la douleur, pourrait devancer son propre travail, en l’effaçant complétement. Elle souhaite une publication de Lila, car, en tant que lectrice – et, à la fin de sa carrière, en tant qu’éditrice – elle est curieuse. Mais, parallèlement, elle craint ce livre mystérieux, transparent, un livre inexistant qui perdure, dans sa tête, comme une obsession.
Les mots de Lila semblent toutefois contredire son angoisse : elle ne souhaite pas participer activement à la mise en mots de son existence. Elle préfère s’absenter, se faire néant :
« Per scrivere bisogna desiderare che qualcosa ti sopravviva. Io invece non ho nemmeno voglia di vivere, non ce l’ho mai avuta forte come ce l’hai tu. Se potessi cancellarmi adesso, proprio mentre ci parliamo, sarei più che contenta. Figuriamoci se mi metto a scrivere […] di me non voglio lasciare niente, il tasto che preferisco è quello che serve a cancellare ». (2014, 433).
Dans ce contexte nous observons comment l’acte d’écrire correspond, pour Lila, à une manière d’exister, de durer. La page blanche possède la capacité de créer un cosmos, un univers structuré dans lequel il est possible de se définir. D’une manière analogue, écrire pour laisser une trace signifie produire un surplus d’existence. Lila, qui ne s’aime pas, Lila, fragilisée par une existence hostile, pétrie de souffrance, semble éloigner d’elle toute possibilité de multiplication de sa subjectivité imparfaite – souffrante – en quelque sorte raturée. Car ce livre potentiel qu’elle n’a jamais été écrit pourrait représenter, pour Lenù, une possibilité d’existence, une manière de restituer un minimum de structure à la personnalité en lambeaux de son amie. Pour reprendre une expression de Carlo Sini, la page d’écriture peut devenir métaphore d’un véritable « foglio-mondo » (1993) qui illustre une possibilité de subjectivation à travers la parole.
Lila, qui réfléchit sur le désir de ne pas exister et qui, parallèlement, s’interroge sur la survivance de l’écriture – et, donc de la littérature – semble incarner la structure poreuse, ambivalente, d’un récit. Elle laisse présager, dans sa corporéité démargée – « smarginata » – ce que Ferrante identifie à travers la métaphore d’un troisième livre – « un terzo libro » – invisible, inclassable, que personne n’a jamais vu, ni lu. Il s’agit d’un « libro di nessuno » (2016, 185) un volume qui n’est pas en vente dans les librairies, ni à disposition des bibliothèques. C’est un texte qui garde, dans sa structure incertaine, toutes les phrases, tous les mots, qui n’ont pas été écrits par l’auteur. Des phrases imaginées, potentielles – parfois ratées – constituant la membrane transparente qui se situe au croisement entre la pensée et la page. Il s’agit d’une série d’idées restées emprisonnées dans la plume de l’écrivain, des visions qui n’ont pas trouvé de place dans le texte publié. Ce livre contient aussi, dans sa structure indéterminée, le travail involontaire qui est mené par chaque lecteur. Il est dépositaire de toutes les réflexions, les images, les souvenirs suscités par la lecture et qui contribuent à faire de ce livre impalpable un livre qui est, finalement, tangible : existant. Malgré sa structure énigmatique : « c’è. È il libro che si fa nel rapporto tra vita, scrittura e lettura ». (2016, 185).
En parallèle, nous observons comment la notion d’effacement semble être, dans l’univers de Ferrante, profondément liée à l’idée de création. Si Lenù est obsédée par le livre potentiel de Lila c’est parce qu’elle craint qu’une publication de son amie puisse effacer son œuvre, en dévoilant aux lecteurs son rôle d’imposteur. Face au talent inexprimé de son amie, elle redoute d’être qualifiée de subalterne, d’éternelle seconde, d’incompétente :
« Nei momenti di maggior cupezza ero sempre più sicura che Lila avesse scritto la storia dettagliata di sua figlia, ero sicura che l’avesse mescolata a quella di Napoli con l’ingenuità proterva della persona incolta che però, forse proprio per questo, finiva per ottenere risultati prodigiosi.» (2014, p. 440).
Pour Lenù la disparition n’est qu’une énième trouvaille de son amie. Un projet esthétique banal : un moyen théâtral pour mettre en scène sa propre rature. Pour Lila, en revanche, disparaître semble être un acte chargé de sens – synonyme de création – qui garde, dans sa concrétisation, le spectre d’un désespoir impénétrable. Il coïncide avec le geste ultime d’une femme qui interprète la dissipation – sa propre rature – comme la seule possibilité pour arriver à exprimer une souffrance sans nom, sans image, frôlant les limites de l’indicible. C’est ainsi que les livres publiés par Lenù – trace évidente de sa permanence sur terre – perdent de leur force face à ce supposé projet esthétique. Ils révèlent leur caractère lacunaire, fallacieux, souvent artificiel. À l’inverse, le livre de Lila – ce texte potentiel, absent – perdure comme une sorte de monito – mieux : un modèle – apte à mettre en lumière les fragilités d’une écriture, celle de la narratrice, qui n’a pas atteint son objectif. La carrière d’écrivaine de Lenù s’écoule, donc, face à Lila : devant sa manière de créer l’absence, et, à travers cette même absence, devant sa capacité d’expression qui coïncide avec la tentative de raconter une vérité qui ne peut être traduite dans la page.
Comme nous avons vu, le geste de Lila se structure autour d’un manque d’amour propre ; il est alimenté par une forme de tristesse, par une souffrance qui ne peut trouver d’apaisement. Toutefois, son regard sur les choses, sa capacité à percer le mur du réel pour entrevoir une réalité autre – parellèle, sghemba – traduit, en vérité, une forme de conscience que Lenù ne possède pas. Son écriture n’est pas – comme le souhaitait Ferrante dans ses réflexions – une façon de raconter la réalité du monde, ni une manière de resituer à l’écrit – à travers « scrittura anomala, una scrittura a gorgo » – ce que l’écrivaine définit comme « difficile da dire » (2016, 315). Lenù, dans ses pages, dans sa tétralogie, n’a pas atteint cet objectif. Nous faisons face, ici, à une forme d’auto-conscience : une forme malheureuse d’autocritique où l’écrivaine – Ferrante ou Lenù, peu importe – perçoit sa propre page comme insuffisante : fausse. La vérité n’a pas été racontée, cette même vérité qui, à l’inverse, perdure dans le regard et dans le livre transparent de Lila : un livre, qui, toutefois, n’existe pas.
Mais alors, qu’est-ce que cette capacité, cette faculté à percevoir le réel, cette manière de voir la vérité ? Comment se manifeste-elle ? Comment se reproduit-elle ? La smarginatura, que nous pouvons tenter de traduire en français à travers néologisme « la démargeur » – (dé privatif – marge – et le suffixe -eur, qui vient du latin -orem, et qui indique des noms abstraits de genre féminin), n’est pas dissociable du personnage de Lila. Cette dernière comprend la smarginatura comme un phénomène qui provoque une perte des marges, une perte des limites, en lui permettant, à travers la fracture, de saisir le réel grâce à une vision liminaire – autre – sur les choses.
Ce phénomène obsède Lila depuis son enfance, à une époque où elle avait déjà ressenti « la sensazione […] di trasferirsi […] in una persona o una cosa o un numero o una sillaba » (2011, 86-87). Mais, même pendant l’âge adulte, le personnage semble hanté par les dérives de cette capacité de vision. Les épisodes liés à la nuit du 31 décembre 1958 illustrent une vérité dérangeante concernant le frère de Lila, Rino : « le scie dei razzi struscia[vano] su mio fratello Rino come lime, come raspe, e gli spacca[vano] la carne, […] face[vano] sgocciolare fuori da lui un altro mio fratello disgustoso » (2014, 163). Ensuite, le viol qu’elle subit pendant sa première nuit de noce lui permet de comprendre le vrai visage de son mari Stefano : « Don Achille stava risorgendo dalla melma del rione nutrendosi della materia viva di suo figlio. Il padre gli stava crepando la pelle, ne stava modificando lo sguardo, gli stava esplodendo dal corpo » (2012, 41). Enfin, le tremblement de terre de Naples du 23 novembre 1980 représente l’acmé d’une smarginatura qui touche objets, individus, mais surtout Lila elle-même :
« Borbottò che non doveva mai distrarsi, se si distraeva le cose vere, che con le loro contorsioni violente, dolorose, la terrorizzavano, prendevano il sopravvento su quelle finte […] e lei sprofondava in una realtà pasticciata, collacea, senza riuscire più a dare contorni nitidi alle sensazioni. Un’emozione tattile si scioglieva in vista, una visiva si scioglieva in olfattiva, ah che cos’è il mondo vero, Lenù, l’abbiamo visto adesso, niente niente niente di cui si possa dire definitivamente: è così. Per cui se lei non stava attenta, se non badava ai margini, tutto se ne andava in grumi sanguigni di mestruo, in polipi sarcomatosi, in pezzi di fibbra giallastra ». (2014,162).
La démargeur fonctionne donc comme un angle d’observation privilégié : une sorte de limen, un entre-deux, permettant au sujet de lire le monde à travers sa propre fracture. Lila, dans sa structure de personnage fortement allégorique – mi-femme, mi-récit – semble d’ailleurs reproduire, dans son hétérogénéité, la même capacité de perception du je poétique décrit dans plusieurs poèmes de E. Montale. En effet, sa césure semble calquer certains motifs de la voix poétique qui s’exprime dans Forse un mattino andando (Montale, [1925], 2006, 42). Il s’agit d’un sujet qui parvient, par hasard, un matin, pendant une promenade, à percevoir la tromperie quotidienne mise en place par le monde. Il s’agit d’un « inganno consueto » (42) de la terre qui se préoccupe de monter une sorte de scène en carton – « cipria [sullo] spavento » (2012, 323), dirait Ferrante – pour couvrir la réalité, pour offusquer l’horreur de vivre. Cette possibilité de vision – et donc de connaissance – passe par des chemins désuets, souvent étroits. Toucher la vérité de l’être humain semble d’être une prérogative de ces sujets brisés qui, dans leur individualité broyée, dans leur étrangeté, n’ont qu’une seule possibilité de survie : celle de la compréhension.
Cette authenticité se manifeste à travers des brèches – des intuitions – qui permettent d’accéder à un surplus d’existence. La violence de cette révélation est accompagnée d’une force excédante – « eccessiva » (Ferrante, 2012, 295) – démontant les constructions artificielles que les individus bâtissent pour chercher à surmonter l’horreur de vivre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce motif, typiquement novecentesco, revient sans cesse dans toute la poésie d’E. Montale. Dans I limoni les choses « s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo segreto, / talora ci si aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene » (Montale, [1925], 2006,12). Comme dans le cas de Lila, il existe toujours un élément, capable de dégonder le réel, d’afficher un quid de vérité, d'en révéler un pan normalement caché aux individus. Ferrante semble appeler cette conscience smarginatura. En effet, au-delà de son caractère négatif – brutal – c’est justement à travers cette « maglia rotta nella rete » (Montale, [1925], 2006, 12) que le sujet accède à une forme de connaissance sur soi et sur autrui.
3. Écrire l’indicible
La notion d’effacement qui entoure tantôt les personnages de Ferrante, tantôt l’écrivaine elle-même peut, en quelque sorte, nous permettre d’élargir notre champ d’analyse en orientant ce même concept vers un terrain plus général. En particulier, il nous semble intéressant d’analyser comment cette même idée pourrait amener à une réflexion sur l'avenir de la littérature contemporaine italienne. Giorgio Ficara, dans un essai récent – Lettere non italiane (2016) – s’interroge, justement, sur la survivance de la littérature italienne interprétée comme un pivot identitaire susceptible de forger notre conscience de citoyens et d’individus. Notre subjectivité et notre façon de penser ne peuvent pas être séparées des textes, des écrits, des poèmes qui sont à la base de notre éducation intellectuelle (Ficara, 2007, 239). Comment reconnaître, alors, la valeur d’une œuvre contemporaine quand nous faisons face à une littérature interrompue, qui s’inscrit dans le régime de la discontinuité formelle entre les auteurs de la tradition, « i moderni » – G. Ficara les identifie comme les « continui » – et ceux qui font partie de notre époque contemporaine, les « discontinui », ceux qui incarnent la césure (2016, 5) ? Comment reconnaître, donc, la valeur d’une œuvre qui ne soit pas, pour le dire avec G. Ferroni, un produit de la société de communication (2005, 68) ? Comment distinguer la bonne littérature d’une œuvre banale, écrite avec une langue adaptée à la traduction ? Nous faisons référence, dans ce contexte, à une œuvre qui, au lieu d’apporter une fracture et, à travers elle, un surplus de vision, ne contribue qu’à nourrir notre capitalisme littéraire. Mais, au delà de cela : cette fracture, cette œuvre possible, comment se configure-t-elle ? Car, en écoutant G. Ficara, A. Berardinelli et les autres critiques contemporaines, il est légitime de se demander si nous ne sommes pas – finalement – condamnés au spectre de l’« illisibilité » barthienne, unique arme contre la valeur négative du lisible (Barthes, [1994], 2000, 44-45). Pour résumer : quel est le destin de notre littérature ? Car, en fin de compte, nous sommes conscients que la littérature italienne est souvent interprétée comme épigonale, périphérique, condamnée à répéter ce qui a déjà été dit. Dans le pire des cas, on entend même parler d’une littérature de l’absence, garante d’un style neutre, d’un style que nous pouvons définir – d’une manière provocatrice – comme effacé (Di Paolo, 2018).
Dans ce contexte la figure de Ferrante est controversée. Car d’un côté, nous ne pouvons pas nier l’ampleur d’un succès qui affiche un bilan de dix millions de livres vendus dans le monde. Toutefois, ces chiffres, ses traductions en cinquante-cinq langues différentes, ces affiches et les articles dans les journaux, contrastent avec sa figure, avec sa résistance programmée aux mécanismes de l’industrie du livre. L’écrivaine, dans sa volonté de ne pas participer au panorama des auteurs vedettes, dans sa volonté de marquer une distance avec l’horizons des plateaux télévisés, semble réfléchir, à l’instar d’un critique littéraire, à des nouvelles formes de survie littéraire : à la possibilité de créer une œuvre qui ne soit capable d’émerger, dans le « mare magnum » contemporain (Ferroni, 2005, 92), qu’ à travers la force de sa parole. Une œuvre, qui puisse exister, circuler, justement grâce à la disparition de son auteur.
« Écrire l’effacement » signifie donc d’adopter une posture précise qui touche tant la figure de l’auteur – effacé et toutefois présent – que son style. L’effacement concerne Ferrante, sa manière de comprendre son métier, mais il touche, aussi, ses thématiques, ses personnages, la recherche littéraire qu’elle mène depuis presque trente ans. C’est dans cette optique qu’il nous semble intéressant de réfléchir à son écriture en cherchant à la lire à la lumière des théories féministes proposées par Hélène Cixous. Le contexte semble propice pour tenter de lire le style de Ferrante à travers le prisme de ce qui a été défini comme une écriture féminine dans le sens politique du terme. Nous ne faisons pas référence, ici, à une écriture-femme (Didier, 1981) ni à la volonté d’étudier des textes pour y trouver des spécificités, des échos, des proximités thématiques et littéraires à travers le prisme de la biologie. Il ne s’agit pas d’une écriture au sens genré du terme. Nous faisons plutôt référence, ici, à une écriture qui, selon l’optique de H. Cixous se produit grâce à une « encre blanche » ([1975], 2010, 48), qui ne se soucie pas du sexe de l’auteur, mais qui s’interroge sur une posture littéraire précise, sur la volonté de donner voix à l’inexprimable. Une écriture capable de contenir, dans sa propre structure lexicale, dans son rythme, dans ses silences, dans ses réticences, le corps même des femmes. H. Cixous cherche, en effet, à définir une écriture qui se fait corps : elle incite les femmes à s’écrire, à se faire matière littéraire, à s’incarner dans la parole. L’écrivain doit donc, dans ce contexte, songer à corporaliser la page en la transformant en tissu de sa propre histoire, de sa propre pensée, de ses non-dits. Il s’agit d’une écriture qui est souvent subversive, capable de rompre les schémas classiques, d’apporter une différence. Une écriture interprétée, donc, au sens féministe du terme. Il ne s’agit pas d’une écriture du neutre, mais plutôt d’une écriture qui contient, dans sa polysémie, une cacophonie des voix et des différences. Comment la classer ? Comment la définir ? On ne peut pas. Il s’agit d’une opération qui n’est même pas envisageable. Pour H. Cixous : « on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l’enfermer, la coder » ([1975], 2000, 50) mais cela ne veut pas dire que cette « encre » subversive, inclassable, n’existe pas. Au contraire. Elle est présente dans les chemins parallèles, dans les sentiers mineurs : elle échappe à la théorie littéraire car elle est porteuse d’un excèdent, d’un surplus. Une fois encore elle incarne une smarginatura des codes et des discours.
Ferrante, à travers son parcours littéraire nous semble, tout compte fait, afficher une certaine affinité avec ce type de réflexion. Dans son œuvre elle met en place un véritable remaniement du langage, des styles littéraires, des genres. Elle passe du roman court (L’amore molesto, 1992 ; I giorni dell’abbandono, 2002 ; La figlia oscura, 2006) à un conte pour enfants (La spiaggia di notte, 2007). Elle utilise ensuite les codes de l’autobiographie en les habitant à sa manière (La frantumaglia, 2003, republié en 2016). Elle s’amuse à écrire un essai critique sur le sens même de l’écriture, sur le métier d’écrivain, mais ce faisant elle mélange à la critique ses souvenirs d’enfance, elle transforme son essai en une sorte d’autofiction-critico-littéraire. Ensuite elle abandonne les sentiers battus – à savoir les romans courts, l’écriture pour enfants et les essais littéraire – pour s’aventurer dans l’écriture de L’amica geniale (2011-2014) : un roman-cathédrale qui prend l’ampleur d’une tétralogie de plus de mille pages.
Son œuvre affiche une langue apparemment simple et, soudainement décalée. Une langue qui présente une facilité de lecture, une certaine recherche de la forme épurée – piana – pour s’écraser, littéralement, contre un choix lexical issu d’une littérature basse, populaire, parfois vulgaire, qui mélange certains idiomes du dialecte napolitain. Nous faisons référence, entre autres, à l’usage parfois déroutant qu’elle fait des insultes qui apparaissent brutalement en provoquant une coupure dans la page. Nous pouvons presque parler d’une véritable blessure dans le langage. Dans ses livres nous retrouvons certaines expressions comme « hommemerd’ », « strunz » (Ferrante, 2011-2014) qui se mélangent à certains verbes utilisés avec une insistance presque dérangeante. Nous pensons au verbe « chiavare » utilisé sans cesse par Ferrante à la place du plus commun, plus tendre : « fare l’amore ». Il s’agit d’une langue qui ne craint pas la contamination, qui n’a pas peur de descendre dans ce que l’écrivaine définit comme le « scantinato dello scrivere » : un terrain où l’écriture longuement réfléchie, longuement travaillée, s’associe aux idiomes issus des « giornaletti femminili che circolavano per casa; robaccia di amori e tradimenti », à savoir les photoromans. Cette plongée dans un terrain obscur, populaire, ouvre la voie à un plaisir d’écriture qui dévoile une sorte de jouissance coupable, celle des émotions provoquées par une langue qui insiste sur le « godimento di passioni forti e un po’ volgari » (2016, 59). L’écriture de Ferrante est donc une écriture contaminée. Une écriture traversée de néologismes – frantumaglia, smarginatura – une écriture qui cherche à exprimer la souffrance en évoquant un imaginaire strident – souvent dissonant – accentué par l’usage réitéré de certains termes comme « squadernare », « scollamento », « deragliamento », « squinterno » souvent employés hors contexte.
Les personnages de Ferrante sont donc des femmes déraillées, démantibulées, décollées. Elles sont représentées dans leur rage inexprimée, et ces rages, ces souffrances, produisent des failles, des blessures physiques qui se répercutent tant sur leurs corps que sur leur langage. La parole, alors, se fait miroir d’une série de corporéités problématiques, en donnant lieu à des figures oxymoriques, à des allégories décalées. Nous faisons référence à Delia, protagoniste de L’amore molesto, que Ferrante définit comme une « bambina con le rughe » (1992, 10) ; ou à la femme en saumure de I giorni dell’abbandono – l’« alice argentea » – image que Ferrante utilise pour décrire le cadavre de La poverella, la femme devenue folle à cause d’un chagrin d’amour (2002, 57). La souffrance, qui se fait corps, qui se fait langage, amène aussi à des phénomènes bizarres : « le vene sono di metallo » (2006, 57) et peuvent s’éteindre à tout moment – « mi si erano spente le vene » (2002, 131) – ; la bouche se remplit de « stelle-uova avvelenate » (2014, 163) douées d’une « consistenza bianca, gommosa » liée à la « nerezza gelatinosa del cielo » ; les personnages errent dans la nuit avec la tête remplie d’une « folla di parole morte » (2002, 33) ; les maris, les amoureux, les amis, perdent leur structure originelle pour devenir « polipi sarcomatosi, pezzi di fibbra giallastra » ; le monde se transforme en une réalité « pasticciata, collacea » (2014, 162) aux contours apocalyptiques.
Nous sommes confrontés à une écriture stridente – dissonante – qui joue sur le contraste entre une langue travaillée, presque épurée, et une parole obscure, fortement vulgaire, évoquant un imaginaire sombre. Cette écriture liée à la mémoire, aux rapports irrésolus avec la mère, cherche donc à raconter une faille : elle sonde l’abîme, elle le contemple, elle l’habite. C’est une écriture féminine dans le sens où elle cherche à exprimer une vérité sur le sujet, à travers la quête d’une forme de véridicité qui arrive à être, selon Ferrante « insostenibile » (2016, 267). Une écriture enkystée de néologismes, qui s’immerge donc dans les viscères du féminin et qui rappelle le sombre travail d’un boucher en train de « macellare le anguille » (Ferrante, 2016, 218).
Il nous semble alors que cette écriture liminaire, controversée, au rythme claudiquant, dévient, en quelque sorte, une forme de témoignage, in absentia, d’une langue enterrée dans l’enfance, évoquée, puis manipulée, et que Lea Melandri définit à travers l’expression « alfabeto d’origine »(2017). L’écriture de Ferrante se fait donc, à travers une optique féministe : une "scrittura di esperienza" (Melandri, 2017,119-141) qui affiche la structure incomplète et cacophonique des narrations issues des groupes d’auto-conscience féministe des années 1970. Il s’agit d’une écriture où « il fuori tema diventa il tema » (Melandri, 2017, 9) : tout ce qui normalement était considéré comme hors-sujet, prend une place centrale dans la narration. C’est ainsi que cette écriture à « l’encre blanche », cette langue discordante, laisse émerger le récit de ces individus, de ces femmes, qui à travers leurs narrations, font émerger, pour citer Saveria Chemotti, une « galassia sommersa » (2008) qui garde, dans ses modalités expressives, un caractère fracturé, non linéaire, capable d’apporter un regard différent sur les choses et la réalité.
Les personnages qui se profilent grâce à cette écriture féminine qui devient, dans le cas de Ferrante, une « écriture de l’effacement », sont porteurs d’une absence qui ne cesse pas d’être recherchée – choisie– presque invoquée. Ces identités fracturées confient leur narrabilité– leur « soi narrable » – à un langage parallèle qui les forge tout en mettant en lumière leur caractère caduc.
Comme nous avons pu le voir Lila, personnage-miroir de L’amica geniale, porte en elle les traits d’un récit qui est imparfait : autre. Elle incarne, dans sa personnalité irrésolue, le potentiel créatif d’une narration qui pourrait atteindre une forme de véridicité mais qui n’arrive pas à se concrétiser dans la forme écrite. Lenù – narratrice à la première personne – dévoile, de son côté, tous les pièges d’une écriture qui s’avère, en quelque sorte, impossible. C’est pour cela, que, en fin de compte, la recherche d’une parole potentielle – parfaite – répondant aux canons d’une supposée validité littéraire, s’effondre face au choix d’une langue mineure, enterrée dans la mémoire enfantine, une langue qui sache être : la Langue de la Mère. Ainsi, la frantumaglia, cette parole dialectale, issue des souvenirs de Ferrante, semble résumer, dans son mélange indéfini de tristesse et de désir, le sens ultime de cette « écriture de l’effacement ». En effet, ce mot tiré du dialecte napolitain était souvent employé par la mère de l’auteure pour décrire le mal-être psychologique qui l’affectait : sa dépression. Ferrante en fait l’emblème d’une posture d’écrivaine signifiant l’incapacité de trouver une forme narrative apte à raconter la douleur. La frantumaglia est « il deposito del tempo senza l’ordine di una storia, di un racconto ». Elle représente l’angoisse de mort, – « è l’effetto del senso di perdita, quando si ha la certezza che tutto ciò che sembra stabile, duraturo, andrà a unirsi presto a quel passaggio di detriti » – mais elle incarne, aussi, l’incapacité à donner une forme au discours. Elle est « il terrore che la capacità di esprimersi si inceppi come per una paralisi […] e tutto quello che ho imparato a governare dal primo anno di vita a oggi fluttui per conto suo, gocciando via o sibilando da un corpo sempre più cosa, una sacca di cuoio che perde aria e liquidi ». (2016, 95). Dans ce contexte, l’expression se configure comme un non-savoir : un dire qui, pour reprendre l’enseignement de Mariangela Gualtieri, se produit par soustraction. Il s’agit d’une locution qui revendique la position subalterne de tous ces sujets qui n’ont jamais pu faire entendre leur voix et qui s’expriment par « slacciatur[e] » (Gualtieri, 2003, 63) laissant émerger une dissonance – à la fois stridente et mélodieuse – entre la tentation d’un discours et l’abîme de toute parole.
Références bibliographiques
- Œuvres d’Elena Ferrante
Romans
L’amore molesto [1992], Roma, Edizioni e/o, 2015, trad. Jean-Noël Schifano : L'Amour harcelant, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 1995.
I giorni dell’abbandono [2002], Roma, Edizioni e/o, 2015, trad. Italo Passamonti : Les jours de mon abandon, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2004.
La figlia oscura [2006], Roma, Edizioni e/o, 2015, trad. Elsa Damien : Poupée volée, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2009.
L’amica geniale [2011], Roma, Edizioni e/o, 2016, trad. Elsa Damien : L'Amie prodigieuse, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2014.
Storia del nuovo cognome. L’amica geniale volume secondo [2012], Roma, Edizioni e/o, 2016, trad. Elsa Damien : Le Nouveau Nom (L’Amie prodigieuse, vol 2), Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2016.
Storia di chi fugge e di chi resta. L’amica geniale volume terzo [2013], Roma, Edizioni e/o, 2016, trad. Elsa Damien : Celle qui fuit et celle qui reste (L’Amie prodigieuse, vol 3), Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2017.
Storia della bambina perduta. L’amica geniale volume quarto [2014], Roma, Edizioni e/o, 2016, trad. Elsa Damien : L’enfant perdue (L’amie prodigieuse, vol 4), Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2019.
Conte pour enfants
La spiaggia di notte, Roma, Edizioni e/o, 2007, trad. Elsa Damien : La plage dans la nuit, Paris, Éditions Gallimard Jeunesse, 2017.
Essai
La frantumaglia [2003 republié en 2016], Roma, Edizioni e/o, 2016 : trad. Nathalie Bauer : Frantumaglia. L'écriture et ma vie, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2019.
Articles
L’invenzione occasionale, illustrazioni di Andrea Ucini, Roma, Edizioni e/o, 2019.
- Textes critiques
ARENDT, Hannah, The human condition [1958], trad. Georges Fradier : La condition de l'homme moderne (1992); préface de Paul Ricœur, Paris, Presses Pocket, 2008.
ARSLAN, Antonia, CHEMOTTI, Saveria (dir.), La galassia sommersa. Suggestione sulla scrittura femminile italiana, Padova, Il Poligrafo, 2008.
BARTHES, Roland, Le plaisir du texte précédé de Variations sur l’écriture, [1973 ; 1994], Paris, Éditions du Seuil, 2000.
CAVARERO, Adriana, Tu che mi guardi, tu che mi racconti [1997], Milano, Feltrinelli, 2011.
CIXOUS, Hélène, Le rire de la Méduse et autres ironies [1975], Paris, Galilée, 2010.
DIDIER, Béatrice, L’Écriture-femme, Paris, Presses universitaires de France, 1981.
DI PAOLO, Paolo, « Ferrante, boh », L’Espresso, 11 février 2018.
FERRONI, Giulio, I confini della critica, Napoli, Guida, 2005.
FICARA, Giorgio, Lettere non italiane. Considerazioni su una letteratura interrotta, Milano, Bompiani, 2016.
FICARA, Giorgio, Stile novecento, Venezia, Marsilio, 2007.
GUALTIERI, Mariangela, Fuoco centrale, Torino, Einaudi, 2003.
MELANDRI, Lea, Alfabeto d’origine, Milano, Neri Pozza, 2017.
MONTALE, Eugenio, Tutte le poesie [1984], Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2006.
SINI, Carlo, Teoria del foglio-mondo (La scrittura filosofica), Milano, Libreria CUEM, 1993.
Pour citer cette ressource :
Ilaria Moretti, Écrire l’effacement : Elena Ferrante et la construction d’un dire par soustraction, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2019. Consulté le 16/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/periode-contemporaine/ecrire-leffacement-elena-ferrante-et-la-construction-dun-dire-par-soustraction



 Activer le mode zen
Activer le mode zen