À la recherche du Pays de Nulle-Part. L’œuvre de Pier Paolo Pasolini au prisme de l’utopie
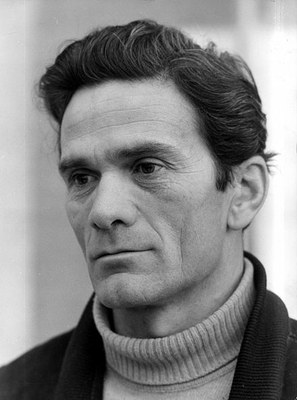
Introduction
Ci troviamo nel buio e nel silenzio delle altezze cosmiche [...]. Ci avviciniamo sempre più... ed ecco il panorama di Napoli [...]. A Napoli si vive, si piange, si ride, ci si dispera, si discute, si litiga, si prega, si canta, perché si è sparsa la voce, misteriosa, che in qualche parte del mondo è nato il Messia. E questo Messia dovrà portare tra gli uomini felicità, ordine, ricchezza, bontà, fraternità [...]. Eduardo e Ninetto prendono il treno che va verso il Nord. Incomincia così il loro viaggio, il lungo viaggio della loro vita (Pasolini, 2001, 2697-2701).
Le voyage en quête d’une utopie de deux picaros napolitains, l’acteur Eduardo de Filippo, dans le rôle du Roi Mage Epifanio, et Ninetto Davoli, prêtant ses traits au domestique Nunzio : voici l’idée centrale du dernier projet cinématographique de Pier Paolo Pasolini, qu’il envisageait de tourner après son dernier film, Salò (Pasolini, 2001, 3022). La dernière version du traitement, achevée avant le 24 septembre 1975, s’intitule Porno-Teo-Kolossal. Ce récit ‒ car tel est l’aspect de ce scénario atypique, quasiment sans dialogues, d’abord enregistré au dictaphone et ensuite retapé à la machine à écrire – ne se limite pas à raconter l’histoire de la recherche d’un rêve de bonheur incarné par la figure d’un Messie enfant, mais il met en scène un périple à travers quatre véritables villes utopiques, dont chacune permet de découvrir, pour reprendre une expression du théoricien de l’utopie Raymond Ruyer, « un monde en miniature »(1988, 3). Dans Porno-Teo-Kolossal, nous avons donc à faire à un Pasolini-utopiste, qui raconte la quête d’un avenir meilleur et échafaude, l’une après l’autre, différentes représentations de la cité idéale « con tutte le sue regole coerenti e assolute ‒ un mondo assolutamente astratto, ideale, perfetto ‒ collocato in una dimensione diciamo metafisica » (Pasolini, 2001, 2710).
Pourquoi la figure de l’utopie, pratiquement absente des nombreux essais sur l’art et la littérature de Pasolini, ainsi que de ses textes politiques ‒ où il emploie le plus souvent ce terme dans le sens banalisé par l’usage de « projet irréalisable » ‒ prend une place aussi significative dans sa dernière œuvre inachevée ? La narration du « long voyage » d’Epifanio et Ninetto, que Pasolini a défini comme « un’enorme Metafora che rovescia e reinventa la realtà » (2001, 2702), ne se servirait-elle pas de l’imaginaire utopique pour raconter le récit même de sa propre quête humaine et esthétique jusqu’à ce moment ? Sous quel angle prend-il alors la catégorie chatoyante d’utopie pour déployer l’histoire de sa recherche de l’idéalité ?
Paradis perdu – utopie ‒ dystopie
L’irruption de l’imaginaire utopique dans un texte comme Porno-Teo-Kolossal où Pasolini raconte métaphoriquement, à travers le récit d’Epifanio et Nunzio, l’histoire sans fin de la poursuite des idéaux nous suggère de repenser les principaux tournants de son œuvre au prisme du concept même d’utopie. Mais pour pouvoir utiliser cette catégorie comme clef d’entrée dans l’art pasolinien, il faut d’abord revenir sur la genèse anthropologique, historique et littéraire de ce terme polysémique. Jean‑Jacques Wunenburger a observé que l’utopie relève de la même « figure archétypique de l’imaginaire » (1979, 17) qu’une autre représentation de l’espace idéal : le paradis. Ces deux manifestations différentes du désir d’atteindre l'« habitat rêvé » (1979, 17) ne seraient pas toutefois deux représentations autonomes, mais le paradis terrestre de l’utopie serait en vérité la métamorphose du mythe du paradis céleste. En effet, comme l’a illustré plus récemment Corin Braga, l’utopie ne serait rien d’autre que le rêve du paradis devenu immanent et atteignable par l’homme sa vie durant, à l’époque où les conquêtes du « nouveau » monde, la prolifération des récits de voyage et le système philosophique de l’humanisme relancent la fantasmagorie de la Cité de Dieu, enfin devenue tangible. Ce n’est pas un hasard si Thomas More, l’inventeur du néologisme « utopia » et du texte fondateur du genre littéraire qui porte son nom, était non seulement l’une des voix majeures de l’humanisme catholique anglais, mais aussi un témoin privilégié de l’attraction du mythe de l’édification d’un « paradis » sur terre. En effet, non seulement il avait lu, comme la plupart des intellectuels de son époque, la célèbre lettre de Christophe Colomb à François Ier et les écrits d’Amerigo Vespucci (Wolfzettel, 1996, 37), mais en 1517, son beau-frère John Rastell, était parti à la recherche du passage Nord‑Ouest, ce qui aurait dû aboutir à la fondation de plusieurs établissements dans la région de la Nouvelle‑Écosse (Goyard‑Fabre, 1987, 155). Nous comprenons alors à quel point les transformations géographiques de son époque avaient dû influencer Thomas More dans l’écriture de son Utopia, emblème de l’ouverture de l’imaginaire européen à une altérité spatiale et sociale.
Toutefois, si l’utopie transfère dans le territoire des hommes la promesse divine du paradis de la tradition judéo-chrétienne, ce dernier est à son tour, la projection en avant d’une autre déclinaison de l’imaginaire de l’espace idéal, c’est-à-dire le paradis terrestre. En effet, dans la religion juive, le paradis, ne devient inaccessible à l’humanité qu’au moment où la première femme et le premier homme trahissent les ordres divins, en entraînant leur expulsion de l’espace du bonheur parfait. Comme l’explique Braga, si le paradis reste longtemps une dimension immanente, après la prise de Jérusalem et la déportation en Babylonie, ainsi qu’avec l’influence de la théologie chrétienne, la religion juive trouve une explication « pour motiver le désastre historique et pour produire une espérance future » (Braga 2010, 21-47). C’est alors que sediffuse l’idée d’une résurrection des Justes qui seront transportés au ciel. Dans l’histoire des idées, l’utopie apparaît donc comme la dernière étape de la recherche d’un nouveau paradis terrestre, désormais édifié par l’homme pour l’homme.
L’histoire du genre littéraire de l’utopie connaît un autre tournant significatif au XXe siècle, lorsque le traumatisme des totalitarismes, les guerres mondiales, l’holocauste remettent profondément en question la légitimité d’une foi en un monde idéal à construire sur terre. Bien que l’idée d’une forme littéraire qui prendrait à contre-pied l’utopie ne soit pas une invention du siècle dernier, c’est bien à ce moment que paraissent les classiques du sous-genre de la dystopie tels que Nous autres de Eugenij Zamiatine en 1922, Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley en 1932 et 1984 de Georges Orwell en 1949. Le rêve du paradis sur terre laisse donc place à la représentation littéraire d’un monde qui réaliserait le plus terrible des cauchemars humains. Paradis, utopie, dystopie : voici les trois moments de l’imaginaire de l’ « habitat rêvé » raconté aussi bien par l’histoire de l’Occident que par le genre littéraire de l’utopie qui l’absorbe et le transpose dans ses mondes imaginaires.
Ce schéma triadique, qui repose sur la projection en avant d’un paradis mythique des origines qui devient ensuite un espace céleste puis terrestre, à atteindre dans le futur, et la négation de ce même élan, est un mouvement que nous retrouvons au niveau macrostructural dans l’œuvre pasolinien. Il est en effet possible de tracer une sorte de parabole qui l’amènerait de la représentation de mondes archaïques, tels que son Frioul ou les borgate romaines, au fantôme de la projection en avant de ces espaces comme hypothèse révolutionnaire pour enfin prendre conscience du caractère illusoire de cette utopie qui sombre alors dans un imaginaire dystopique où la force destructrice du négatif devient paradoxalement le moteur principal de la création.
Antiche ardenti Subtopie
Le premier lieu littéraire de l’œuvre pasolinien est le Frioul de Casarsa, la petite ville maternelle qui surgit sur le fleuve Tagliamento. Le recueil Poesie a Casarsa, entièrement écrit dans le dialecte local et paru en 1942 décrit un espace poétique qui a toutes les caractéristiques d’un véritable Éden. L’idiome « casarsese », qui n’avait pas de tradition écrite, offre en effet à Pasolini la possibilité de créer un univers poétique à partir d’une « lingua antichissima eppure del tutto vergine », capable de « suggerire le immagini originarie », « non ancora corrotto da una coscienza poetica » (Pasolini, 1999, 160). C’est une langue adamique qui n’a, au moins au début, rien de vernaculaire. De manière analogue à son idiome, la Casarsa de la poésie pasolienne est un monde bucolique, clos et encore pur, « senza tempo » et « senza luogo » (Pasolini, 1999, 160). La campagne de ces poèmes apparaît en effet comme un univers rural idéalisé où règne une simplicité paysanne, peuplée de symboles chrétiens : les cloches, les prières, les processions, les récurrences religieuses (le jour de Pâques, le dimanche des rameaux). Toutefois la conception linéaire du temps, propre au christianisme, est absente de cet univers et laisse place à la logique cyclique de l’alternance du jour et de la nuit, des saisons, de la vie et de la mort, comme l’exemplifie l’image de l’éternel retour « des yeux des pères dans les yeux des fils » qui célèbre la permanence de l’Éden de Casarsa. Bien que la morte hante cet univers, le substantiel retour du passé dans le présent lui garantit une stabilité et l’inscrit dans la boucle du temps cyclique et non dans celui de l’Histoire.
La manière dont Pasolini représente en l’idéalisant le monde de Casarsa donne à voir une caractéristique essentielle de sa démarche : la fascination et la recherche de mondes qu’il fantasme comme immergés dans une sorte de temps mythique des origines, étrangers, pour utiliser une expression de Leopardi, aux « magnifiche sorti e progressive » de la culture bourgeoise. Dès le début, le lieu idéal pasolinien n’est donc pas un espace du futur mais une dimension antérieure à rechercher dans un passé lointain.
Lorsque, après le scandale de Ramuscello, Pasolini est obligé de quitter son Frioul pour s’installer à Rome, il revit une expérience d’une certaine manière analogue à l’invention de l’Éden frioulan. Comme pour les Poesie a Casarsa, sa quête esthétique vise à mette en scène un univers anhistorique en créant une osmose entre langue, corps et paysage. À partir de 1950, son sujet littéraire privilégié devient le monde de borgate romaines, un espace sous-prolétaire qui surgit aux marges de la Rome officielle des beaux palais et du Vatican. Son nouvel outil littéraire pour décrire ce monde est le dialecte romain, le romanesco, qui impressionnait Pasolini pour sa richesse, son inventivité et son expressivité, dont l’usage dans ses deux romans Ragazzi di vita et Una vita violenta fera de Pasolini, un non‑Romain, la voix littéraire la plus connue de l’univers du sous-prolétariat de la capitale italienne.
Le rythme de vie des borgatari, les habitants de cette Rome marginale, ne peut pas être comparé à celui des paysans frioulans. La succession du jour et de la nuit ne scande en aucune manière leur temporalité. Au contraire, la nuit, le temps où les travailleurs se reposent, est le moment où la population inactive des borgate multiplie ses errances et se consacre aux amours furtifs et aux petits crimes qui leur permettent de survivre. Un thème de toute la « période romaine » pasolinienne, présent d’abord dans ses romans et puis dans ses premiers films, Accattone et Mamma Roma, est en effet la nécessité et l’impossibilité de sortir de ce monde à part qui est le microcosme du sous-prolétariat romain. De la même manière que les ragazzi, dans leurs pérégrinations, entrent en contact avec Rome et les classes dominantes, pour après rejoindre leurs quartiers périphériques, le mouvement de leur existence semble par moments aspirer à imiter la trajectoire rectiligne des autres vies, mais immédiatement, presque par fatalité, cette tentative échoue. Le temps linéaire et progressif de l’Histoire n’est accessible que ponctuellement par les gens de borgata,fils d’un monde autre, exclu et destiné à rester en-deçà de la civilisation bourgeoise.
Dans un texte du novembre 1961, Pasolini affirme que les borgatari « sont restés préchrétiens : stoïques ou épicuriens » et que « la papauté les a tenus au bain marie en gardant leurs caractères typiques, comme pour tous les insulaires ou les isolés » (Pasolini, 1999 SPS, 742). Derrière cette idée d’un univers insulaire, préchrétien et imperméable au flux historique, on aperçoit l’influence du récit de voyage de Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli (1945) qui avait dû fasciner le jeune Pasolini. Envoyé au confino par le régime fasciste dans un village de la Lucanie, Levi, un peintre de Turin, avait rencontré un monde paysan qu’il avait défini comme une terre qui n’a jamais été atteinte par « il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia » (Levi, 1990, 3). De manière analogue, le monde sous-prolétaire des borgate que Pasolini découvre après son « exil romain » lui apparaît comme un univers qui n’a pas connu « le Christ », figure qui incarne certes la religion chrétienne mais aussi une forme de pensée qui est celle de la morale et de la rationalité bourgeoises qui n’ont pas pu coloniser cette humanité éternellement marginale.
Au monde édénique du Frioul, à l’humanité préchrétienne des borgate, suivra un autre univers dans lequel Pasolini croira retrouver un espace-temps originaire : il s’agit du Tiers Monde. En 1961, il voyage pour la première fois en Inde. À son retour il publie le récit de voyage L’odore dell’India et il n’arrêtera plus de chercher au-delà des seuils de l’Occident des univers marginaux qui seuls lui paraissent des alternatives à cette modernité néocapitaliste qui de plus en plus conquit la vieille Italie prolétaire et sous-prolétaire dépeinte par le néoréalisme. Un poème du recueil La religione del mio tempo se conclut par un cri d’amour pénétrant : « Africa ! Unica mia alternativa » (Pasolini, 2003, 1050). Et son œuvre, notamment son cinéma, fera de plus en plus place aux paysages et aux visages du Tiers-Monde.
Dans le recueil Poesia in forma de rosa (1964), on rencontre un néologisme qui fait sauter les barrières géographiques, historiques et sociologiques qui différencient les divers mondes auroraux de l’œuvre pasolinien pour les faire coexister dans une même entité conceptuelle, aussi fantasmatique que suggestive. Il s’agit du mot subtopia. Il figure pour la première fois dans la section L’alba meridionale :
- Bari Vecchia, un alto villaggio
Sul mare malato di troppa pace –
Un bianco che è privilegio e marchio
Di umili – eccoli, che, come miseri arabi,
abitanti di antiche ardenti Subtopie,
empiono fondachi di figli, vicoli di nipoti,
interni di stracci, porte di calce viva
pertugi di tende di merletto, lastricati
d’acqua odorosa di pesce e piscio [...] (Pasolini, 2003, 1236)
Dans ce paysage des Pouilles, rayonnant de blanc, apparaissent ses habitants qui se déversent dans les ruelles aux odeurs « di pesce e piscio ». L’ambiguïté de la poésie nous empêche de savoir si le vers où figure le néologisme se réfère aux « miseri arabi » ou aux habitants de cette ville blanche de lumière. Peu importe, car les « miseri arabi » sont comparés aux humbles habitants des Pouilles. Le rapprochement des ces deux termes les fait sortir de leurs barrières référentielles en créant ce nouvel espace de sens dont se fait porteur le mot « subtopie » : terre de l’imaginaire, royaume des Arabes, des Italiens du Sud, de tous les mondes pauvres qui leur ressemblent. La deuxième et dernière occurrence précise davantage ce néologisme :
[…] Se l’uomo fosse un Monotipo della Subtopia
Di un mondo senza più capitali linguistiche,
e disparisse quindi la parola da ogni sua via
dell’udire e del dire, lo stringerebbero mistici
legami ancora alle cose […] (Pasolini, 2003, 1250)
Dans ces vers, le poète fait l’hypothèse d’une humanité pré-linguistique où les langues qui ordonnent et hiérarchisent le flux de la vie n’auraient pas encore été découvertes ou elles auraient été oubliées. Aucune « capitale linguistique » ‒ métaphore de tout centre de pouvoir ‒ n’imposerait son hégémonie. Dans la subtopie on parle la langue des « choses ». L’être qui habite le monde de ce rêve poétique prend le nom de Monotype, un seul type d’hommes, qui fait cesser les différences entre individus, caractérisés désormais par le simple fait d’habiter la subtopie. Ce néologisme institue alors une continuité transnationale et transrégionale fantasmatique entre communauté humaines différentes qui ont en commun, comme semble l’indiquer le préfixe « sub » (ce qui est « en dessous », inférieur), leur appartenance à une réalité sous-jacente à l’évolution linéaire bourgeoise qui, comme un fleuve souterrain, coule en dessous du devenir historique en se renouvelant tout en restant toujours identique à soi-même.
L’utopie de la subtopie
Dans l’horizon esthétique et politique de Pasolini, l’humanité de la subtopie est l’unique sujet révolutionnaire. Le calligramme en forme de croix Profezia (Pasolini, 1998, 859-864) est peut-être le plus beau texte qui exprime son marxisme hybride et hétérodoxe. Non seulement ces vers sont une véritable ode à la subtopie, mais cette classe en marge de l’histoire, méprisée par Karl Marx lui-même, qui n’attribuait aucun potentiel révolutionnaire au Lumpenproletariat (« le prolétariat des haillons »), est imaginée comme la seule capable de renverser le cours de l’Histoire bourgeoise. Dans les derniers vers du poème, sous les ordres d’Ali aux yeux bleus, un énigmatique chef barbare venant d’Alger ‒ figure au sein de laquelle cohabitent le martyre du Christ, la révolution socialiste, une certaine perspective tiers-mondiste ‒, une horde d’hommes du Sud du monde débarque en Europe et, dans une sorte de nouvelle fin de l’Empire, détruit Rome pour ensuite y semer « il germe della Storia Antica » et poursuivre « verso nord-ovest, con le bandiere rosse di Trotzky al vento » (Pasolini, 1998, 864).
La révolution que Pasolini invoque vise donc à faire tabula rasa non du passé mais, bien au contraire, de la situation socio‑économique de son époque, à savoir le développement capitaliste. Hervé Joubert‑Laurencin a expliqué la révolution selon Pasolini comme le « grand paradoxe temporel » « d’un retour au statu quo ante » car « pour lui le sens profond de toutes les révolutions (telles qu’elles devraient être plutôt que telles qu’elles sont généralement dans l’histoire moderne) consiste à redécouvrir la vérité archaïque des pères perdue par les fils, le danger de chaque révolution étant de confirmer le moderne » (Joubert-Laurencin, 1995, 145). Tout comme dans l’histoire des idées l’île d’Utopia n’est qu’une projection future du mythe du paradis perdu, l’utopie pasolinienne repose sur l’idée d’un mouvement qui catapulterait en avant un passé originaire pour ouvrir une sorte de fracture subtopique dans la progression de l’Histoire de l’Occident.
Dans deux œuvres telles que le film de montage La Rabbia (1963) dans un premier temps puis dans le film-projet Appunti per un’Orestiade africana, tourné en 1970, Pasolini se penche sur le potentiel révolutionnaire de la subtopie, et en particulier sur la décolonisation comme une occasion de voir apparaître à son époque des alternatives politiques et sociales aux modèles bourgeois. Dans La Rabbia, les mouvements d’indépendance de pays asiatiques, comme l’Inde de Gandhi et Nehru et l’Indonésie de Sukarno ; africains, comme le Congo, l’Égypte, la Tunisie, le Tanganyika, le Togo et bien sûr l’Algérie ; et latino-américains, comme Cuba, sont présentés sur un ton triomphal et plein d’espoir comme l’accès des opprimés à une émancipation à laquelle les oppresseurs les avaient soustraits pendant des siècles. Dans Appunti per un’Orestiade africana, qui se présente comme un journal de bord cinématographique, à savoir une série de notes visuelles pour un potentiel film à venir, le questionnement va plus loin et se fait plus inquiet et problématique. Pasolini s’interroge en effet sur les possibles modalités de conciliation d’une Afrique antique, traditionnelle, tribale, avec les solutions démocratiques qui se présentent à ce continent après la décolonisation. C’est pourquoi il envisage de transposer dans un ou plusieurs pays du continent africain le mythe de la naissance de la démocratie à Athènes, et plus particulièrement l’institution du premier tribunal citadin racontée dans le troisième volet de l’Orestie d’Eschyle.
Mais si ces projets relèvent de l’interrogation pasolinienne sur le futur d’une humanité qui sache projeter à l’horizon de son propre devenir historique ses origines les plus ancestrales pour perpétrer la survivance de l’antique dans le présent, l’utopie pasolinienne ne saurait se réduire à ces questionnements. Avant même l’écriture définitive de Porno-Teo-Kolossal, Pasolini réalise une œuvre qui fonctionne comme une véritable utopie. Il s’agit du Decameron, le premier film de sa Trilogia della Vita avec I racconti di Canterbury et Il fiore delle Mille e una notte.
Naples cité utopique
Au premier abord, le Decameron n’a pas la cohésion d’une utopie : sa structure fragmentaire (neuf récits), l’importance de la dimension narrative, le ton léger et comique de la plupart des nouvelles, sa parenté directe avec le chef-d’œuvre de Boccace, sa nature apparemment apolitique, invitent à mobiliser d’autres outils interprétatifs que ceux que la tradition utopique met à notre disposition. Les utopies, souvent marquées par leurs descriptions neutres et informatives, leur focalisation principalement externe et panoramique, la quasi absence d’une trame narrative (au moins chez More et ses émules), leurs projets sociaux toujours présents en filigrane, réveillent en effet un imaginaire bien différent de l’univers du Decameron pasolinien. Cependant, si l’on suit de près la genèse du film et si l’on observe attentivement le réseau de renvois et raccords qui relie les récits, nous découvrons une unité, une cohérence, une vis utopica qui échappent à première vue.
Dans un premier temps, Pasolini avait imaginé un Decameron international aussi riche géographiquement que le chef-d’œuvre de Boccaccio. Toutefois, en avançant dans la genèse de son film, il décide progressivement de limiter la spatialité à un unique lieu, porteur pour lui d’une force symbolique très forte : la ville de Naples, qui était pour lui une exception dans l’Italie néo-capitaliste transformée par le « miracle économique », comme il l’explique dans une interview à Ezio Golino de 1973 :
Sono secoli che i napoletani si adattano mimeticamente a chi è sopra di loro, ma poi nella sostanza restano uguali, conservano il loro modello culturale. E di quale nazione dovrebbero sentirsi cittadini i napoletani ? Almeno a Napolo qualcosa di autentico sopravvive. Solo a Napoli il dialetto e il suo mondo esistono ancora (Gulinucci, 1995, 220-223).
Le Naples du Decameron est toutefois, de fait, un espace-temps imaginaire. En effet, Pasolini a tourné son film moins dans la ville elle-même que dans plusieurs localités limitrophes de la Campanie et du Latium qui conservaient ces caractères archaïques qui auraient conféré un aspect subtopique à la cité racontée dans son film. Ces fragments spatiaux, recherchés et assemblés minutieusement par le cinéaste, construisent au fil du film une ville complète, avec ses marchés, ses lieux de culte et sa campagne.
Véritable maille du film, ces espaces de vie commune reviennent d’une nouvelle à l’autre et ici se rencontrent les personnages des différents récits. Les nouvelles de « Ciappelletto », « Andreuccio », « Giotto », « Gemmata », « Tingoccio et Meuccio » gravitent autour de lieux pivots comme le marché de bétail, la ruelle avec la représentation de la Vierge à l’Enfant, la place Santa Chiara et sa basilique et le marché de fruits et légumes. Les autres nouvelles, ayant une dimension plus rurale, sont insérées dans cette trame géographique commune par une autre stratégie. Leurs protagonistes apparaissent dans les autres épisodes en faisant court‑circuiter l’autonomie de chaque récit : les nonnes de la nouvelle de Masetto attendent Giotto devant la basilique de Santa Chiara et deux d’entre elles font les courses au marché, Lisabetta joue avec un groupe de jeunes filles de son âge au début de la nouvelle de Caterina, la famille de cette dernière se rend au marché de fruits et légumes où travaillent les maîtresses de Tingoccio et Meuccio et où Giotto les regarde. La continuité que le cinéaste établit entre les différents lieux du Decameron institue donc des liens entre les personnages des différentes nouvelles qui sont ainsi dotés d’une identité commune napolitaine.
Si la construction spatiale est une des stratégies qui confèrent au film une unité forte qui résout la fragmentation narrative, la langue du Decameron, le dialecte napolitain, joue également un rôle crucial. De la même manière que dans Poesie a Casarsa et dans les œuvres de la période romaine Pasolini avait crée une osmose physique, topographique et linguistique, avec le premier film de la Trilogia della Vita, il reprend ce dispositif en fabriquant un univers autonome, une véritable « île linguistique », une entité ab‑solue, à savoir libérée de tout lien avec une altérité qui pourrait la contaminer. Bien que le Naples que Pasolini réinvente pour son Decameron ne soit pas une île comme Utopia de Thomas More, par le travail sur la géographie du film et l’unité linguistique, le cinéaste accomplit une véritable opération d’isolement visant à concentrer dans le périmètre de cette ville inventée une étrangeté spatio‑temporelle qui supporte mal des contaminations extérieures qui pourraient perturber son authenticité.
Mais l’utopie intra-muros du Naples pasolinien partage un autre élément narratif avec la tradition utopique : la présence du voyageur qui s’aventure en Utopie. Type particulier de récit viatique, l’utopie ne peut pas exister, en effet, sans le regard et la voix d’un personnage errant qui est à la fois l’alter-ego de l’utopiste ‒ qui explore par le biais de son imagination un nouveau monde ‒ et du lecteur ‒ qui, en lisant son récit, adopte son point de vue dans la découverte du pays de Nulle part. Si dans Utopia de More, ce personnage est Raphaël Hytlodée, une sorte de nouvel Ulysse (More, 1987, 85), dans le Decameron ce rôle est confié au personnage de l’élève de Giotto, interprété, de manière très parlante, par Pasolini lui-même. Après le désistement du poète Sandro Penna d’abord, puis du romancier Paolo Volponi (Mettel, 1971, 208-209) qui devaient interpréter le rôle de Giotto, Pasolini décide, sous conseil de l’ami Sergio Citti, de jouer lui-même ce personnage en saisissant une occasion parfaite, pour quelqu’un qui avait toujours revendiqué l’inspiration picturale de son cinéma, de s’identifier littéralement à ce peintre. À partir de ce moment, on ne parlera plus de Giotto, mais d’« un élève de Giotto venant du Nord de l’Italie », allusion évidente à son origine.
Une réplique de Forese, le personnage qui accompagne le disciple de Giotto, subit également une transformation importante : le peintre se rend à Naples non pour « peindre dans la ville » comme écrit dans le scénario, mais « pour peindre la ville ». Ce personnage métanarratif, à fois transposition de Pasolini-utopiste, voyageur dans la cité utopique du Décaméron et regard qui la fait exister pour un spectateur, condense toutes les fonctions du personnage du voyageur de la tradition utopique qui convergent dans l’impératif de donner à voir un monde absolument autre pour inviter l’époque de l’auteur à questionner ses convictions et son idéologie dominante.
Le Decameron apparaît alors lui-même comme un contre-modèle jeté au visage de l’Italie des années soixante-dix. Tourné après la période de la contestation estudiantine, ce film oppose au mythe de la libération sexuelle et de l’anti-autoritarisme, une utopie du passé qui entretient un rapport au désir véritablement révolutionnaire à ses yeux. Si le cinéaste voit dans le mouvement des années 1968-1969, des revendications qui ne font que promouvoir cette « fausse tolérance » dont la société de consommation a besoin pour ôter les derniers freins au fétichisme de la marchandise, le Decameron propose au contraire une société où les interdits existent et où ces même interdits, auxquels les personnages se confrontent sans cesse, donnent un sens à la puissance transgressive de leur désir. La liberté que les personnages affirment en faisant triompher leur jouissance contre les impératifs moraux de leur temps (la chasteté des religieux dans « Masetto » et « Gemmata », la fidélité conjugale dans « Peronella », le respect des morts dans « Andreuccio », le timor dei dans « Ciappelletto », la virginité dans « Caterina », « Lisabetta » et « Tingoccio et Meuccio ») touche à son sens le plus profond car elle n’est jamais octroyée de haut, mais construite au jour le jour, avec joie et inventivité, par les habitant de l’utopie napolitaine au prix de mettre en péril leur vie. Par là, Pasolini rejoint l’idée adornienne de la jouissance comme une « vengeance » contre la civilisation (Adorno, Horkheimer, 1974, 114), en opposition au néo-capitalisme qui l’asservit et la plie à ses besoins en l’intégrant aux normes de la société. En donnant à voir un monde autre, où le plaisir sexuel ne répond pas à l’obligation d’ « être modernes » comme dans la société de consommation, mais où, au contraire, il conteste radicalement la norme morale, Pasolini fait de la subtopie napolitaine un miroir inversé qui met son présent face à ses contradictions.
Lorsque l’utopie pasolinienne se retourne en dystopie
Toutefois, l’énergie utopique qui anime le Decameron doit bientôt se confronter à une impulsion de toute autre nature, qui amène Pasolini à délaisser son engagement pour une affirmation dans le présent de l’utopie d’un espace-temps originaire. Ayant perdu tout espoir dans une transformation de sa société qui semble avoir été investie par une véritable « rivoluzione di destra », il tourne son art vers la dénonciation désespérée de la dimension infernale du présent. En 1975, il écrit un texte révélateur de ce dernier tournant de son esthétique. Il s’agit de l’Abiura dalla « Trilogia della Vita » où il déclare :
I giovani e i ragazzi del sottoproletariato romano - che son poi quelli che io ho proiettato nella vecchia e resistente Napoli, e poi nei paesi poveri del Terzo Mondo - se ora sono immondizia umana, vuoI dire che anche allora potenzialmente lo erano [...]. Il crollo del presente implicaanche ilcrollo del passato. La vita è un mucchio di insignicanti e ironiche rovine. [...]. Riadatto il mio impegno ad una maggiore leggibilità (Salò?). (Pasolini, 1999 SPS, 601-603)
Si l’espace‑temps de l’origine comme possibilité de salut dévoile rétrospectivement son visage mensonger, les corps des habitants de la subtopie ne sont plus à voir comme des survivants à protéger contre un présent ennemi, mais comme la dernière étape d’une « dégénérescence » qui se manifeste inéluctablement à travers l’Histoire. Dans ses dernières œuvres, Pasolini revient alors sur sa littérature et son cinéma du passé pour les adapter à son nouvel état d’esprit.
L’espace qui doit être remis en cause en premier lieu est l’éden frioulan. Dans son dernier recueil de poèmes, La Nuova Gioventù, à côté des anciens vers de frioulans réédités pour l’occasion, figure la réécriture d’une partie de ces textes dans lesquels Pasolini nie ou profane les images édéniques qui peuplaient la campagne de Casarsa de ses poèmes des années quarante. Là où il y avait les corps innocents des paysans frioulans, il y a à présent un monde de spectres et d’images mortifères. Dans son dernier roman inachevé Petrolio, une longue séquence appelée « La Visione del Merda » propose une nouvelle représentation de la subtopie des borgate romaines. Par la mise en scène de la promenade d’un nouveau borgataro à l’aspect répugnant dans une sorte d’enfer néocapitaliste peuplé de corps corrompus par la société de consommation, Pasolini affronte la réalité du sous-prolétariat romain, désormais rendu brutal et névrosé par l’impératif, véhiculé par la société italienne et en particulier par la télévision, d’adopter un mode de vie bourgeois qui, de fait, lui est inaccessible.
Mais, comme annoncé dans l’Abiura dalla « Trilogia della Vita », l’œuvre qui nie et défigure avec le plus de virulence le mythe de la subtopie est bien évidemment Salò. Reposant sur un dispositif complexe qui superpose l’évocation historique de la République de Salò, les Cent-vingt journées de Sodome du Marquis de Sade et une structure inspirée de l’Enfer de Dante, ce film met en scène une terrible métaphore de la jouissance autoritaire et violente que le pouvoir néocapitaliste impose aux corps de ces jeunes qui jadis peuplaient la subtopie pasolinienne, désormais privés de leur éros insouciant. Comme dans la trilogie dystopique Zamiatine-Huxley-Orwell, nous sommes face à un espace clos et infranchissable, régi par des règles strictes comme un véritable ordre politique, où le cours de l’Histoire semble avoir atteint son monstrueux et irréversible but ultime. La figure du voyageur qui caractérisait l’utopie est désormais remplacée par des individualités qui cherchent en vain à se libérer du pouvoir qui les assujettit, par l’expérience érotique et des tentatives révolutionnaires. En effet dans Salò nous assistons à des scènes de transgression (l’amour homosexuel d’Eva et Antiniska, le poing levé du collaborationniste Ezio) qui ouvrent des brèches dans la dimension absolue du pouvoir, avant que ces infractions ne soient réprimées dans le sang. Aucune échappatoire ne semble donc possible dans cette réinvention du château de Silling sadien, tout comme dans la société italienne des années soixante-dix, ayant désormais renoncé à poursuivre une alternative à l’idéologie consumériste.
Ce « long voyage » qui conduit Pasolini d’un monde subtopique à l’autre pour arriver enfin à prendre conscience du caractère illusoire de son rêve révolutionnaire ainsi que de son mythe spatial, est racontée dans Porno-Teo-Kolossal à travers l’édification de quatre villes utopiques, chacune métaphorisant l’un des moments de son parcours humain et artistique. Animés par la vis utopique de la subtopie napolitaine, Epifanio et Nunzio, arrivent d’abord à Sodome qui, comme nous le lisons dans le scénario, devait coïncider avec la Rome des années cinquante. C’est une radieuse ville homosexuelle, où « non soltanto minoranze eterosessuali, ma anche minoranze di negri, minoranze di ebrei, minoranze di zingari […] vivono nella più assoluta libertà anche interiore » (Pasolini, 2001, 2713). Véritable utopie de la jouissance et de la liberté, Rome-Sodome spatialise la découverte de Pasolini de l’éros subtopique et de ses règles. Mais comme toute utopie, elle est fragile : non seulement lorsqu’elle transgresse à son éthique de l’acceptation de l’altérité, elle est détruite par Dieu, comme dans la Bible, mais l’utopie qu’Epifanio et Nunzio rencontrent immédiatement après n’est de fait que cette même cité tournée en dystopie. Il s’agit de Gomorrhe, imaginée dans la ville de Milan, postdatée dans les années 1975-1976. Ville féroce, violente, absolument hétérosexuelle et réfractaire à toute différence, elle incarne l’esprit du néocapitalisme destiné à anéantir tout espace subtopique. Si dans ce couple antagoniste d’utopies, il y a déjà l’histoire de la « conversion » dystopique de Pasolini, ce schéma se précise dans la suite du voyage d’Epifanio et Nunzio. Lorsque ils arrivent à Numance-Paris, cette ville de l’utopie socialiste, modèle absolu de démocratie et d’adhésion aux valeurs du collectif, est entourée par une armée nazie qui l’assiège. L’opposition entre Sodome et Gomorrhe, qui se jouait sur le plan du désir, recoupe ainsi la dichotomie qui oppose l’idéal politique pasolinien à la nouvelle idéologie de la société de consommation, qu’il a sans cesse appelé dans Scritti Corsari « nouveau fascisme ». L’éros et le politique se rejoignent donc et apparaissent comme étant l’un le visage de l’autre. Mais le voyage ne s’arrête pas ici. Comme toujours dans l’œuvre de Pasolini, un conflit entre deux réalités opposées ne se résout pas entièrement mais amorce une nouvelle dynamique. Lorsque les protagonistes arrivent enfin à Ur, où est censé naître le Messie, ils font une terrible découverte qui entraînera leur mort. Dans cette ville d’un Tiers-Monde désormais globalisé, ils apprennent que l’enfant attendu est déjà né, mort et oublié. Ainsi, leur quête s’achève dans la prise de conscience de ce paradoxe temporel qui avait caractérisée non seulement leur voyage mais aussi l’utopie pasolinienne : lorsque le mythe de l’espace originaire est projeté en avant et transformé en utopie il ne peut que révéler sa vacuité et dévoile l’illusion qui l’avait nourri dès le départ. Le paradis perdu ne peut qu’être espace vide.
Mais le récit continue. Après avoir erré dans le ciel à la recherche d’un paradis qu’ils ne sauront pas trouver, les âmes des protagonistes s’arrêtent et regardent la Terre. Epifanio pense à l’illusion qui l’amené jusque là et commente ému : « Senza quella stronzata, Terra, non ti avrei conosciuta » (Pasolini, 2001, 2753) Le leurre qui a animé leur voyage leur a permis cette appropriation du réel qui est au fond la véritable destination de toute quête utopique. C’est sur cette déclaration d’amour à la vie et à la réalité que se conclut la recherche inépuisable de l’espace idéal de Pasolini.
Références bibliographiques
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max, 1974. Dialectique de la raison, Paris : Gallimard, p. 114.
BRAGA, Corin, 2010.Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe‑XVIIIe siècles, Paris : Éditions Classiques Garnier, pp. 21‑47.
GOYARD-FABRE, Simone, 1987. Thomas More. L’utopie. Paris : Flammarion, p. 155.
GULINUCCI, Michele (dir.), 1995, Interviste corsare sulla politica e sulla vita1955‑1975, Roma : Liberal Atlantide, pp. 220‑223.
JOUBERT-LAURENCIN, Hervé, 1995. Pasolini.Portrait d’un poète en cinéaste, Paris : Cahiers du cinéma, p. 145.
LEVI, Carlo, 1990. Cristo si è fermato a Eboli, Torino : Einaudi, p. 3.
METTEL, Paolo Andrea (dir.), 1971. « Atmosfera di esuberanza », La Rivista del Cinematografo, n°5, Roma : Fondazione ente dello spettacolo, pp. 208‑209.
MORE, Thomas, 1987. L’Utopie, Paris : Flammarion, p. 85.
PASOLINI, Pier Paolo, 2003. Tutte le poesie, Milano : Mondadori.
PASOLINI, Pier Paolo, 2001. Per il cinema,Milano : Mondadori.
PASOLINI, Pier Paolo, 1999. Saggi sulla letteratura e sull’arte, Milano : Mondadori.
PASOLINI, Pier Paolo, 1999 SPS. Saggi sulla politica e sulla società, Milano : Mondadori.
PASOLINI, Pier Paolo, 1998.Romanzi e racconti, Milano : Mondadori.
RUYER, Raymond, 1988. L’utopie et les utopies.Monfort : Saint‑Pierre‑de‑Salerne, p. 3.
WOLFZETTEL, Friedrich, 1996. Le Discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, du Moyen âge au XVIIIe siècle. Paris : PUF, p. 37.
WUNENBURGER, Jean-Jacques, 1979.L’Utopie ou la crise de l’imaginaire. Paris : Delarge. p. 17.
Pour citer cette ressource :
Daria Bardellotto, À la recherche du Pays de Nulle-Part. L’œuvre de Pier Paolo Pasolini au prisme de l’utopie, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), février 2018. Consulté le 12/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/periode-contemporaine/A-la-recherche-du-Pays-de-Nulle-Part



 Activer le mode zen
Activer le mode zen