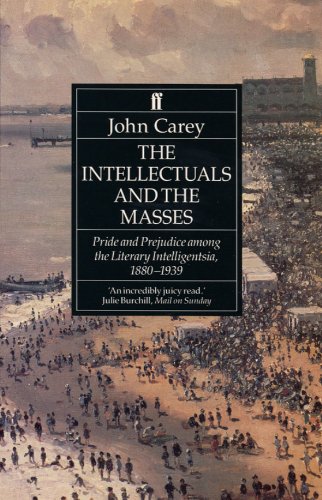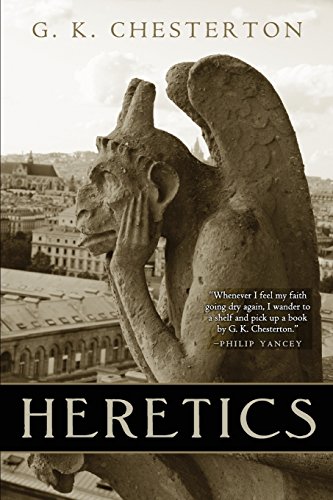G.K. Chesterton, penseur critique de la culture de masse ?
Introduction
Avant que les travaux de Richard Hoggart et de Stuart Hall à Birmingham ou de Raymond Williams à Cambridge ne consacrent la naissance des cultural studies modernes, la Grande-Bretagne voit fleurir une tradition britannique d’écrits littéraires et critiques sur la culture populaire. Celle-ci se forge sous l’ère victorienne et accompagne l’émergence de la première industrie culturelle de masse, qui naît des effets conjugués d’une augmentation du lectorat britannique et d’une révolution de l’industrie de la presse. Les essais de Matthew Arnold (notamment dans Culture and Anarchy, série d’articles publiés dans Cornhill Magazine en 1867 et 1868 et édités en 1869), de Thomas Carlyle (Past and Present, publié en 1843) et d’autres penseurs fondent une lignée de textes polémiques et canoniques qui tentent d’articuler des pratiques culturelles contemporaines avec des rapports sociaux. À la grande différence des cultural studies, ces textes expriment une vision conservatrice, qui, quoique sûrement anti-utilitariste, élaborent une ligne réactionnaire. Une vision anti-prolétaire domine par exemple dans l’œuvre d’un Matthew Arnold, pour qui la culture de masse est un problème social. Cette tradition se prolonge, dans la première moitié du XXe siècle, dans les travaux de F.R. et Q.D. Leavis ou encore dans l’essai de T.S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture (1943), qui attaquent eux aussi l’existence même de cette culture de masse. Un fossé sépare donc cette critique culturelle des cultural studies, devenues une discipline académique marquée par un fort héritage marxiste (Lukács, Gramsci) et consacrée à l’étude des conditions de production et de réception de la culture de masse.
On serait a priori tenté de classer Chesterton dans la lignée de la première tradition. Cet écrivain et polémiste édouardien conservateur, engagé dans la défense de plus en plus acharnée de la foi catholique est d’abord, chronologiquement du moins, un homme de lettres et un critique littéraire original. En effet, la critique connaît à l’époque édouardienne un succès croissant, mais elle se pratique principalement sur le mode biographique (sur le modèle vie-œuvre). Or les monographies chestertoniennes (au nombre de neuf pour la seule période édouardienne et dont les plus célèbres sont consacrées à Dickens, Carlyle ou Browning) s’écartent considérablement de ce modèle, délaissant l’aspect biographique pour une réelle analyse littéraire. À côté de cet examen d’artefacts culturels remarquables, Chesterton développe dans son journalisme une étude tout aussi attentive de productions littéraires beaucoup plus ordinaires qui peuplent le quotidien édouardien londonien : il s’intéresse à la littérature de masse, à la presse à scandale, au roman policier et à toutes sortes d’objets culturels pour peu qu’ils soient populaires, au sens de « qui a la faveur du plus grand nombre ». Chesterton s’écarte donc de la première tradition, installée par Arnold et Carlyle, et de la détestation affichée pour « les masses ». Dans l’introduction qu’il rédige à une compilation d’essais d’Arnold parue en 1906, Chesterton lui reproche par exemple son manque de « sympathie populaire » (xi) et marque à plusieurs reprises son rejet du terme-même de masses (masses ou mob) qui ne renferme selon lui aucune réalité, mais donne un contour linguistique à un fantasme bourgeois. L’intérêt qu’il porte à toutes les expressions culturelles, quelles qu’elles soient, et à leurs implications idéologiques, relève d’une forme précoce d’ethnographie de la culture. Plus encore, il s’érige en défenseur (The Defendant est d’ailleurs le titre de l’un de ses premiers recueils de critique culturelle paru en 1901) de certaines de ces productions culturelles populaires tant décriées par les penseurs victoriens puis édouardiens.
Cet article propose de montrer comment la conception chestertonienne de la culture populaire s’inscrit à la croisée des chemins entre critique culturelle et cultural studies britanniques. On décrira tout d’abord le climat intellectuel fébrile de l’époque édouardienne, souvent résumé sous l’antagonisme de Peers vs. People et qui résulte d’une crise à la fois politique, sociale et culturelle, avant de présenter la critique culturelle chestertonienne et de montrer comment elle ouvre la voie à une défense de la culture populaire.
1. The Peers and the People : l’ère édouardienne à l’heure d’une crise politique et culturelle
L’antagonisme entre Peers et People s’élabore dès les années 1840, notamment sous la plume de Carlyle, pour décrire les conséquences sociales de la révolution industrielle. Carlyle critique violemment l’esprit de la révolution, dans laquelle il voit une force de destruction de l’individu, capable de précipiter la chute de l’homme dans l’âge mécanique. Craignant la mécanisation de la société comme des esprits, il mène une croisade contre le matérialisme scientifique et le système du laissez-faire. Loin de voir dans l’avènement de cette nouvelle société une libération des énergies, Carlyle perçoit le danger d’une précarisation des travailleurs (People), laissant les fruits de la révolution à une minorité possédante (Peers).
Cet antagonisme refait surface à l’ère édouardienne, créant un effet d’écho entre les deux époques. Les années 1900 sont marquées par un certain nombre d’événements décisifs dans la renégociation des rapports sociaux britanniques, laissant progressivement apparaître une crise de représentativité politique : l’émergence du Labour Party, le militantisme accru du mouvement des Suffragettes ou les revendications irlandaises pour le droit à l’auto-détermination (Home Rule) en sont les manifestations les plus critiques. De surcroît, la dénonciation des conditions de vie déplorables des plus pauvres par la slum literature (une frange de la Condition of England literature qui porte sur les bidonvilles urbains britanniques) et par des réformateurs sociaux comme Charles Booth contribue à la création d’un climat social fiévreux, un certain nombre de commentateurs voyant dans cette conjonction de manifestations une remise en cause de la paix et de la justice sociales (Hattersley, 2005, 65).
La crise n’est pas seulement politique mais aussi culturelle. The Condition of England de Charles Masterman, publié en 1909, en est une illustration éclatante et résume des problématiques déjà à l’œuvre les années précédentes ((Le titre ‘The Condition of England’ constitue un exemple supplémentaire de l’effet d’écho entre les deux époques puisqu’il renvoie explicitement à l’essai de Carlyle, Chartism (1839).)). Dans cet essai, dont le succès est immédiat, Masterman brosse le portrait d’un pays au bord du conflit politique, déplore l’inefficacité et l’impuissance de la culture, et reproche à la littérature son incapacité à éduquer l’opinion : « The critics and the novelists, no less than the poets, would seem to have deserved Plato’s rigorous sentence of expulsion from a civilisation against which they are openly at war » (1909, 259-60). Il souligne en outre : « In face of such disillusionment the men who attempt literature attempt escape in various ways. And “escape” is the prominent aspect of today’s art, in a deliberate turning away from the realities of the present, which only a few accept as substance for artistic interpretation » (232). On trouve ici l’acte de naissance du principal préjugé à l’encontre de la fiction édouardienne : son absence de sérieux et sa volonté de s’évader de la réalité en font un divertissement plébéien.
La condamnation par Masterman de la capacité réformatrice de la littérature intervient au terme d’une crispation culturelle entre élite et classes populaires qui se développe à l’ère édouardienne sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Pour rappel, l’accroissement naturel de la population et la promulgation de l’Education Act de 1870 qui permet la création d’un premier réseau d’écoles primaires publiques en Angleterre, ont fait considérablement progresser le taux d’alphabétisation. Celui-ci crée un nouveau lectorat, rapidement courtisé par un certain nombre d’acteurs culturels, dont le plus visible est certainement la presse à sensation, la yellow press. En 1900, alors que Chesterton arrive à Fleet Street, est fondé le Daily Express, quatre ans après le Daily Mail. Ces journaux bon marché visent un lectorat appartenant aux classes les moins nanties. Chesterton est donc pris en étau entre la presse de Northcliffe ((Alfred Harmsworth, 1er Vicomte de Northcliffe, est considéré comme l’un des pionniers de la yellow press. Il fonde en 1896 le Daily Mail, qui devient rapidement le quotidien au plus fort tirage du monde ainsi qu’un instrument de façonnage des opinions politiques.)) symbolisée par le Daily Mail, « The Busy Man’s Paper », et celle d’une élite méprisant ce nouveau lectorat.
En effet, face au développement de cette nouvelle culture, une attitude parmi les intellectuels consiste à en mépriser non seulement les produits mais aussi à nier à ses consommateurs toute individualité, ceux-ci étant regroupés sous l’étiquette peu flatteuse de « masses ». C’est la thèse développée par John Carey dans The Intellectuals and the Masses. Il y défend que le terme même est une construction imaginaire, une fiction repoussoir, élaborée par les intellectuels de la fin du XIXe siècle pour se distancer de la culture de masse industrielle. Pour Carey, ce mépris est promu par Nietzsche (mais aussi Ibsen et Flaubert), en qui il voit paradoxalement l’un des premiers produits de cette culture de masse puisque Nietzsche est extrêmement lu en Europe, et au Royaume-Uni en particulier. Il donne l’exemple de l’influente revue The New Age, qui publie plus de 80 articles sur Nietzsche entre 1907 et 1913. Plus mesuré, Daniel Cottom note l’ambiguïté de l’héritage victorien : « It is no accident that the same age that invented mass literacy and mass communication also invented an attitude of intellectual distrust toward certain works simply because they were too popular » (1987,11).
Dans ce contexte, Chesterton se démarque rapidement de ses pairs, par sa défense de la culture low-brow, qui se développe massivement dans de nouveaux médias. S’il est extrêmement critique vis-à-vis de certaines productions, il prend aussi rapidement la défense d’une certaine culture populaire (lui-même n’employant pas le terme de « masse »), héritière discrète d’une tradition partagée, d’un folklore. Chesterton ne fait jamais preuve de cynisme ou d’arrogance envers les classes « à éduquer », s’attaquant plutôt aux modes intellectuelles et au mépris de classe adossé à cette culture, si bien qu’il semblerait que Chesterton n’ait pas tant à cœur d’éduquer les masses, comme nombre de ses contemporains, que d’éduquer les classes moyennes à déconstruire le fantasme des masses.
Il développe par conséquent un goût particulier pour la critique des productions culturelles en tant que telles mais aussi en tant qu’expressions d’une certaine idéologie, en l’occurrence de l’idéologie victorienne. C’est en cela qu’il peut être vu comme un penseur critique précoce de la culture de masse : par sa conscience que les feuilletons, les magazines, les romans et pièces de théâtre produits en masse informent la mentalité de leur public, par les pouvoirs d’imagination et de fiction qu’ils mettent en branle. Fort de ce constat, il prend pleinement part à la tentative de résoudre la crise culturelle édouardienne en se faisant d’une part le critique de l’héritage victorien et le pourfendeur d’un certain climat intellectuel de l’époque et d’autre part, le défenseur d’une culture littéraire populaire. Dernier trait et non des moindres, c’est par la littérature qu’il mène ses excursions intellectuelles, comme à sa suite le feront les premiers artisans britanniques des cultural studies.
2. Chesterton penseur critique de la culture de masse, entre tradition et modernité
2.1 L’héritage du « sage victorien » Carlyle
Il n’est guère étonnant, lorsqu’une époque développe une production culturelle à grande échelle, que se déploie conjointement sa critique. La critique culturelle (cultural criticism) c’est-à-dire l’étude de la culture envisagée en tant qu’objet idéologique ayant des effets sur les structures mentales, naît au XIXe siècle dans les travaux de penseurs comme Carlyle ou Matthew Arnold, que John Holloway rassemble sous l’étiquette de Victorian Sages dans son étude éponyme de 1953. Mais, à l’aune du développement des études culturelles modernes, une critique plus récente propose de considérer Carlyle et Arnold comme des ‘critiques culturels précoces’ (Mattingly, 2010, 231) tout en nuançant cette attribution ((Leur critique des relations entre culture et pouvoir les rapproche de fait des études culturelles modernes mais l’absence d’une remise en cause de l’ordre social ou d’une vision transgressive ou contestataire de la culture populaire les en éloigne.)). Or, selon Ian Ker (2003,75) et William Oddie (2008, 10), Chesterton serait un « sage victorien tardif ». À quoi tient donc cette parenté ? Et l’étiquette de critique culturel ne pourrait-elle pas s’appliquer à Chesterton ?
Chesterton est très tôt profondément travaillé par l’héritage de la pensée de Carlyle. Le nombre d’essais qu’il lui consacre témoigne de cet intérêt précoce et soutenu : Carlyle fait l’objet d’une étude dans Twelve Types en 1902 (retravaillé à partir d’un article publié dans le Daily News en 1901), avant la publication de Thomas Carlyle en 1903 chez Hodder & Stoughton, écrit avec son camarade J. E. Hodder Williams et l’année suivante, d’une préface à l’édition de Cassell de Sartor Resartus. Il consacre également une quinzaine de pages à Carlyle dans The Victorian Age in Literature en 1913, posant là encore les fondations de l’étude universitaire moderne de Carlyle. Lowell Frye postule que Chesterton est un rejeton direct de Carlyle tant dans ses choix de carrière que dans son style d’écriture et qu’il joue un rôle déterminant dans la révision de l’héritage du « Sage de Chelsea », contribuant grandement à déplacer une attention focalisée jusqu’alors sur des aspects personnels de Carlyle vers une attitude critique détachée de ces considérations biographiques (2018, 308-9).
Chesterton et Carlyle diffèrent sur un nombre de points : le premier reproche au second son calvinisme et une forme d’aristocratie démocratique méprisante, limitant comme Arnold la culture populaire à une dangereuse nuisance. Toutefois, leur filiation se fait jour dans le tempérament enthousiaste qui affleure dans une écriture extrêmement figurée. Chesterton célèbre en particulier l’emploi par Carlyle de la vision comme instrument cognitif privilégié et instantané, qui aboutit à ce qu’il appelle une pensée visuelle ou une vision intuitive et qu’il résume dans The Victorian Age in Literature par « he was a seer » (1913, 50). À cette similitude, Christiane d’Haussy ajoute une forme d’humour frénétique, mélangé de passion et de colère, naissant du contraste entre grotesque et sublime (1981, 58). Mais plus encore que le style, ce qui fait de Chesterton un héritier des sages victoriens, à l’instar d’un Carlyle qui voit dans la publicité populaire victorienne un symbole de ses valeurs (à savoir son esprit boutiquier, cf. Past and Present, 1843), c’est la production, à travers la critique littéraire, d’une critique de la culture édouardienne.
2.2 Heretics et la crise culturelle édouardienne
La crise culturelle édouardienne, que Burrow nomme dans son ouvrage de référence éponyme The Crisis of Reason, est à bien des égards la queue d’une comète qui traverse la seconde moitié du XIXe siècle, à partir de l’avènement démocratique européen en 1848. Elle se manifeste notamment par une certaine anxiété du monde intellectuel, inquiet du vide moral et culturel laissé par l’effacement du christianisme et de l’urbanisation dévorante à tous égards qui change considérablement le paysage social.
Dans ce contexte, Chesterton se construit progressivement le personnage de pourfendeur des postures philosophiques en vogue comme l’insistance du discours contemporain sur le progrès ou encore l’efficacité et la pragmatique érigées en philosophies. Il livre également une critique de l’héritage victorien dans The Victorian Age in Literature, série d’essais publiés en 1913, qui condamne un certain héritage intellectuel et moral victorien qu’il juge défectueux. Mais nulle part n’apparaît plus clairement la critique du climat intellectuel édouardien que dans Heretics, publié en 1905, qui inaugure la prise de conscience par Chesterton de l’existence d’une crise culturelle. Dans l’introduction, Heretics se donne pour mission de déconstruire les philosophies contemporaines accusées par Chesterton de ne pas soutenir de « vérité cosmique » (1905, 14). Derrière cette entrée en matière pour le moins grandiloquente, Chesterton se livre à une attaque en règle des canaux et des acteurs de la production culturelle édouardienne. Il choisit comme point de départ la littérature contemporaine, à propos de laquelle il remarque qu’elle véhicule des idéologies sans que celles-ci soient toujours formulées explicitement. L’enjeu de Heretics est donc de faire affleurer les idéologies sous-jacentes à des productions culturelles contemporaines pour souligner leur influence sur des enjeux aussi variés que le bien-fondé de la colonisation ou les prochaines élections.
À travers des sujets disparates, en apparence hétéroclites (Kipling ou la presse à scandale), Chesterton peint le portrait d’une intelligentsia influente, contrairement à ce qu’avance Masterman en 1909, mais conformément à ce que Stefan Collini, dans son étude de l’influence des intellectuels anglais dans la vie publique (Public Moralists, 1991), décrit de leur tentative d’orienter les valeurs et les finalités de la société. Chesterton élargit la définition d’intellectuel pour inclure des auteurs populaires comme Kipling et Wells, et pour expliciter la vision du monde qui se dégage de leurs romans. Par exemple, dans le chapitre intitulé « On Mr. Rudyard Kipling and Making the World Small », il commence par reconnaître le génie poétique de Kipling pour sa compréhension intime de « la vapeur et de l’argot » (1905, 43), mais rapidement, Chesterton, un fervent anti-colonialiste, lui reproche sa promotion de l’empire. Quoiqu’ayant des prolongements politiques évidents, son attaque est d’ordre ontologique : le principe de la colonisation est de dévorer, réduire et appauvrir ce qu’elle conquiert.
The truth is that exploration and enlargement make the world smaller. The telegraph and the steamboat make the world smaller. The telescope makes the world smaller; it is only the microscope that makes it larger. (1905, 51)
They are ancient civilizations with strange virtues buried like treasures. If we wish to understand them it must not be as tourists or inquirers, it must be with the loyalty of children and the great patience of poets. To conquer these places is to lose them. (1905, 52)
Les auteurs populaires ne sont pas les seules forces d’influence de l’opinion publique, renouvelée par l’arrivée d’un lectorat populaire : la toute jeune presse à scandale, prétend être la voix de l’homme de la rue. La majorité des détracteurs de la yellow press de l’époque éreintent son sensationnalisme censé exciter les instincts les plus bas de son lectorat populaire et dénoncent par ce biais l’immoralité supposée des masses et de leur bêtise. En attaquant la yellow press (dont il veut mettre à jour les ambitions intéressées) Chesterton se range de facto dans la catégorie de ces intellectuels mais il attaque aussi les censeurs qui voudraient l’interdire au nom d’un paternalisme de classe. Ce faisant, il prend le contrepied du discours intellectuel dominant et attaque non le sensationnalisme de cette presse mais, au contraire, ce qu’il décrit à grand renfort d’antiphrase et avec un détachement de façade seulement, comme une modération, une tempérance :
This journalism does not merely fail to exaggerate life—it positively underrates it. This press is not the yellow press at all; it is the drab press […]. It must not expose anybody (anybody who is powerful, that is), it must not offend anybody, it must not even please anybody, too much. (1905, 114)
L’appréciation évolue ensuite vers une critique des logiques de pouvoir à l’œuvre dans cette presse, et, avec un humour dont on ne peut que se délecter, Chesterton renvoie dos à dos dans un même ridicule cette presse et ses détracteurs :
Just as a man shows he has a weak voice by straining it to shout, so [yellow journalists] show the hopelessly unsensational nature of their minds when they really try to be sensational. With the whole world full of big and dubious institutions, with the whole wickedness of civilization staring them in the face, their idea of being bold and bright is to attack the War Office. They might as well start a campaign against the weather, or form a secret society in order to make jokes about mothers-in-law. (1905, 117)
Après avoir critiqué sur une base ontologique et humoristique les défauts de cette presse, donnant par-là l’image d’un critique distancé, Chesterton abat sa dernière carte, et dans un saisissant effet de retour au contexte immédiat dans lequel il écrit, il expose les nombreuses collusions entre presse et politique, signes manifestes des ambitions opportunistes de cette presse et de sa lutte pour le contrôle et l’influence de l’opinion publique. La culture de masse n'a donc rien à voir avec une production censée refléter le plus grand nombre, avec une culture populaire, mais apparaît bien comme un outil d’influence voire de manipulation des esprits.
Dans la continuité des polémistes du XIXe siècle, Chesterton s’emploie à déchiffrer les tenants et les aboutissants des productions culturelles de son époque, mais, chose plus rare et contrairement à la grande majorité des intellectuels, il défend aussi la culture populaire en laquelle il voit un reposoir de la tradition anglaise.
3. Défense de la culture populaire
En 1900, le tout jeune Chesterton publie dans The Speaker, qui se veut l’arbitre public du débat sur l’identité nationale, une série d’articles prenant la défense de la culture populaire prisée par les soi-disant masses (il rassemblera ces articles dans le recueil The Defendant en 1901). Il semble donc que cette défense de la culture populaire s’insère dans un débat plus large sur ce qui fait l’identité et l’unité de la société britannique à l’heure édouardienne.
À travers ses articles, Chesterton devient un ardent défenseur de cette culture, ce qui lui vaut un certain nombre de critiques de la part de ses contemporains : Masterman publie par exemple en 1905 un essai, In Peril of Change, dans lequel il attaque notamment l’amour de Chesterton pour « l’homme de la rue ». L’essai révèle le manque d’empathie de l’auteur envers les classes dominées, qu’il défend pourtant socialement et politiquement. Masterman, qui a vécu dans les quartiers pauvres du sud-est de Londres pour écrire son premier essai From the Abyss (1902), donne pleinement dans le travers intellectuel décrit par Carey qui aboutit à la création d’un fantasme des masses : il raye toute individualité pour offrir une vision globaliste et déshumanisée des pauvres. Dans The Condition of England, Masterman se livre à une attaque en règle de la culture populaire édouardienne : il exprime son mépris pour le sport professionnel, les guessing competitions ou la frivolité du music-hall. À l’inverse, Chesterton professe un optimisme reposant sur la promotion d’une identité individuelle qui réhumanise les masses fantasmées par les intellectuels : « I never doubted human beings inside the houses were almost miraculous; like magic and talismanic dolls in whatever ugly dolls’ houses » (1937, 127).
3.1 Défense des genres littéraires populaires mineurs comme prolongements des mythes
Dans une note de lecture écrite pour Pall Mall (1901, 573), Chesterton évoque le livre d’un certain E. A. Bennet, intitulé Fame and Fiction, qui consiste en une étude littéraire des romans les plus lus, afin de définir ce qui constitue la culture grand public, « populaire » : preuve en est que la critique littéraire de l’époque s’intéresse à cette culture (avec cependant une arrogance dont Chesterton ne témoigne jamais). La nature high-brow de la publication dans laquelle Chesterton fait paraître son article confirme un aspect important, déjà mentionné : à l’inverse de nombre de ses contemporains, Chesterton ne cherche pas à s’ériger en éducateur des masses. Sa défense de la culture populaire s’adresse aux classes moyennes et supérieures ; ce sont à elles à qui il faut apprendre à déconstruire le fantasme des masses. Dans cette chronique, il identifie et réfute la savante confusion entre hiérarchie sociale et hiérarchie littéraire à l’œuvre dans les différentes acceptions du terme « populaire ». Il écrit : « it is always unsafe to defend the mob, for there does not exist a single human being who believes himself to be a member of the mob » (1901, 573). Le terme mob est ici à entendre comme un synonyme de masses, John Carey expliquant que l’autre remplace l’un avec l’accroissement de l’alphabétisation (1992, 5). Chesterton formule donc la même critique que Carey : les intellectuels construisent un ennemi imaginaire qui prend d’abord le nom de mob puis de masses pour opérer une forme d’affirmation individuelle de soi contre la collectivité repoussoir de la masse. Dans la suite de l’article, Chesterton relie la célébrité de Marie Corelli (1855-1924) (qu’il n’apprécie pourtant pas) ou de Dickens à ce qu’il nomme la faim spirituelle de l’homme de la rue. À contre-pied de ses contemporains pour qui les masses aiment la mauvaise littérature par facilité et absence de sensibilité esthétique, Chesterton y voit au contraire un investissement et une participation sensible accrus :
If we leave literary criticism on one side, the enthusiasm of the populace for these mystic and moral works is symptomatic of an enduring spiritual hunger. And surely, we need scarcely, in order not to overrate a handful of bad novelists, underrate the whole spirit of man. (1901, 576)
La littérature populaire n’est donc pas une manifestation de la dégénérescence de la civilisation britannique mais renvoie à une forme primitive de littérature, naissant d’une impulsion, d’un désir voire une faculté d’ordre anthropologique, et aussi fondamentale que celle de se nourrir. Quoiqu’encore maladroitement, Chesterton attache la fiction au régime de la vie ordinaire et ouvre la voie, par la critique culturelle, à une théorie de la fiction.
C’est pourquoi il s’engage dans une défense de cette culture populaire (incarnée dans le roman d’aventures, les penny dreadfuls, les romans policiers, les contes pour enfants et le grotesque), héritière à ses yeux des vieux mythes. Dans « A Defence of Penny Dreadfuls », ou « A Defence of Detective Stories », comme dans toutes les autres défenses de la culture populaire du Defendant, Chesterton s’applique à exhumer les vestiges d’une sagesse populaire marquée par le bon sens et demeurée vivace dans les fictions populaires. Les élites affichent au contraire un dédain pour ce genre de littérature, qui leur permet d’établir une hiérarchie culturelle cachant à peine un mépris social.
Pour preuve de ce qu’il avance, il prend les penny dreadfuls, ces histoires urbaines macabres, sensationnelles et/ou drôles, souvent inspirées de faits réels et accompagnées d’illustrations, qui s’adressent à partir des années 1860 en priorité aux enfants :
Nobody imagines that an admiration of Locksley in Ivanhoe will lead a boy to shoot Japanese arrows at the deer in Richmond Park […]. In the case of our own class, we recognise that this wild life is contemplated with pleasure by the young, not because it is like their own life, but because it is different from it. It might at least cross our minds that, for whatever other reason the errand-boy reads The Red Revenge, it really is not because he is dripping with the gore of his own friends and relatives. […] In this matter, as in all such matters, we lose our bearings entirely by speaking of the ‘lower classes’ when we mean humanity minus ourselves. (1901, 13)
Chesterton expose ici les préoccupations sociales et classistes sous-jacentes à l’attitude littéraire. Parant aux vieux reproches (quoiqu’encore actuels) selon lesquels la fiction encouragerait la confusion avec la réalité et exciterait les désirs criminels des classes les plus pauvres, Chesterton expose la volonté des intellectuels de se démarquer socialement des masses, via l’argument littéraire (du mauvais goût). Ce faisant, ils perdent leur « humanité » au sens où ils font semblant d’oublier que la qualité littéraire de ces histoires ne repose pas dans leur exécution sinon dans leur appartenance à un canon populaire universel. C’est ce qu’il expose dans « A Defence of Useful Information », dans laquelle il feint de dénoncer « this widespread madness of information for information’s sake » (1901, 69). Adoptant encore et toujours le mode de la défense paradoxale, Chesterton prend le prétexte de la critique de magazines comme Tit-Bits ou Science Siftings pour attaquer les ennemis de la littérature populaire :
Here again, we find, as we so often do, that whatever view of this matter of popular literature we can trust, we can trust least of all the comment and censure current among the vulgar educated. The ordinary version of the ground of this popularity for information, which would be given by a person of greater cultivation, would be that common men are chiefly interested in those sordid facts that surround them on every side. (1901, 68)
L’intérêt particulier de cette défense est que Chesterton s’inclut dans la classe qu’il accuse ; il avoue lui-même n’avoir pas trouvé d’intérêt à ces informations sur le monde tel qu’il est : « The merely educated can scarcely ever be brought to believe that this world is itself an interesting place » (1901, 71). Ici « merely » ne renvoie pas à un degré particulier d’éducation intellectuelle mais relève d’une forme d’auto-flagellation (puisqu’il parle en réalité de lui-même) qui retourne l’argument éculé selon lequel les pauvres ne sont pas animés du désir de savoir. Là encore, Chesterton ne fait pas tant l’éducation des « masses » que l’autocritique des classes moyennes prêtes à les diaboliser et à construire ce fantasme.
3.2 Un humanisme à rebours de l’ethnographie
Un trait marquant de la défense de la culture populaire de Chesterton est son amateurisme. Il ne cherche pas à calquer son étude sur la discipline anthropologique évolutionniste (née sous l’impulsion de l’ethnographe Edward Burnett Tylor dans la seconde moitié du XIXe siècle) qui pose alors les bases d’un examen systématique des cultures et pratiques premières et/ou populaires. Au contraire, il attaque même sa méthodologie classificatoire et technique qui ne s’applique pas selon lui à la quête de connaissance humaine. Il écrit : « The sin is not that engines are mechanical, but that men are mechanical » (1905, 140). À rebours de cette approche scientifique, il défend une approche que l’on pourrait qualifier d’humaniste dans son sens le plus littéral, en particulier sur la question de l’étude du folklore. Le savant folkloriste (sur le modèle d’Edward Burnett Tylor) est accusé de découper et de ranger les histoires récoltées « dans un musée de fables » à la manière d’un entomologiste : « story after story the scientific mythologists have cut out of its place in history, and pinned side by side with similar stories in their museum of fables » (1905, 147). Chesterton reproche à l’ethnographe folkloriste de dissocier la fable de son contexte factuel et d’en faire une carte postale pittoresque illustrant un irrationalisme primitif (ou selon Tylor, le stade primitif de la culture et donc de la civilisation) et par là un discours tenant le primitif pour inférieur au civilisé. Le folkloriste contemporain, en séparant fait et fiction, présente le recours à l’imagination comme une tentative subalterne, par ignorance de la science et de ses méthodes, de dire la réalité. La fable folklorique est alors réduite à un pis-aller destiné à contrer une incapacité ou un refus de se confronter aux faits. Il évoque en guise d’exemple l’anthropomorphisme identifié par les anthropologues chez des tribus dites « primitives » et interprété comme relevant d’une tentative symbolique d’expliquer des phénomènes inexplicables. Selon Chesterton, cette attribution repose sur une erreur :
Possibly the most pathetic of all the delusions of the modem students of primitive belief is the notion they have about the thing they call anthropomorphism. They believe that primitive men attributed phenomena to a god in human form in order to explain them, because his mind in its sullen limitation could not reach any further than his own clownish existence. (Heretics, 154)
L’anthropomorphisme est assimilé par ces savants à une forme de connaissance primitive, une tentative de subsumer les faits à la forme humaine, inférieure à la connaissance scientifique. Pour Chesterton elle est d’un ordre différent, qui dépasse le terrain seul de l’anthropologie. Il défend que l’humanisation en jeu dans l’anthropomorphisation est une forme d’expérience :
The final cure for all this kind of philosophy is to walk down a lane at night. Any one who does so will discover very quickly that men pictured something semi-human at the back of all things, not because such a thought was natural, but because it was supernatural; not because it made things more comprehensible, but because it made them a hundred times more incomprehensible and mysterious. For a man walking down a lane at night can see the conspicuous fact that as long as nature keeps to her own course, she has no power with us at all. As long as a tree is a tree, it is a top-heavy monster with a hundred arms, a thousand tongues, and only one leg. But so long as a tree is a tree, it does not frighten us at all. It begins to be something alien, to be something strange, only when it looks like ourselves. When a tree really looks like a man our knees knock under us. (Heretics, 154)
L’imagination est cet outil qui permet de donner corps au mystère, à ce qui n’existe pas, à une sensibilité intime, à l’émotion. En l’occurrence elle donne forme à la peur que l’homme ressent lorsqu’il marche seul, la nuit, dans une rue. L’imagination n’est pas ici une fuite mais un moteur de réel : voir revient à connaître. À travers l’exemple anthropologique, l’enjeu pour Chesterton est donc de replacer l’imagination dans un cadre de la connaissance humaine où la science ne serait pas dans une position d’autorité dominante et où l’imagination procurerait une expérience de l’humain, plus précisément du mystère de sa propre humanité, comme un miroir tendu à soi-même.
L’anthropologie est pour Chesterton une métaphore de l’entreprise de connaissance de la part non-scientifique, ontologique de l’homme mais qui pêche par son « exoticisation », c’est-à-dire par sa tendance à asservir l’altérité à la rationalité. Or, « when a man has discovered why men in Bond Street wear black hats he will at the same moment have discovered why men in Timbuctoo wear red feathers » (1905, 143-4). Cette citation met en lumière un précepte chestertonien selon lequel l’étude du lointain permet de rappeler à l’ordre la nécessité de l’étude du proche. Comparer les hauts de forme à des plumes rouges est le plus court chemin pour comprendre ce qui motive un tel geste. Pour connaître, il faut rendre le quotidien étranger, passer l’environnement immédiat, l’acquis, l’ordinaire et l’anodin au filtre de l’inconnu. C’est le remède (final cure) à la tentation rationaliste, mécaniste, entomologiste. L’imagination doit être mise à profit non pas pour s’échapper de la réalité mais pour la confronter, la gonfler de l’irréel pour l’examiner. En somme, comme il l’écrit dans Orthodoxy, il s’agit de comprendre que le rhinocéros est la version réelle de la licorne. Par la transfiguration du connu, de l’anodin et de l’ordinaire peut advenir, pour chacun et chacune, le réenchantement du monde.
Conclusion
Assistant au développement d’une culture de masse, Chesterton comprend que les romans et feuilletons, parce qu’ils impliquent une relation ludique et affective aux représentations qu’ils proposent et parce qu’ils mettent en branle les pouvoirs de la fiction, informent en profondeur l’imagination, les opinions et les pensées de leur public. Mais il refuse la conception, qui prévaut parmi les intellectuels contemporains, consistant à mettre toute la littérature populaire au rebut sous prétexte qu’elle est populaire. Il s’engage non seulement dans une défense des formes qu’il affectionne particulièrement mais cette défense ponctuelle ouvre la voie à une défense plus systématique. L’argument selon lequel une littérature populaire est forcément de mauvaise qualité est renversé et la littérature populaire est rattachée à la littérature folklorique, dont elle serait un reliquat, une forme de fiction distincte du roman réaliste. Plus encore, ce qui ferait la marque de fabrique de la littérature populaire serait son universelle pratique. Elle prolonge le désir enfantin et naturel d’imaginer des histoires et permet de cultiver ce pouvoir d’imagination. Refouler ce travail, c’est se couper d’une forme d’humanité essentielle car les contes comme les romans policiers sont des manifestations d’un « désir de fiction ». En somme, la défense de la littérature populaire libère la littérature du régime de l’Histoire en tant que récit sous contrôle et ouvre la voie à une théorie de la fiction d’ordre anthropologique.
Notes
Bibliographie
CAREY, John. 1992. The Intellectuals and the Masses, Pride and Prejudice among the Literary Intelligentsia, 1880-1939. Londres : Faber & Faber.
CHESTERTON, Gilbert Keith. 1991. The Defendant. Londres : R. Brimley Johnson.
—. 1901. « Books to Read » in George R. Halkett (ed.), Pall Mall Magazine, volume 25, p.573.
—. 1905. Heretics. Londres : John Lane Company.
—. 1906. Introduction à Essays Literary and Critical by Matthew Arnold. Londres : J.M. Dent & Sons, pp.ix-xiv.
—. 1913. The Victorian Age in Literature. Londres : Williams and Norgate.
—. 1937 (1936). Autobiography. Londres : Hutchinson & Co.
COATES, John. 1984. Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis. Hull : Hull University Press.
—. 2002. G. K. Chesterton as Controversialist, Essayist, Novelist, and Critic. Lewiston N.Y. : E. Mellen Press.
COLLINI, Stefan. 1991. Public Moralists, Political Thought and Intellectual Life in Britain 1850-1930. Oxford : Clarendon Press.
COTTOM, Daniel. 1987. Social Figures: George Eliot, Social History, and Literary Representation. Minneapolis : University of Minnesota Press.
FRYE, Lowell. 2018. « G. K. Chesterton and the ‘Shaggy Old Malcontent’ », in Paul E. Kerry, Albert D. Pionke et Megan Dent (eds.), Thomas Carlyle and the Idea of Influence. Vancouver : Fairleigh Dickinson University Press, pp.305-318.
HATTERSLEY, Roy. 2005 (2004). The Edwardians [2004]. Londres : St Martin’s Press.
HAUSSY, Christiane d’. 1981. La vision du monde chez G. K. Chesterton. Paris : Didier-Érudition.
INGOLD, Tim. 2014. « Walking with Dragons: An Anthropological Excursion on the Wild Side », in Celia E. Deane-Drummond, David L. Clough et Rebecca Artinian-Kaiser (eds.), Animals as Religious Subjects: Transdisciplinary Perspectives. Londres : Bloomsbury, pp.35-58.
KER, Ian. 2003. The Catholic Revival in English Literature, 1845-1961. South Bend : Notre Dame University Press.
LODGE, David. 1993 (1992). The Art of Fiction. New York : Viking Penguins.
MASTERMAN, Charles. 1909. The Condition of England. Londres : Methuen.
MATTINGLY, Hans. 2010. « Didactic Destiny » in Paul E. Kerry et Marylu Hill (eds.), Thomas Carlyle Resartus: Reappraising Carlyle's Contribution to the Philosophy of History, Political Theory, and Cultural Criticism. Madison : Fairleigh Dickinson University Press.
ODDIE, William. 2008. Chesterton and the Romance of Orthodoxy: The Making of GKC (1874-1908). Oxford : Oxford University Press.
THOMPSON, Andrew Stuart. 2000. Imperial Britain: The Empire in British Politics, c. 1880-1932. Harlow : Longman.
Pour citer cette ressource :
Charlotte Arnautou, G.K. Chesterton, penseur critique de la culture de masse ?, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2022. Consulté le 20/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/litterature/litterature-britannique/g-k-chesterton-penseur-critique-de-la-culture-de-masse



 Activer le mode zen
Activer le mode zen