Histoire de la révolution mexicaine
Jesús Silva Herzog, Histoire de la Révolution mexicaine, traduit de l'espagnol par Raquel Thiercelin-Mejías, postface de Felipe Ávila Espinosa, Lux Editeur, Montréal, 2009; coll "Mémoire des Amériques", 320 p.
Présentation de l'éditeur
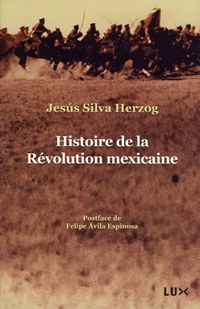 Au fil des pages de ce classique de la littérature mexicaine, Jesús Silva Herzog raconte, dans un style vif et enlevant, les principaux événements de la Révolution mexicaine (1910-1917), la première révolution sociale du xxe siècle. Oeuvre trépidante faisant une large part aux intrigues et aux retournements qui l'ont ponctué, Histoire de la Révolution mexicaine retrace les faits et gestes des grands personnages de l'époque que sont les dictateurs Porfirio Díaz et Victoriano Huerta et les chefs révolutionnaires Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa et Emiliano Zapata. L'historien porte une attention particulière aux problèmes économiques et sociaux, notamment le partage des terres et la répression des grèves, qui ont poussé des millions de paysans et d'ouvriers mexicains à la révolte.
Au fil des pages de ce classique de la littérature mexicaine, Jesús Silva Herzog raconte, dans un style vif et enlevant, les principaux événements de la Révolution mexicaine (1910-1917), la première révolution sociale du xxe siècle. Oeuvre trépidante faisant une large part aux intrigues et aux retournements qui l'ont ponctué, Histoire de la Révolution mexicaine retrace les faits et gestes des grands personnages de l'époque que sont les dictateurs Porfirio Díaz et Victoriano Huerta et les chefs révolutionnaires Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa et Emiliano Zapata. L'historien porte une attention particulière aux problèmes économiques et sociaux, notamment le partage des terres et la répression des grèves, qui ont poussé des millions de paysans et d'ouvriers mexicains à la révolte.
Lorsque la première édition de la Breve historia de la Revolución mexicana paraît à Mexico en 1960, son auteur, Jesús Silva Herzog , est l'une des figures les plus prestigieuses de l'intelligentsia mexicaine. Tour à tour ou simultanément "économiste, professeur, éditeur, journaliste, historien, fonctionnaire et homme d'état ; révolutionnaire, socialiste, et même chargé d'affaire en Union soviétique. Protagoniste décisif, primordial, dans la nationalisation du pétrole mexicain", pour reprendre les termes mêmes d'un article récent, Jesús Silva Herzog est au zénith d'une carrière aussi brillante que féconde. Homme des Lettres et homme public, sa vie, son oeuvre, son engagement sont indissolublement liés à l'histoire du Mexique révolutionnaire et postrévolutionnaire dont il embrassera toujours les justes causes. Pendant près de trois quarts de siècle, "don Jesús" a exercé une influence constante sur la vie de la nation mexicaine.
Au Mexique, la Breve historia de la Revolución mexicana, qui n'a cessé d'être rééditée, reste l'ouvrage de référence obligé pour tous ceux, professionnels ou simples curieux, qui s'intéressent à l'histoire de ce grand mouvement populaire, la première révolution prolétarienne et paysanne du XXe siècle.
Jesús Silva Herzog (1892-1985), a été un témoin actif de la Révolution mexicaine en tant que journaliste, puis secrétaire d'un chef révolutionnaire. Il est par la suite devenu un universitaire, un diplomate et un homme politique respecté et a notamment participé, en 1940, à la nationalisation du pétrole mexicain sous la présidence de Lázaro Cárdenas. Immense succès populaire, son Histoire de la Révolution mexicaine, publiée au Mexique pour la première fois en 1960, demeure encore aujourd'hui une œuvre incontournable.
Avant-propos
Avant-propos (p. 7-14) reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Lux.
Lorsque la première édition de la Breve historia de la Revolución Mexicana paraît à Mexico en 1960, son auteur, Jesús Silva Herzog, est l'une des figures les plus prestigieuses de l'intelligentsia mexicaine. Tour à tour ou simultanément « économiste, professeur, éditeur, journaliste, historien, fonctionnaire et homme d'État ; révolutionnaire, socialiste et même chargé d'affaires en Union Soviétique. Protagoniste décisif, primordial, dans la nationalisation du pétrole mexicain », pour reprendre les termes mêmes d'un article récent(1), Jesús Silva Herzog est au zénith d'une carrière aussi brillante que féconde. Homme de lettres et homme public, sa vie, son oeuvre, son engagement sont indissolublement liés à l'histoire du Mexique révolutionnaire et postrévolutionnaire dont il embrassera toujours les justes causes. Pendant près de trois quarts de siècle, « don Jesús » va exercer une influence constante sur la vie de la nation mexicaine.
Jesús Silva Herzog est né à San Luis Potosí en 1892, dans une famille de classe moyenne constituée d'artisans et de commerçants. Après des études secondaires au petit séminaire de San Luis Potosí, sa famille l'envoie poursuivre ses études aux États-Unis où elle a des parents. Il séjourne à New York de 1912 à 1914, entreprend, entre autres, des études d'économie à l'université et lit, en anglais et en espagnol, tous les grands classiques de la littérature européenne.
De retour au pays natal, Jesús Silva Herzog prend fait et cause pour la révolution qui a éclaté en 1910 et suit les péripéties des mouvements armés comme correspondant des journaux El Demócrata et Redención. En octobre 1914, assistant à la Convention d'Aguascalientes en tant qu'envoyé spécial et porte-parole du chef révolutionnaire Eulalio Gutiérrez, il est arrêté par des partisans de son adversaire, Venustiano Carranza, et emprisonné à San Luis Potosí. Condamné à mort par Carranza, le « Primer Jefe », il échappe de peu à l'exécution capitale mais restera de longs mois en prison. Ce n'est qu'en 1920, à la mort de Carranza, devenu entretemps président de la république, qu'il pourra gagner la capitale et s'y installer définitivement. Il se marie, et tout en poursuivant ses études, donne des cours d'anglais à l'École normale d'instituteurs, puis d'économie politique à l'École nationale d'agriculture, pour subvenir aux besoins du ménage. Il termine ses études d'économie et suit des cours d'histoire, d'histoire économique et de sociologie à l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM), où il sera bientôt lui-même professeur.
Au cours des années suivantes, Jesús Silva Herzog va développer une activité intense, enseigner dans diverses institutions, puis finalement à l'UNAM, publier plusieurs ouvrages et quantité d'articles. À partir de 1928 il fonde diverses institutions et organismes qui vont jouer un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et politique du pays : l'Instituto Mexicano de Investigaciones económicas qu'il va diriger pendant plusieurs années et la Revista Mexicana de Economía ; plus tard, en collaboration avec des Républicains espagnols exilés, il crée Cuadernos Americanos (1940), publication de renommée internationale dont il sera longtemps le principal et infatigable animateur ; il participera aussi à la création de la maison d'édition Fondo de Cultura Económica, au jour d'aujourd'hui toujours magistralement active.
En 1929 Jesús Silva Herzog est envoyé à Moscou comme ministre plénipotentiaire; il y rencontre les « artisans » de la Révolution d'octobre : Lounatcharski, Boukharine, Zinoviev, Kamenev... rend visite à Maïakovski peu de temps avant son suicide. Il étudie de près les aspects fondamentaux de l'organisation socialiste, lit les classiques de la doctrine communiste, mais il est vite déconcerté par l'expérience soviétique et demande à être remplacé. Rentré au Mexique au bout d'un an, il se tiendra farouchement en marge des orthodoxies sans jamais renier, bien au contraire, ses engagements d'homme de gauche(2).
Le principal titre de gloire de Jesús Silva Herzog est sans conteste d'avoir dirigé en 1937-1938, à la faveur d'un conflit salarial très dur opposant les ouvriers du pétrole aux grandes compagnies, et à la demande du président Lázaro Cárdenas, un important rapport approfondi et explosif concernant l'industrie pétrolière mexicaine. L'expropriation des compagnies étrangères par décret de la Cour Suprême de Justice en 1938, suivie de la nationalisation de l'industrie du pétrole mexicain en 1940, sont en grande partie le fruit du travail acharné de « don Jesús » et de son équipe d'experts et de techniciens.
Nommé professeur titulaire du Colegio Nacional (l'équivalent mexicain du Collège de France) en 1948 et membre de la Academia Mexicana de la Lengua dès 1956, Jesús Silva Herzog a reçu nombre de prix et de distinctions honorifiques. Considéré par ses compatriotes comme une des figures majeures du xxe siècle mexicain, sa mémoire continue d'être saluée et honorée comme le prouve l'hommage qui lui a été rendu en mars 2008 lors de la commémoration officielle des soixante-dix ans de la nationalisation du pétrole mexicain(3). Jesús Silva Herzog est mort à Mexico, en 1985, à l'âge de 93 ans(4), au terme d'une existence tout entière vouée à la construction de l'État mexicain moderne.
Parmi ses publications les plus importantes il convient de signaler les ouvrages suivants : Petróleos mexicanos. Historia de un problema (1941) ; El pensamiento económico en México (1947), El Agrarismo mexicano y la Reforma agraria (1959) et l'incontournable Breve historia de la Revolución Mexicana (1960).
« Montagnes de livres, infini des documents, bibliothèques d'histoire, la matière imprimée continue de s'accumuler », commentait l'historien Jean Meyer dans son ouvrage sur la Révolution mexicaine paru en 1973(5). Dans le même ordre d'idées, la bibliographie de la révolution mexicaine que j'ai sous la main, Bibliografía de la Revolución Mexicana 1959-1960(6), occupe trois volumes, qui comptent près de 800 pages, et contient au bas mot plus de 10 000 références. Depuis lors, études et monographies, tant en espagnol qu'en anglais, n'ont cessé de voir le jour.
Cependant, au Mexique, la Breve historia, qui n'a cessé d'être rééditée, reste l'ouvrage de référence obligé pour tous ceux, professionnels ou simples curieux, qui s'intéressent à l'histoire de ce grand mouvement populaire, la première révolution prolétarienne et paysanne du xxe siècle. Il y a à cela, à mon sens, plusieurs raisons.
La première est que l'histoire évènementielle que rapporte Jesús Silva Herzog est extrêmement précise et détaillée, et toujours étayée par une documentation rigoureuse; le récit circonstancié des combats, des mouvements de troupes, des affrontements idéologiques entre les différentes tendances, permet au lecteur de suivre pour ainsi dire pas à pas, au jour le jour, tous les avatars de ce formidable bouleversement social et politique. D'autre part, même s'il n'a jamais combattu les armes à la main(7), nous savons que l'auteur s'est trouvé au cœur de la mêlée comme partisan du chef Eulalio Gutiérrez, et les références répétées qu'il donne de sa présence sur le terrain (j'en ai comptabilisé une quinzaine dans le livre) donnent à cette dramatique saga une indéniable véracité.
Aussi peut-on aisément affirmer que Jesús Silva Herzog a su allier la rigueur et l'objectivité de l'historien à la réflexion du sociologue et au témoignage direct de l'observateur de terrain pour faire de sa Breve Historia un document incontournable.
En revanche, il peut nous sembler arbitraire que l'auteur ait choisi de mettre un point final à son travail en 1917, année de la proclamation de la Constitution de Querétaro, et, dans la foulée, de l'élection de Venustiano Carranza, Primer Jefe, comme président de la république. Pour Jesús Silva Herzog, la révolution est terminée et il ne reste plus qu'à mettre en oeuvre ses principes. Or rien n'était moins assuré, comme allaient le prouver les longues années de troubles et de conflits, toujours violents, souvent sanglants qui allaient se prolonger pendant de nombreuses années. En dépit de sérieuses avancées, la Révolution institutionnalisée allait connaître bien des déboires.
C'est une lutte sans merci : révoltes, pronunciamientos et assassinats vont se succéder jusqu'à la fin des années 1920. Engagés dans des combats fratricides pour le pouvoir et dans le but de voir triompher leurs idées, les principaux chefs révolutionnaires sont tour à tour portés au pinacle puis violemment éliminés. Les chefs de guerre paysans Zapata et Villa sont assassinés ; Carranza, le premier président constitutionnaliste, est assassiné en 1920, avant la fin de son mandat ; le général Obregón, qui lui succède, subira le même sort quelques années plus tard, après avoir été élu pour un deuxième mandat. Entre-temps un homme fort s'est imposé, le général Plutarco Elías Calles ; élu président du Mexique en 1924, il fonde le Parti national révolutionnaire (PNR) dont il sera le « Chef Suprême » autoproclamé. Plus qu'un parti politique proprement dit, le PNR est une structure destinée à mettre en œuvre et à garantir les acquis de la révolution, un système pyramidal qui fonctionne comme un parti unique et ouvre la voie à un populisme dont le plus pur représentant sera Lázaro Cárdenas. C'est sous la présidence de ce dernier (1934-1940), que le Mexique verra concrétisés les grands principes de la révolution : réforme agraire, nationalisation des ressources énergétiques, réorganisation des syndicats, grandes avancées en matière éducative et sociale. La plupart des historiens s'accordent à dire que c'est la période cardéniste qui clôt définitivement la Révolution mexicaine ; d'autres la prolongent jusqu'à la fin du siècle... Ce qui est sûr c'est que le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), héritier du PNR, va être une formation résolument hégémonique. Avec une majorité écrasante à la Chambre, il donnera jusqu'à la fin du siècle tous les présidents et pratiquement tous les gouverneurs des États ainsi que la grande majorité des cadres de la nation. Ceci jusqu'à la défaite du candidat priiste(8) Francisco Labastida, au profit du candidat de droite, Vicente Fox Quesada, le 2 juillet 2000.
Pleinement conscient du chemin qui restait à parcourir, Silva Herzog se voulait optimiste et terminait son livre sur une déclaration d'intention :
Le pays avait de nouveau un gouvernement constitutionnel, après quatre ans de luttes sanglantes au cours desquelles, à cause des combats, de la faim et d'une épidémie de typhus, avaient péri près d'un million de Mexicains. Pour rendre hommage à nos morts, pour commémorer dignement le cinquantenaire de la révolution, nous, révolutionnaires sincères et convaincus, et tous ceux d'entre nous qui occupons des fonctions gouvernementales, devrons lutter sans relâche pour que ses postulats fondamentaux soient effectivement appliqués. Et non seulement cela, mais aussi aller de l'avant, en accord avec la réalité du moment historique, en nous appuyant sur le progrès technique et sur les nouveaux courants de la pensée contemporaine. Le but immédiat et urgent, qu'il faut atteindre sans délai et sans ménager nos efforts, comme nous l'avons dit et redit à satiété dans d'autres ouvrages, et depuis des années, est d'en finir une fois pour toutes avec la misère, l'ignorance et la maladie qui affectent les masses populaires de notre pays. Aujourd'hui encore, après un demi-siècle, et malgré les progrès qui ont été faits sur le plan économique et social, aujourd'hui encore, des millions de Mexicains ont faim de pain et soif de terres, de justice et de liberté. – Ce ne sont pas là de vaines paroles, ni le désir de faire de belles phrases. La faim est une réalité, car 60% des habitants de notre pays ont une alimentation insuffisante et inadaptée ; le manque de terres est une réalité, puisque des milliers de paysans n'en ont pas et n'ont pas le droit d'en avoir ; la soif de justice existe dans un pays où la plus grande partie du revenu national est répartie entre une minorité de privilégiés ou de semi-privilégiés ; la soif de liberté tenaille tous ceux qui n'ont pas un bien-être économique suffisant pour occuper dans la société un rang honorable.Cependant, nous ne sommes pas pessimistes. Pendant longtemps, le problème fondamental du Mexique a été de parvenir à connaître ses vrais problèmes. Aujourd'hui du moins les connaissons-nous, et par conséquent nous connaissons aussi les moyens de les résoudre. Pour y arriver, nous devons travailler avec acharnement et droiture et aimer le Mexique d'un amour profond et désintéressé.
¿ Adónde va México ? Où va le Mexique ? se demandait en 1968, peu de temps avant les dramatiques évènements de la Place des Trois cultures(9), l'écrivain et député mexicain Antonio Castro Leal(10) ; où va le Mexique ? Oui, telle est la question que légitimement on peut encore se poser aujourd'hui... Au terme de cette brève présentation, je me dois de signaler le plus étonnant des paradoxes. En effet, à l'inverse de l'intérêt constant et sans répit porté en Amérique à un événement, devenu, pour ainsi dire, emblématique de la nation mexicaine, face à l'image d'une saga qui a fait le tour du monde par le nombre de productions cinématographiques qu'elle a inspirées(11), et face, surtout, à la cette pléthorique montagne de documents en tous genres et de tous bords qu'elle a provoqués, la Révolution mexicaine ne semble pas avoir suscité beaucoup d'intérêt parmi les historiographes francophones. Dans ces conditions, il va sans dire que la réédition de l'ouvrage de Jesús Silva Herzog par l'éditeur montréalais Lux vient à point nommé pour combler un vide notoire en permettant au lecteur francophone de se familiariser avec l'histoire du Mexique contemporain, initiative dont très sincèrement nous nous félicitons.
Raquel Thiercelin-Mejías, Maître de conférences honoraire à l'Université d'Aix-Marseille
Notes
(1) Ismael Carvallo Robledo, «Homenaje a Jesús Silva Herzog (1892-1985) con motivo de los 70 años de nacionalización del petróleo en México », El Catoblepas, no 73, mars 2008, p. 6.
(2) « Je suis devenu de gauche quand j'ai rejoint la brigade du Général Eulalio Gutiérrez à l'âge de 21 ans à San Luis Potosí en cette lointaine année 1914 ; et j'ai continué à être de gauche, je ne l'ai jamais nié, et je vais continuer à être de gauche ; ce qui se passe c'est que plus je vieillis plus je suis de gauche. » Ibid., p. 19.
(3) Ibid.
(4) J'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer à plusieurs reprises le grand « don Jesús » - comme l'appelait familièrement son entourage, suivant la coutume espagnole -, au début des années 1970, à Mexico. Il était déjà fort âgé et pratiquement aveugle, mais n'avait rien perdu de sa faconde, de sa lucidité, de sa combativité de militant et d'homme de gauche. Raquel Thiercelin, «Mexico y los medios de información. Entrevista con don Jesús Silva Herzog », dans Hommage à André Joucla Ruau, Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1974, p. 215-220.
(5) Jean Meyer, La Révolution mexicaine, Paris, Calman-Lévy, 1973, p. 313.
(6) Editée par Roberto Ramos, 2e édition, Publications du ministère de l'Instruction publique, Mexico, 1959-1960.
(7) Jesús Silva Herzog souffrait dès sa naissance d'une grave maladie de la rétine qui le rendait mal voyant ; il ne voyait pratiquement que d'un oeil et devint complètement aveugle à la fin des années 1960.
(8) Priiste : Du PRI; le Parti révolutionnaire institutionnel. [nde]
(9) Également nommé Place de Tlatelolco, ce lieu hautement symbolique de la nation mexicaine est une place de dimensions moyennes flanquée sur trois côtés d'une pyramide aztèque, d'une église baroque et d'un édifice moderne siège d'un lycée professionnel. À la fin d'un été de manifestations estudiantines sévèrement réprimées, le 2 octobre 1968, dix jours avant l'inauguration des Jeux olympiques de Mexico, l'armée réprima violemment un meeting rassemblant plus de dix mille personnes dans cette place transformée en souricière. Il y eut entre 300 et 500 morts, des milliers d'arrestations, de nombreux disparus. Pour en savoir plus, cf. Elena Poniatowska, La Noche de Tlatelolco, Mexico, Ed. Era, 1971.
(10) ¿ Adónde va México ? Reflexiones sobre nuestra historia contemporánea, México, Porrúa, 1968.
(11) Le lecteur trouvera, p. 303, une filmographie de la Révolution mexicaine et, p. 301, une bibliographie. [nde]
Chapitre 5
Extrait du chapitre 5 qui relate les soulèvements armés et le triomphe de Madero (p.93-111), reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Lux.
Le 24 juin 1908, Benito Ibarra suivi de quelques hommes s'était soulevé contre le gouvernement de don Porfirio à Viesca (Coahuila). Le surlendemain, c'était le tour de P. Araujo à Las Vacas, dans le même État. Mais le mouvement le plus important fut celui qui éclata à Palomas (Chihuahua) le 1er juillet, à l'instigation de Enrique Flores Magón, José Inés Salazar, Praxedis Guerrero et Francisco Manrique. Tous ces mouvements armés obéissaient aux plans du Parti libéral mexicain et s'appuyaient sur les principes du Plan de Saint Louis Missouri. Mais ils étaient prématurés, le pays n'étant pas encore prêt pour faire la révolution, et ils avaient été très rapidement étouffés par les troupes gouvernementales.
Deux ans plus tard, le 4 juin 1910, la ville de Valladolid dans le Yucatán fut le théâtre de très graves incidents. Ne voulant plus supporter l'arbitraire et les mauvais traitements du chef politique Luis Felipe Regil, les habitants s'emparèrent de la ville sous la conduite de Miguel R. Ponce et Claudio Alcocer et assassinèrent le commissaire Regil. Le gouvernement fut obligé d'envoyer de grands renforts de troupes pour reprendre la ville en main, après un violent combat.
Vers le milieu de l'année 1910, Gabriel Leyva se souleva également dans l'État de Sinaloa, mais la lutte pour la conquête de la liberté ne fut que de courte durée. Vaincu par les troupes fédérales, il fut immédiatement passé par les armes.
Tous ces événements mettent en relief le mécontentement croissant qui régnait dans le pays aux alentours de 1910. Le célèbre écrivain Blas Urrea en explique ainsi les raisons profondes :
Le « caciquismo(1) », c'est-à-dire la pression despotique exercée par les autorités locales en contact avec les classes populaires et qui se fait sentir par le truchement du contingent, de l'emprisonnement arbitraire, de la loi sur le délit de fuite et par d'autres moyens de pression et de limitations de la liberté du travail.
Le « peonismo », c'est-à-dire l'esclavage de fait, ou le servage de type féodal, qui est la condition générale du péon à la journée, principalement lorsqu'il est embauché de force ou déporté dans le sud-est du pays, situation qui subsiste en raison des privilèges économiques, politiques et sociaux dont jouissent les grands propriétaires terriens.
Le « fabriquismo », c'est-à-dire l'asservissement individuel auquel sont soumis les ouvriers d'usine en raison de la situation privilégiée dont se prévalent les patrons, tant dans le domaine politique que dans celui de l'économie, comme conséquence de la protection systématique dont on a cru nécessaire de faire bénéficier l'industrie nationale.
L'« hacendismo », c'est-à-dire la pression économique qu'exerce la grande propriété sur la petite ou moyenne à la faveur des inégalités fiscales et d'une infinité de privilèges, et qui ont pour conséquence l'absorption constante de la petite propriété rurale par la grande exploitation.
Le « cientificismo », c'est-à-dire le cumul commercial et financier et la concurrence déloyale des grandes entreprises vis-à-vis des petites, en conséquence de la protection officielle ou de l'influence politique que peuvent avoir les premières dans les hautes sphères gouvernementales.
L' « extranjerismo », c'est-à-dire la prédominance ou la concurrence déloyale que peuvent exercer les étrangers au détriment des ressortissants mexicains, et ce dans toutes les branches de l'économie du pays, en raison de leur situation privilégiée, de la protection démesurée qu'ils reçoivent des autorités nationales et de l'appui dont ils bénéficient de la part de leurs représentants diplomatiques.
Blas Urrea avait assez nettement conscience des problèmes qui agitaient le pays et sentait combien il était urgent d'y apporter une solution. Le gouvernement porfiriste, par contre, ne se rendait pas compte de la situation, ne connaissait pas la réalité des faits. La révolution était inévitable.
Aussitôt imprimé, le Plan de San Luis fut expédié par la poste de San Antonio (Texas) aux quatre coins du Mexique et aux plus fervents partisans de Francisco I. Madero, prêts à organiser un mouvement armé destiné à renverser le régime porfiriste. Le gouvernement eut bientôt connaissance des projets de sédition de Madero et de ses amis et commença à prendre des mesures et à surveiller de plus près les partisans de l'anti-réélectionnisme les plus en vue. Le 13 novembre, certains madéristes connus furent arrêtés dans la capitale. Cependant, à partir de la mi-octobre, de nombreux partisans se rendaient à San Antonio pour recevoir les instructions de Madero et les transmettre aux différents points du territoire afin d'y organiser la lutte armée. À cette époque, fin octobre, début novembre, d'après ce qu'a rapporté plus tard Roque Estrada, Madero et ses amis étaient pleins d'optimisme quant au succès de la révolution. Madero lui-même pensait que deux semaines lui suffiraient pour remporter la victoire sur l'ensemble du territoire national.
Le 18 novembre, deux jours avant la date prévue par le Plan de San Luis pour le soulèvement général, de graves événements se déroulèrent dans la ville de Puebla. Le chef de la police, Miguel Cabrera, se présenta en compagnie de plusieurs policiers au domicile d'Aquiles Serdán, l'un des madéristes les plus connus et les plus éminents. Revolver au point, Cabrera voulut pénétrer dans la maison pour la fouiller car il avait été averti de l'existence d'un important dépôt d'armes et de munitions. Cela étant vrai, et se sentant sérieusement compromis puisqu'il était décidé à se soulever le 20, pensant qu'il ne lui restait aucune autre issue possible, Aquiles Serdán estima que la lutte devait commencer sur-le-champ. Il affronta Cabrera fusil en main et le tua d'une balle en plein front. Un véritable combat s'engagea alors qui dura près de quatre heures. Un bataillon entier attaqua la maison de Serdán défendue par une poignée d'hommes courageux. On raconta que même les femmes participèrent à la lutte, rechargeant les armes et encourageant les combattants. Finalement, les munitions s'épuisèrent et les défenseurs durent se rendre. Lorsque les soldats pénétrèrent dans la maison, en prenant toutes sortes de précautions, ils n'y trouvèrent que des femmes ; tous les hommes avaient été tués, mais le maître de maison ne se trouvait pas parmi les cadavres. À l'aube, lorsque Aquiles Serdán quitta sa cachette creusée sous le sol de la maison, il fut assassiné par le soldat qui montait la garde dans la pièce. Ainsi débutait, par un combat héroïque en plein coeur du pays, la Révolution mexicaine.
Dans l'ouvrage de López Portillo y Rojas intitulé Elevación y caída de Porfirio Díaz, on peut lire : « Le 20 novembre, il sembla que le peuple mexicain ne répondait pas à l'appel de Madero. Cette première désillusion déprima profondément la famille (Madero) qui pensa que tout était perdu et qui alla même jusqu'à décider que Francisco I. Madero devait partir pour Cuba ; les officiers qui entouraient Madero furent congédiés. » La vérité est que la nouvelle des soulèvements de Chihuahua ne parvint à San Antonio où s'était réfugié le chef révolutionnaire que les premiers jours de décembre. L'optimisme revint immédiatement, et les ressources de la plupart des riches parents de Madero furent investies dans l'aventure révolutionnaire. Aussitôt, de nouvelles expéditions furent organisées ainsi que des achats d'armes et de munitions grâce à la complicité des autorités nord-américaines qui ne voyaient plus d'un bon oeil le gouvernement de don Porfirio. En effet, ce dernier ne se montrait plus très docile aux voeux de la Maison Blanche.
Ce fut Abraham González qui organisa les soulèvements armés de Chihuahua. Le 20 novembre, Pascual Orozco se souleva à San Isidro, José de la Luz Blanco à Santo Tomás, Francisco Villa à San Andrés, tout près de la capitale de l'État ; et le lendemain, Guillermo Baca s'emparait de l'importante localité de Parral qu'il dut abandonner le surlendemain en raison de la supériorité des forces fédérales envoyées pour reprendre la ville. D'autres soulèvements de moindre envergure eurent encore lieu dans les États de Coahuila et de Durango.
Au début, les chefs révolutionnaires, qui étaient inconnus et ne jouissaient d'aucun prestige dans le pays, n'étaient suivis que de quelques hommes et le gouvernement pensa qu'il en viendrait aisément et rapidement à bout, comme cela s'était déjà produit ; mais cette fois les événements allaient se dérouler de manière différente, car les conditions sociales étaient désormais favorables au mouvement révolutionnaire. Les petits groupes armés de Pascual Orozco, José de la Luz Blanco, Francisco Villa et autres s'accrurent de jour en jour grâce à l'incorporation d'habiles cavaliers et d'excellents tireurs et finirent par former de véritables escadrons, mettant très souvent en déroute les troupes régulières. Les premières victoires révolutionnaires importantes furent celles de Pedernales, de Mal Paso et de Ciudad Guerrero. À Mal Paso, un cavalier orozquiste pénétra dans le camp ennemi au plus fort de la mêlée et réussit à prendre au lasso une mitrailleuse qui fut la première dont disposèrent les insurgés. En janvier et février 1911, d'autres soulèvements eurent lieu dans plusieurs points du pays. Ainsi, Luis Moya prit les armes dans les environs de Nieves (Zacatecas), mais fut tué, après une courte mais brillante carrière, au cours de l'attaque de la ville de Sombrerete.
Le président étant malade, la campagne contre les insurgés de Chihuahua était dirigée depuis Mexico par le fils du dictateur, le lieutenant-colonel Porfirio Díaz, aidé de ses amis, des militaires du même grade que lui ou de grade inférieur, qui manquaient d'expérience et de connaissances du terrain sur lequel se déroulaient les opérations. Il est certain que le commandement commit de nombreuses erreurs que les guérilleros révolutionnaires mirent immédiatement à profit.
Don Francisco I. Madero pénétra en territoire national non loin de Ciudad Juárez, en compagnie de quelques-uns de ses partisans, le 14 février. La nouvelle se propagea rapidement, provoquant une grande animation et donnant aux rebelles un nouvel enthousiasme. Quelques semaines plus tard, le 6 mars exactement, Madero attaqua avec le meilleur de ses troupes l'importante localité de Casas Grandes qui aurait pu être occupée sans l'arrivée de nouveaux renforts gouvernementaux aux ordres du général Samuel García Cuéllar. Les révolutionnaires essuyèrent là leur première défaite. Madero fut sur le point d'être fait prisonnier, mais réussit cependant à se retirer en bon ordre avec le reste de ses troupes. Le général García Cuéllar, blessé à la main, dut subir une amputation mais refusa de laisser le commandement à son second, le colonel Eguía Liz, ce qui provoqua de longues discussions et causa d'énormes pertes de temps. Ramón Prida estime que s'il en avait été autrement, si Madero était tombé entre les mains des fédéraux, la défaite des insurgés aurait été totale ce jour-là et la révolution aurait peut-être échoué. Personnellement, nous ne partageons pas l'opinion de M. Prida. Certes tout ce qu'il suppute aurait effectivement pu se produire, mais même dans le cas extrême de l'exécution de Madero la révolution n'en serait pas restée là ; même si le détail des événements avait été différent, le cours de l'histoire n'aurait pas été modifié dans ce qu'il avait de fondamental. Chaque fois que les structures sociales d'un peuple connaissent un déséquilibre profond, ce qui était précisément le cas du Mexique, elles sécrètent par ailleurs des forces tendant à rétablir l'équilibre perdu. Dans ces conditions, le chef est toujours secondaire et, s'il vient à périr au combat, un autre se lève immédiatement pour occuper sa place.
Un épisode qui ne doit pas passer inaperçu dans cet ouvrage fut l'invasion de la Basse-Californie, vers la fin janvier 1911, par un groupe de Mexicains, d'Américains et de personnes de diverses nationalités dirigés par Ricardo et Enrique FloresMagón. Ce mouvement n'avait aucune relation avec les mouvements madéristes de Chihuahua ou d'autres États ; il était absolument indépendant et obéissait à des idéaux de profonde transformation sociale. Un grand nombre de citoyens, qu'ils fussent partisans du gouvernement ou révolutionnaires madéristes, s'émurent à l'annonce de la prise de Mexicali par ceux que l'on appela les magonistas, redoutant l'intervention des États-Unis. Les magonistes s'emparèrent également de Tijuana, mais ils furent complètement défaits quelques jours plus tard par les troupes de Celso Vega, chef politique de La Ensenada. D'après nos informations, il est inexact de penser que les frères Flores Magón voulaient fonder une république indépendante en Basse-Californie, comme l'annoncèrent à l'époque certains journaux et plus tard des écrivains mal informés. Les Flores Magón s'étaient lancés dans la lutte poussés par les principes de l'anarchisme international dont ils voulaient faire les bases de la réorganisation économique, sociale et politique du Mexique.
Par ailleurs, 20 000 soldats américains furent envoyés à la frontière nord du Mexique. Le gouvernement de Díaz demanda le retrait des troupes, mais Washington n'en fit rien et donna le fallacieux prétexte qu'il s'agissait uniquement de manœuvres périodiques normales.
L'attitude des États-Unis eut une énorme influence aussi bien sur les porfiristes que sur les révolutionnaires et explique en partie le déroulement des événements ultérieurs. Le souvenir de 1847, l'ombre tragique des États-Unis se projetaient une fois de plus sur le territoire du Mexique, sur le coeur d'un peuple en lutte pour conquérir un peu de pain et un peu de liberté(2).
Au cours du mois de mars, Torres Burgos et les frères Zapata se lancent dans la lutte dans l'État de Morelos. Le premier meurt au début de la campagne. À Guerrero, d'autres hommes se préparent pour la lutte armée : Ambrosio Figueroa, Juan Andrew Almazán et José I. Lugo. Ailleurs aussi, il y a des ferments révolutionnaires. L'armée fédérale n'a plus le temps de lutter contre tant de foyers de sédition et la situation militaire du gouvernement empire de jour en jour. Le 16 mars, le gouvernement Díaz lance un décret suspendant toutes les garanties individuelles sur l'ensemble du territoire. Cependant qu'à New York, à son retour d'Europe, M. José Ives Limantour, ministre des Finances du régime porfiriste, s'entretient avec le docteur Vázquez Gómez, Venustiano Carranza et quelques-uns des membres de la famille Madero. Nul n'ignore que Limantour était l'homme le plus influent du gouvernement Díaz. L'objet de ces conversations n'était autre que d'échanger des impressions sur les moyens de rétablir la paix. Aussi bien Limantour que les partisans du parti adverse, tous craignaient une intervention armée des États-Unis. Il fallait rétablir la paix à tout prix ; il fallait assurer l'intégrité du territoire et la souveraineté de la république. De sorte qu'une psychose pacifiste commença à gagner bon nombre des principaux membres du gouvernement et de la révolution.
Tout semble indiquer que, vers le milieu du mois de mars, ni Madero ni les Vázquez Gómez ne jugeaient indispensable que le vieux dictateur renonçât au pouvoir pour rétablir la paix. En échange, d'après Manuel Calero, pour lui comme pour beaucoup d'autres, Limantour était arrivé à Mexico en mars 1911 avec la ferme intention de sacrifier le général Díaz. De toutes façons, il est certain que la présence du ministre des Finances se fit bientôt sentir dans la capitale. Devant la gravité de la situation, le général Díaz, vieux et malade - il venait d'avoir quatre-vingts ans -, se laissa guider par son ministre. « Le président, toujours selon Calero, n'était plus tout à fait conscient de ses actes. » Et il ajoute que « l'attitude de Limantour ne fut pas seulement maladroite, mais perfide ». Tous s'accordent à dire que, dès son retour d'Europe, Limantour avait abandonné à son sort le groupe científico dont il avait été le chef pendant de longues années, et qu'en ces moments dramatiques la plupart de ses actes semblaient obscurs et inexplicables, même à ses meilleurs amis. Cet éloignement du ministre des Finances s'explique peut-être par les engagements qu'il avait pris à Paris avec un des ennemis les plus acharnés du groupe des technocrates, le général Bernardo Reyes.
Le 24 mars, le général Díaz procéda à un important remaniement ministériel, très probablement dans le but de faciliter les négociations de paix prévues et sur le conseil de Limantour. Sous le poids des ans, le vieux lion avait perdu beaucoup de sa bravoure et de son assurance. Le nouveau cabinet fut ainsi constitué : Affaires étrangères, Francisco León de la Barra ; Intérieur, Miguel Macedo avec la fonction de sous-secrétaire chef de cabinet ; Justice, Demetrio Sodi ; Instruction publique, Jorge Vera Estañol ; Agriculture, Manuel Marroquín y Rivera ; Communications, Roberto Rodríguez ; les Finances et la Guerre gardaient les mêmes titulaires, respectivement Limantour et González Cosío. Les hommes nouveaux n'étaient pas toujours supérieurs aux anciens. Dans certains cas, ils étaient nettement inférieurs, comme à l'Instruction publique par exemple. Entre Justo Sierra et l'avocat Vera Estañol, il y avait un abîme en faveur du premier. Cela est encore plus net aujourd'hui, car la personnalité de l'un n'a fait que croître, tandis que celle de l'autre est devenue insignifiante au regard de notre culture nationale. Or Sierra avait eu des difficultés et de très âpres discussions avec le ministre des Finances au sujet du budget de l'éducation nationale. L'éducateur et l'économiste ne pouvaient pas s'entendre, car ils avaient des idées diamétralement opposées sur les problèmes fondamentaux du pays. Limantour estimait que les investissements étrangers allaient apporter le bien-être au Mexique, Sierra pensait au contraire que de tels investissements étaient très dangereux et qu'ils risquaient, à la longue, de compromettre l'indépendance. Limantour vit là une opportunité de se débarrasser d'un collègue gênant, dangereux, indésirable.
Quant au vieux général Cosío, il resta à la tête du ministère de la Guerre et de la Marine uniquement parce que don Porfirio refusa à la dernière minute le général Bernardo Reyes qui avait été proposé par Limantour. Reyes et Limantour, anciens adversaires politiques, s'étaient réconciliés lors de leurs rencontres dans la capitale française. Le président Díaz accepta par contre que Reyes, rappelé d'Europe, fût chargé de la campagne contre les révolutionnaires. On le rappela donc par câble, mais comme les événements se précipitaient, on lui demanda d'attendre à La Havane jusqu'à nouvel ordre. Lorsque Reyes foula le sol mexicain, la révolution avait triomphé.
Le 1er avril, accompagné des membres de son nouveau cabinet, le général Díaz alla lire son rapport devant le Congrès de l'Union. Le plus important, le plus sensationnel même, fut l'annonce d'un projet de loi qui devait être soumis aux Chambres pour rendre effectif le suffrage et établir le principe de la non-réélection. Par cette mesure, le général Díaz essayait d'arracher aux révolutionnaires leur bannière de combat. Mais il était sans doute trop tard. Don Porfirio avait perdu la confiance de la nation et les effets d'une telle mesure furent absolument contraires à ce qu'attendaient ses plus proches conseillers et lui-même. L'activité révolutionnaire se poursuivait sans trêve, remportait de nouveaux succès, animée d'un plus grand courage et d'une plus ferme volonté.
Dès le début avril, des pourparlers de paix eurent lieu entre Oscar Braniff et Toribio Esquivel Obregón et les personnalités les plus marquantes de la famille Madero. Esquivel Obregón et Braniff affirmaient qu'ils agissaient pour leur propre compte, sans aucune représentation officielle. Mais cela était faux, car ils avaient été envoyés par le ministre Limantour. Le docteur Vázquez Gómez soutenait que les pourparlers de paix ne devaient être entrepris qu'en présence des représentants du gouvernement dûment accrédités, ce qui permettrait d'obtenir des États-Unis la reconnaissance de la belligérance, quelque chose comme la légitimité sur le plan international du mouvement révolutionnaire.
Cependant, Madero réunit tous ses éléments de combat et se dirige vers la ville frontière de Ciudad Juárez dans le but de la prendre d'assaut. Il a avec lui les troupes de Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco, Marcelo Caraveo, José Inés Salazar, Emilio Campa et un certain José Garibaldi, descendant à ce que l'on disait alors du grand héros italien. Au total près de trois mille hommes. Voilà qui inquiète aussi bien le gouvernement porfiriste que le docteur Vázquez Gómez et d'autres révolutionnaires. Toujours pour la même raison : la peur de nos puissants voisins. Il nous faut rappeler ici les paroles de quelqu'un que nous n'avons pas réussi à identifier : « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ! »
Les forces révolutionnaires arrivent près de Ciudad Juárez. Francisco I. Madero, d'une part, et le général Juan Navarro, défenseur de la place, d'autre part, décident de signer un armistice. Les négociations de paix sont immédiatement entreprises. Le gouvernement du général Díaz désigne comme représentant le licencié(3) Francisco Carvajal, et le chef de la révolution envoie le docteur Vázquez Gómez, le licencié José María Pino Suárez et Francisco Madero père. Au bout de quelques jours, les négociations échouent. L'armistice prend fin le 6 mai.
Nous ne sommes pas les seuls à penser que le chef de la révolution avait toujours éprouvé une grande sympathie à l'égard de Limantour, qu'il jugeait irremplaçable à la tête du ministère des Finances. De plus, au début des conversations, Madero ne considérait pas la démission de Díaz comme indispensable. Mais Vázquez Gómez était d'une opinion contraire, à son avis la paix ne pouvait être signée sans que l'autocrate renonçât au pouvoir et sans que don José Ives Limantour fût définitivement écarté du gouvernement. L'opinion de Vázquez Gómez prévalut et les négociations furent rompues. Le 7 mai, le général Porfirio Díaz adressa un manifeste au peuple mexicain dont le premier paragraphe disait :
La rébellion qui a éclaté en novembre dernier dans l'État de Chihuahua, et qui n'a pu être écrasée à temps en raison des difficultés du terrain, a stimulé dans d'autres régions de la république les tendances anarchiques et l'esprit d'aventure toujours latents dans certaines couches sociales de notre peuple. Le gouvernement que je préside s'est employé, comme il était de son devoir, à combattre dans l'ordre militaire ce mouvement armé, et dans l'ordre politique le président de la république dans son rapport au Congrès de l'Union le 1er avril dernier a déclaré au pays tout entier et au monde civilisé qu'il avait l'intention d'entrer dans une ère de réformes politiques et administratives souscrivant ainsi aux justes et opportunes demandes de l'opinion publique. Il est évident et notoire que le gouvernement, rejetant le grief qui lui est fait de ne pas agir spontanément, mais sous la pression de la rébellion, est définitivement entré dans la voie des réformes promises.
Le gouvernement de Porfirio Díaz se rendait bien tardivement compte de certaines des nécessités et des aspirations du peuple mexicain, qui auraient dû être satisfaites bien des années plus tôt afin d'éviter la guerre civile et ses lamentables conséquences de mort et de destruction.
Les deux derniers paragraphes du manifeste déclarent :
Le président de la république, qui a la douleur de s'adresser au peuple en ces moments solennels, abandonnera il est vrai le pouvoir, mais comme il convient à une nation qui se respecte, comme il sied à un mandataire qui, s'il a pu commettre des erreurs, a par contre été capable de défendre sa patrie et de la servir avec loyauté.
L'échec des pourparlers de paix aura pour conséquence une recrudescence de l'activité révolutionnaire. Pour sa part, le gouvernement redoublera ses efforts, comptant sur la loyauté de notre héroïque armée, pour soumettre la rébellion et la faire rentrer dans l'ordre ; mais pour conjurer de manière rapide et efficace les périls imminents qui menacent notre régime social et notre autonomie nationale, le gouvernement a besoin du patriotisme et de l'effort généreux du peuple mexicain : il compte sur lui et il est sûr, avec son aide, de sauver la patrie.
De sorte que le 7 mai 1911, le fait mérite d'être souligné, le général Díaz annonçait au pays qu'il laisserait le pouvoir quand sa conscience lui dirait de le faire et que, devant l'échec des négociations de Ciudad Juárez, le gouvernement allait redoubler ses efforts pour combattre les rebelles et les soumettre. Mais pour y parvenir et pour sauver la patrie du péril qui menaçait le régime social et l'autonomie de la nation, c'est-à-dire l'anarchie et l'intervention étrangère, le vieux caudillo réclamait l'aide généreuse et décidée du peuple mexicain ; à l'heure du danger, il réclamait l'aide généreuse et décidée d'un peuple auquel lui, Porfirio Díaz, n'avait pas souvent pensé depuis un quart de siècle.
À la fin de l'armistice qui avait été conclu entre don Francisco I. Madero et le général Navarro sans qu'il eût été possible de parvenir à aucun accord, les troupes révolutionnaires entouraient Ciudad Juárez et se trouvaient en plusieurs points à une portée de fusil des défenseurs de la place. De temps à autre, les soldats du gouvernement et les madéristes s'invectivaient et se lançaient des injures. Ce qui se produisit précisément le 8 mai. Le ton monta et des coups de feu retentirent. La fusillade se généralisa et se transforma bientôt en une violente attaque qui partait de tous les horizons de la ville frontière. Personne ne fut capable d'arrêter l'élan des soldats de l'un et l'autre camp. Après trois jours de violents combats, Ciudad Juárez tomba aux mains des révolutionnaires.
Immédiatement après avoir occupé la place et résolu les problèmes les plus urgents, Madero en tant que président provisoire nomma membres de son cabinet les personnes suivantes : Affaires étrangères, le docteur Francisco Vázquez Gómez ; Intérieur, Federico González Garza ; Justice, José María Pino Suárez ; Communications, l'ingénieur Manuel Bonilla ; Guerre et Marine, Venustiano Carranza.
Le général Juan Navarro, qui, au cours de la campagne contre les révolutionnaires, avait fait preuve d'une grande cruauté en faisant fusiller les prisonniers en mainte occasion, était à bon droit détesté par les troupes d'Orozco, de Villa et des autres chefs madéristes. Lorsqu'il fut fait prisonnier, Villa et Orozco voulurent le passer par les armes, mais Madero s'y opposa, lui sauva la vie au péril de la sienne et l'accompagna personnellement de l'autre côté de la frontière. Cet acte de générosité mécontenta fort les autres chefs de la révolution, à tel point qu'Orozco et quelques autres pensèrent se révolter contre Madero. Dès qu'il l'apprit, ce dernier se dirigea vers l'endroit où se trouvaient les présumés rebelles, adressa aux troupes un éloquent discours et le péril fut conjuré. De tels actes de générosité et de courage de la part de Madero étaient repris par les journaux de la capitale, principalement par El País, quotidien catholique dirigé par le polémiste Trinidad Sánchez, et augmentaient de manière surprenante la popularité du chef de la révolution. Le courage et la bonté sont des vertus qui émeuvent et passionnent toujours les peuples.
La victoire de Madero à Ciudad Juárez eut une influence considérable sur les événements ultérieurs. L'opinion publique pencha définitivement pour Madero et chaque jour de nouveaux groupes armés surgissaient de différents points du pays. Le docteur Francisco Vázquez Gómez, qui s'était opposé à l'attaque de Ciudad Juárez de peur d'une intervention des États-Unis, écrit dans ses Memorias políticas : « Il faut convenir que la prise de Ciudad Juárez sans incident international contribua énormément au triomphe de la révolution ; davantage par son influence morale, qui fut décisive, que par son importance militaire. » Et Ramón Prida, membre du groupe des científicos, commente l'événement en ces termes dans son ouvrage De la dictatura a la anarquía : « La chute de Ciudad Juárez donna le coup de grâce au gouvernement du général Díaz. Par une seule victoire, par la prise d'une seule ville sans importance, la révolution commencée en novembre 1910 avait triomphé. Ce n'étaient pas les armes qui avaient vaincu, c'était l'opinion publique. » Quelques jours après la chute de Ciudad Juárez, un nouvel armistice était conclu entre le gouvernement de don Porfirio et la révolution. Les mêmes plénipotentiaires furent désignés et les conversations reprirent.
Le radicalisme et l'intransigeance de Vázquez Gómez l'emportèrent enfin sur les opinions modérées de la famille Madero et du chef de la révolution. Ces derniers ne voyaient pas d'inconvénient à ce que le général Díaz et son ministre des Finances demeurent au pouvoir, alors que le premier estimait indispensable leur départ afin de garantir les idéaux pour lesquels on avait lutté au prix de tant de destructions et de tant de vies humaines.
Dans la nuit du 21 mai, un accord fut conclu dans l'hôtel des Douanes de Ciudad Juárez, dans les termes suivants :
Le 21 mai 1911, Messieurs Francisco Carvajal, représentant le gouvernement du général don Porfirio Díaz d'une part ; don Francisco Vázquez Gómez, don Francisco Madero et le licencié don José María Pino Suárez, représentants de la révolution d'autre part, réunis à Ciudad Juárez à l'hôtel des Douanes dans le but de parvenir à un accord pour faire cesser les hostilités sur l'ensemble du territoire national et considérant :
Premièrement. Que le général Porfirio Díaz a manifesté sa décision de renoncer à la présidence de la république avant la fin du mois en cours ;
Deuxièmement. Que des assurances ont été données, à savoir que Monsieur Ramón Corral renoncerait également à la viceprésidence dans les mêmes délais ;
Troisièmement. Qu'aux termes de la loi, le licencié don Francisco L. de la Barra, actuellement ministre des Affaires étrangères du gouvernement du général Díaz, sera provisoirement chargé du pouvoir exécutif de la nation et convoquera des élections générales dans les règles de la constitution ;
Quatrièmement. Que le nouveau gouvernement étudiera les aspirations actuelles de l'opinion publique afin d'y satisfaire dans chaque État dans les normes de la Constitution, et qu'il prendra les résolutions nécessaires à l'indemnisation des préjudices directement causés par la révolution.
Les deux parties en présence dans cette conférence sont convenues de signer le présent accord
Paragraphe unique. À dater d'aujourd'hui et dans tout le territoire de la république, les hostilités cesseront entre les forces du gouvernement du général Díaz et celles de la révolution ; ces dernières devant être licenciées à mesure que seront prises dans chaque État les dispositions nécessaires au rétablissement et à la garantie de la paix et de l'ordre public.Clause transitoire. Les travaux de reconstruction ou de réparation des voies télégraphiques et ferrées dont le fonctionnement se trouve interrompu seront immédiatement entrepris.
Cet accord est signé en double exemplaire.
Il est clair que l'accord fut une transaction entre le gouvernement et la révolution étant donné que Madero ne prétendait plus être nommé président provisoire de la république.
BIas Urrea, qui connaissait bien la réalité politique, économique et sociale du pays, adressa à Madero une lettre ouverte qui fut publiée dans différents journaux :
Les révolutions, disait-il, sont toujours des opérations extrêmement douloureuses pour le corps social ; mais, avant tout, le chirurgien a le devoir de ne pas refermer la plaie avant d'en avoir extirpé toute la gangrène. Nécessaire ou non, l'opération est commencée ; vous avez ouvert la plaie, vous êtes obligé de la refermer ; mais gare à vous si, découragé par la vue du sang ou ému par les cris de douleur de la patrie, vous alliez fermer précipitamment la plaie sans l'avoir désinfectée et sans avoir extirpé le mal que vous aviez décidé d'arracher. Le sacrifice aurait été inutile et l'histoire maudirait votre nom, non pas pour avoir fait crever l'abcès, mais parce que la patrie continuerait à souffrir des mêmes maux, après les avoir crus guéris, et qu'elle se trouverait exposée à des rechutes de plus en plus graves et à des menaces d'opérations de plus en plus douloureuses et épuisantes.
Il disait encore à Madero que sa responsabilité était telle que « s'il ne parvenait pas à déterminer quelles étaient les réformes politiques et économiques exigées par le pays, il courrait le risque de laisser vivants les germes de futures perturbations et même d'être incapable de rétablir la paix dans le pays ».
Blas Urrea avait vu juste. Le chirurgien qu'était Madero ferma précipitamment la plaie sans en extirper la gangrène : il n'eut jamais une conscience claire des réformes économiques et sociales que le peuple réclamait et il laissa en vie les germes d'ultérieures et longues perturbations.
Par ailleurs, les délégués de la révolution aux pourparlers de Ciudad Juárez commirent certainement une grave erreur en s'engageant à licencier les troupes madéristes. Bien que partiels, les licenciements produisirent un profond malaise et un grand mécontentement parmi ceux qui avaient risqué leur vie à combattre le porfirisme et furent la cause d'une multitude de problèmes très graves et très difficiles à résoudre.
Quoiqu'il en soit, au lendemain du triomphe de Ciudad Juárez, de nombreuses bandes rebelles improvisées apparurent avec une rapidité inexplicable et s'emparèrent aisément d'un grand nombre de villes importantes. La presse mexicaine, hier gouvernementale, prit le virage avec une rapidité surprenante en faveur de Madero et de sa cause.
On annonça alors à Mexico que le général Díaz et M. Corral devaient présenter leur démission le 24 mai. Les tribunes de la Chambre des députés s'emplirent d'un public impatient et enthousiaste. Mais il n'y eut pas de démission et des cris et des protestations se firent entendre. Les gens qui emplissaient les tribunes et ceux qui attendaient dans la rue organisèrent une manifestation qui acclamait Madero et conspuait le général Díaz. Des immeubles furent lapidés. La foule, de plus en plus houleuse et agressive, se dirigea vers le palais national. La troupe ouvrit le feu, faisant douze morts et vingt blessés.
Le général Díaz n'était pas disposé à présenter sa démission et il hésita jusqu'à la dernière minute. Certains généraux lui demandaient de rester au pouvoir et lui proposaient d'aller combattre sur les champs de bataille, tandis que son entourage immédiat, Limantour, De la Barra et Vera Estañol - d'après le témoignage de José R. del Castillo dans Revolución social de México - faisaient pression sur lui pour obtenir son départ. L'orgueilleux octogénaire finit par céder. Sa démission ainsi que celle de Corral furent présentées le 25. Cette dernière fut acceptée à l'unanimité, celle de Díaz à l'unanimité moins deux voix. C'étaient les voix de Benito Juárez Maza et de José Peón del Valle qui faisaient là un beau geste romantique, mais totalement inutile.
La démission du général Díaz de la présidence qu'il occupait depuis trente ans est un document historique qui mérite d'être reproduit ici :
Le peuple mexicain, ce peuple qui m'a si généreusement comblé d'honneurs, qui m'a pris pour guide au cours de la guerre internationale, qui m'a si patriotiquement secondé dans toutes les œuvres entreprises pour raffermir l'industrie et le commerce de la république, consolider son crédit, lui procurer le respect international et lui donner une place d'honneur auprès des nations amies ; ce peuple, messieurs les députés, s'est soulevé en bandes armées et a manifesté que c'était ma présence au pouvoir exécutif suprême qui était la cause de l'insurrection.
À ma connaissance, aucun acte qui me soit imputable n'a pu motiver un tel phénomène social ; mais en admettant, sans y souscrire, que je sois inconsciemment coupable, une telle éventualité fait de moi la personne la moins indiquée pour raisonner et décider de ma propre culpabilité. Par conséquent, et respectant comme je l'ai toujours fait la volonté du peuple, et en accord avec l'article 82 de la Constitution fédérale, je viens devant la représentation suprême de la nation me démettre de la charge de président constitutionnel dont le suffrage populaire m'avait honoré ; et je le fais avec d'autant plus de raisons que pour me maintenir il serait nécessaire de continuer à répandre le sang mexicain, diminuant ainsi le crédit de la nation, gaspillant ses richesse, tarissant ses sources et exposant sa politique à des conflits internationaux.
J'espère, messieurs les députés, qu'une fois calmées les passions qui accompagnent toute révolution une étude plus consciencieuse et plus documentée des faits fera surgir dans la conscience nationale un jugement sain qui me permettra de mourir en emportant au fond de mon âme l'estime du peuple mexicain égale à celle que j'ai eue, et que j'aurai toute ma vie, à l'égard de mes compatriotes.
À propos de la démission de don Porfirio, López Portillo y Rojas a des mots durs et quelque peu passionnés :
Le document, dit-il, fut froidement accueilli par la majorité des parlementaires ; il n'était pas à la hauteur des circonstances. Son seul résultat, immense, profond et véritablement général, fut une joie débordante, car il semblait marquer la fin du combat et la satisfaction d'un grand élan populaire.
Entre-temps, Díaz et sa famille étaient restés seuls, absolument seuls dans leur demeure de la rue de la Cadena. L'autocrate avait trompé les technocrates, Limantour, ses amis et ses partisans ; il s'était joué de tout et de tous, et à l'heure suprême de la décadence, de la chute, personne ne voulait l'approcher. Seul, et dans le plus grand secret, il prépara son départ et quitta la capitale par le train express qui le conduisit à Veracruz... Il ne prit congé de personne, même pas de ses plus fidèles amis ; Limantour lui-même ignorait sa fuite.
Il est exact que la déclaration n'était pas à la hauteur des circonstances ; elle mêlait la vérité au mensonge, l'orgueil et l'humilité, le reproche et la flatterie à un peuple qu'il avait gouverné de manière despotique. Il faut avouer que le général Díaz ne manqua pas d'une certaine grandeur au moment amer de la défaite. Il est également indéniable que les Mexicains l'avaient comblé d'honneurs, mais il est faux de dire qu'ils l'avaient pris pour guide au moment de l'intervention française. Il avait été l'un de leurs chefs, mais non le seul. Il faut rappeler les noms de Benito Juárez, Ignoci Zaragoza, Mariano Escobedo, Santos Degollado et quelques autres, aussi importants que don Porfirio. Il fait ressortir l'importance de son oeuvre administrative, il feint d'être surpris par l'insurrection des nombreuses bandes armées. La dernière partie est pathétique. Il espère que son oeuvre recevra un jugement favorable et qu'il mourra en emportant au fond de son âme l'estime de ses compatriotes. Il mourut en terre étrangère le 2 juillet 1915 et attend encore le jugement définitif de l'histoire.
L'ex-président quitta le jour même la ville de Mexico en direction de Veracruz. Il était accompagné de sa famille, du général Félix Díaz et de Fernando et Manuel González. L'escorte qui assurait la sécurité du convoi fut placée sous les ordres du général Victoriano Huerta qui allait à quelque temps de là jouer un rôle sinistre dans l'histoire du Mexique. « Une telle mission lui fut confiée par le plus grand des hasards, car le général Díaz n'avait jamais eu confiance en lui », dit Ramón Prida, explication qui nous semble exacte.
C'est ainsi que l'homme extraordinaire qui avait régi les destinées du Mexique pendant tant d'années, le héros et le dictateur, l'octogénaire chargé d'expérience, de gloire et de désillusions monta à bord de l'Ipiranga en direction de l'Europe, le 27 mai, au milieu des applaudissements, des vivats et des larmes du peuple de Veracruz. Face à la disgrâce de son ancien chef, le peuple oubliait les outrages subis et donnait un bel exemple de sa grande noblesse.
Don Francisco León de la Barra occupa la présidence de la république le 26 mai. Son cabinet, désigné en accord avecMadero, était ainsi composé : Affaires étrangères, Bartlomé Carbajal y Rosas ; Intérieur, Emilio Vázquez Gómez ; Justice, Rafael L. Hernández ; Instruction publique, Francisco Vázquez Gómez ; Agriculture, Manuel Calero ; Communications, Manuel Bonilla ; Finances, Ernesto Madero ; Guerre et Marine, Eugenio Rascón. Trois seulement des membres du nouveau cabinet étaient des révolutionnaires : les frères Vázquez Gómez et Bonilla. Rafael L. Hernández et ErnestoMadero étaient parents du chef de la révolution triomphante, mais liés au porfirisme. Calero peut être rangé dans la catégorie des indépendants aux idées démocratiques modérées ; Carbajal y Rosas était un diplomate de carrière et un ami de De la Barra ; Rascón était tout simplement un vieux général.
Le voyage de Madero de Ciudad Juárez à Mexico fut une marche triomphale ; tout au long du trajet, il fut acclamé avec un enthousiasme délirant. Il arriva à Mexico le 7 juin à midi et demi. Cent mille personnes l'attendaient pour l'acclamer. Ces manifestations d'adhésion et de sympathie, absolument spontanées, n'avaient pas eu de précédent dans l'histoire du Mexique, à l'exception peut-être de l'accueil fait à Iturbide lorsqu'il fit son entrée à la tête de l'armée des « trois garanties »(4), à l'issue de l'indépendance du Mexique, le 27 septembre 1821. Rien de tel ne s'est produit depuis le 7 juin 1910, à l'exception toutefois de la manifestation organisée au mois de mars 1938, au moment de l'expropriation des biens des entreprises pétrolières.
Mais ce jour-là, au milieu de cette liesse populaire, des hommes déçus et pleins de rancœur attendaient dans l'ombre l'heure de la vengeance.
Notes
(1) Caciquismo, de cacique, voir note 1 page 22.
(2) De 1846 à 1848, une guerre oppose le Mexique aux États-Unis. Les troupes américaines envahissent le pays et l'occupent en 1847 et en 1848. Après la bataille de Chapultepec, le 14 septembre 1847, les troupes américaines hissent leur drapeau sur le Palais National : la ville de Mexico est occupée. La guerre se termine par la signature du traité de Guadeloupe Hidalgo par lequel le Mexique reconnaît le Río Bravo comme étant sa frontière avec le Texas. Le Mexique cède donc plus de 40 % de son territoire aux États-Unis - près de 2 000 000 km2. Les États-Unis annexent ainsi la Californie, le Nouveau- Mexique, l'Arizona, le Nevada, l'Utah, la majeure partie du Colorado et le sud-ouest du Wyoming. [nde]
(3) Le terme licenciado s'applique à toute personne titulaire d'un titre universitaire; désignation très courante au Mexique.
(4) Les trois garanties dont se prévalait Iturbide dans son manifeste appelé le Plan de Iguala étaient l'établissement d'une monarchie indépendante, le maintien des privilèges de l'Église, l'égalité entre les créoles et les Espagnols.
Pour citer cette ressource :
Jesús Silva Herzog, Raquel Thiercelin-Mejías, Histoire de la révolution mexicaine, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2010. Consulté le 14/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/mexique/histoire-de-la-revolution-mexicaine



 Activer le mode zen
Activer le mode zen