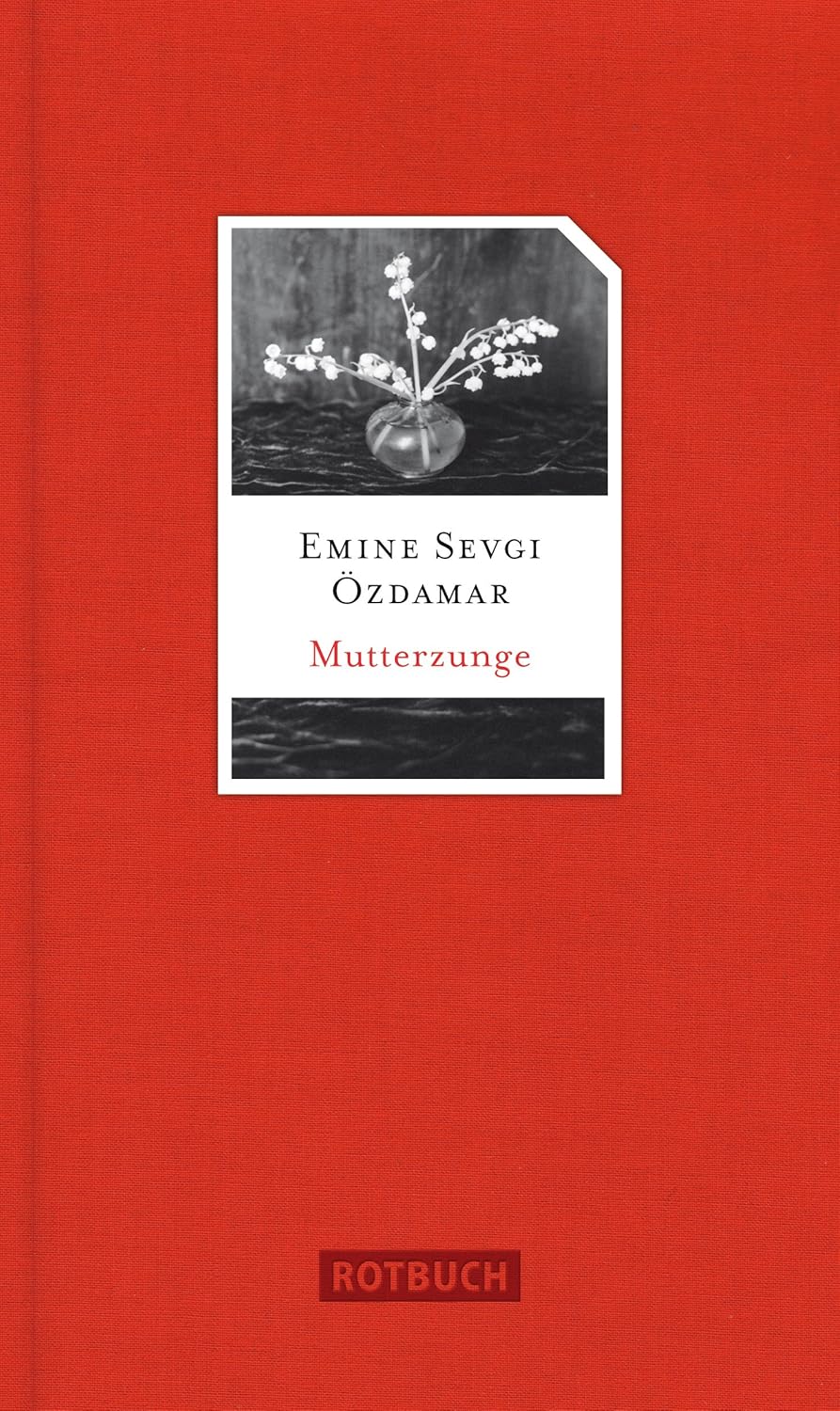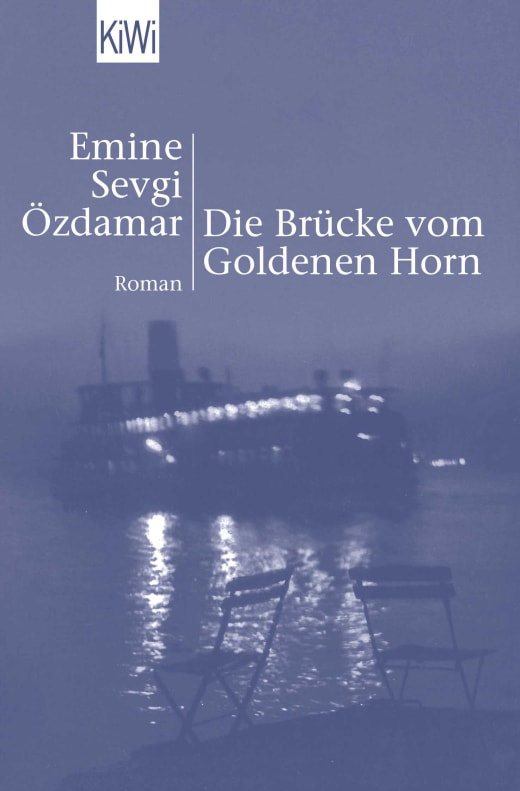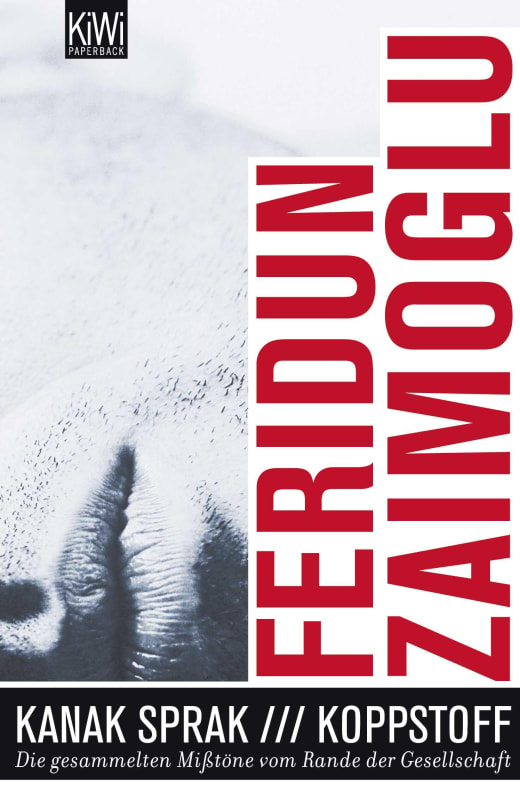Plurilinguisme et interculturalité dans l’autofiction : Özdamar et Zaimoğlu
|
|
ÖZDAMAR, Emine Sevgi. 2002 (1998). Die Brücke vom Goldenen Horn. Köln : Kiepenheuer & Witsch. 320 Seiten.
|
|
Introduction
Emine Sevgi Özdamar et Feridun Zaimoğlu sont une écrivaine et un écrivain allemands contemporains avec un arrière-plan migratoire turc. Leurs œuvres manifestent à des degrés divers le contact entre le monde turc et la culture allemande par une écriture partiellement plurilingue et partiellement éloignée de la norme écrite. Leur écriture hybride fait se rencontrer, dans un va-et-vient délibéré entre une simulation d’oralité quotidienne et une scripturalité soignée, une parfaite maîtrise de l’instrument langagier et la flexibilité stratégique que permet un habitus transculturel. La contribution s’intéresse d’abord à la pratique plurilingue de Emine Özdamar dans le récit « Carrière d’une femme de ménage » (« Karriere einer Putzfrau », 1990) et dans le roman Le pont de la Corne d’or (Die Brücke vom goldenen Horn, 1998). La narration y joue avec des traits empruntés à la biographie langagière de l’auteure, tout en se manifestant comme récit fictionnel. La seconde partie se concentre sur un écrit de Zaimoğlu, polémique lors de sa parution, « Langue canaque » (Kanak Sprak, 1995), s’appuyant sur la réalité (ou la fiction ?) de courtes autobiographies en style oral. La troisième et dernière partie compare les effets identitaires et les objectifs d’intégration que suggère leur rapport différent au plurilinguisme et au contact des cultures pour conclure que la pluriculturalité valorisée dans la littérature fait de la langue allemande une « langue d’accueil » (Neelsen, 2018, 212).
1. Remémoration (pluri)-langagière chez Özdamar
1.1. Autofiction de vies polyglottes
Le récit « Karriere einer Putzfrau », issu du recueil Mutterzunge, est l’histoire à la première personne d’une femme turque qui, répudiée par son mari, émigre en Allemagne fédérale, où elle est ballotée entre une activité rémunératrice de personnel de nettoyage et la carrière de comédienne dont elle rêve. L'histoire du personnage évoque le parcours de l’auteure Özdamar, qui est travailleuse immigrée en Allemagne avant de devenir comédienne puis auteure de pièces de théâtre à la fin des années 1970. Les allusions à la carrière théâtrale réelle de l’écrivaine se font manifestes lorsque le personnage féminin réagit à sa répudiation par les mots d’Ophélie dans Hamlet « Oh welch ein edler Geist ist hier zerstört! » (112) ou que le récit se termine dans un ballet grotesque où des personnages de théâtre (César et Hamlet de Shakespeare, ou la mère de Woyzeck d’une pièce de Büchner) se lancent en guise d’injures des citations altérées.
Le roman Die Brücke vom Goldenen Horn est riche de plurilinguisme réel (pas simplement de pluri-registre comme dans la nouvelle) dû à la fiction narrative. La protagoniste est une jeune femme turque se rendant à Berlin dans le projet d’y faire des études de comédienne, et qui gagne sa vie en travaillant dans une fabrique d’appareils électriques, logeant dans un foyer pour femmes turques. Bien qu'elle converse principalement avec d’autres turcophones, elle s’efforce à l’extérieur de parler l’allemand qu’elle apprend en autodidacte. La trame narrative fait parler les personnages de la fiction en allemand - il faut bien que le lectorat germanophone comprenne -, tout en instillant ici et là des séquences en turc ou des formules traduites du turc en allemand repérables à leurs interférences lexicales ou phraséologiques. Celles-ci ne sont pas les seules traces de pluralité des langues : Berlin, et Paris, ville dans laquelle la protagoniste se rend également, sont deux milieux cosmopolites permettant l’affleurement dans le récit d’autres langues : un anglais « de cuisine » avec d’autres étrangers, le grec moderne employé par des connaissances, l’espagnol de l’étudiant Jordi, avec qui la protagoniste vit une histoire d’amour dans la capitale française, et le français. De surcroît, poursuivant son projet théâtral et poétique, l’héroïne cite Shakespeare en version turque et allemande (12), Baudelaire en langue française (52) ou Lorca en espagnol et allemand (128), et elle se repose de ses lectures politiques (elle s’initie au marxisme) en s’amusant à prononcer, sans connaissance de la phonologie de ces langues, les titres des œuvres de Marx en italien ou en roumain. Le retour à Istanbul ((C’est le pont sur la baie d’Istanbul qui donne son nom au roman.)) dans la deuxième partie du roman réintroduit le contact langagier avec le turc au premier plan du roman. Écrit à la première personne, le roman, avec l’ensemble d’allers-et-retours entre l’Allemagne et la Turquie du roman, fait également écho à la vie de l’autrice, qui a fait son premier séjour en RFA en 1965-66 et y est revenue à partir de 1976.
1.2. Les caractéristiques de l’écriture özdamarienne
L‘auteure Özdamar explique son style dans son discours de remerciement au prix Chamisso (2005, 125) comme suit : son allemand est sous-tendu par sa socialisation originelle en langue maternelle turque, dont la matière est constitutive de son identité, car elle n’est arrivée en Allemagne qu’à l’âge de 18 ans. Mais elle cherche en même temps à décevoir les préjugés de son lectorat, qui attendrait d’une écrivaine germano-turque un style fleuri aux métaphores orientales.
Sa mise en scène du contact des langues se déroule sur plusieurs niveaux. Tout d’abord, elle empêche une lecture littéraire traditionnelle en enfreignant les principes du bon goût par l’utilisation de mots grossiers. Dans Karriere einer Putzfrau (113-116 & 121-122), il est beaucoup question de « Scheiße », « Arsch », « pissen »/ « Pissoir », ou « furzen ». En 1990, date de publication du récit, l’usage de mots vulgaires mis dans la bouche d’une femme-protagoniste par une femme-auteure était vraisembablement plus choquant qu’aujourd’hui. Deuxièmement, elle perturbe certaines expressions idiomatiques ou mots savants en les dé- & reconstruisant de façon fautive, comme dans une scène grotesque dans Die Brücke vom Goldenen Horn pour le mot « orgasme » / « Orgasmus ». Lorsque la protagoniste se rend en Anatolie avec des camarades révolutionnaires pour y prêcher la révolution communiste, elle entreprend de faire l’éducation sexuelle des paysannes, qui altèrent le mot savant « Orgasmus » en « Urugasmus » et le mêlent à des appels pour faire avancer les ânes sur lesquels elles cheminent :
Mit Lenins Buch in der Hand fragte ich die Bäuerinnen auf dem Esel: „Wißt ihr, was ein Orgasmus ist? Orgasmus ist euer Recht”, rief ich. Die Bäuerinnen sprachen mit ihren Eseln, um sie anzutreiben. „Deeh, deeh”, und dann zu mir: „Sag uns, was dieser Urugasmus — deeh, deeh — heißen soll?” – „Gefallen euch eure Männer im Bett? Spielen sie schön mit euch?” Die Bäuerinnen lachten: „Wir Bauern haben nur einen Spaß, den Spaß im Bett. Und dein Mann? Gibt er dir auch einen süßen Geschmack im Bett?” Wir lachten, und unsere Körper wackelten auf den drei Eseln auf der steinigen Dorfstraße, die Beine der Esel kamen fast ins Rutschen. (261)
Enfin, la cohabitation (« mélange ») des registres langagiers met le plurilinguisme des sujets au centre du matériau linguistique et littéraire. Les récits-cadres sont écrits en allemand soutenu, tandis que les évènements présentent occasionnellement du xénolecte au cours d’interactions entre protagonistes turcophones et germanophones natifs. Les interférences entre l’allemand et le turc ne sont pas à porter au compte d’une maîtrise insuffisante de la langue allemande par l’auteure, qui sait parler et écrire un allemand de haute tenue. Il peut s’agir d’interférences grammaticales, comme une linéarisation évoquant le turc au sein d'une phrase en allemand, positionnant le verbe à la troisième place de la phrase affirmative au lieu de la deuxième position réglementaire, comme dans : « Einmal aber dieses Knacken haute nicht richtig hin » (« Karriere einer Putzfrau », 119). Il s’agit aussi d’interférences pragmalinguistiques, comme lorsque le garde forestier croit devoir s’adresser à la protagoniste en « variété pour étranger », lui donnant un conseil à l’infinitif du verbe au lieu du présent : « Du können gehen, hat er mir gesagt. Ich bin gegangen. » (116). L’article des substantifs est parfois omis, trait stéréotypique de l’allemand éthnolectal connu sous le nom de Kiezdeutsch ou allemand du Kiez : « […] Für ihn Zigarette, Abend, Straße, Katze ist vorbei. » (114). Le court récit de « Karriere einer Putzfrau » présente une langue plus hybride que le roman Die Brücke, oscillant entre un allemand fluide et la langue non idiomatique que pourraient parler ces personnages d’une autre langue maternelle, s’ils étaient réels. Ce mélange ou montage de différents registres langagiers attribue une authenticité de parole aux personnages d’origine turque et met en scène l’altérité de la vie à l’étranger.
Ce style serait vraisemblablement lassant pour le lecteur au long cours d’un roman qui fait 320 pages, dont l’écriture ne comporte qu’ici et là des variations ethno-stylistiques en fonction des situations discursives. C’est ainsi que le directeur (turc) du foyer s’adresse gentiment aux femmes en leur disant : « Zucker » ou « Zuckers », qui a la signification de « ma chère, ma douce ». La forte présence dans la fiction de personnages natifs de Turquie explique la multiplication – toujours dans ce récit-cadre rédigé en allemand – des interférences manifestées, par exemple sur le plan phonétique, comme lorsque la désignation du foyer des travailleuses turcophones est altérée par elles en « Wonaym » au lieu de « Wohnheim », permettant d’imaginer une prononciation sans aspiration du « h » à l’amorce de la deuxième syllabe du mot. Les interférences sont également lexico-sémantiques, comme lorsque la gare berlinoise, détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et portant le nom de « Anhalter Bahnhof » ((« Anhalter Bahnhof », d’après la région « Anhalt » d’où venaient les trains, cf. le Land de Sachsen-Anhalt.)) est d’abord désignée par elles comme « zerbrochener Bahnhof », puis « beleidigter Bahnhof » (24), en raison du double-sens de l’adjectif turc correspondant à « zerbrochen ». Le parler étrangéisé de ces femmes dans la fiction affiche les langues en contact.
1.3. Les interactions comme remémoration de situations de contact linguistique
Les protagonistes du roman Die Brücke, agissant dans un environnement linguistique qui n’est pas celui de leur pays natal, jonglent avec les langues de façon babélienne. Un exemple : la protagoniste rencontre à Paris un Allemand qui lui parle en anglais, par honte de parler allemand en France (l’histoire débute en 1966), mais qui s’excuse dans la foulée en français d’avoir heurté quelqu’un et à qui elle répond en allemand par une déclaration d’amour pour la langue allemande :
Nachdem ich alle meine englischen Wörter heraugegeben hatte, fragte ich ihn, warum er mit mir englisch sprechen wolle. Er sagte: „Ich geniere mich in Paris für die deutsche Sprache, das ist die Sprache von Goebbels und Hitler.“ Ich sagte; „Ich liebe Kafka.“ In der Métro merkte ich, dass der deutsche junge Mann, wenn er mit französischen Menschen sprach, sich wie ich in deutsch immer entschuldigte. “Pardon Madame, pardon Monsieur.“ Mit viel “Pardon Madame, pardon Monsieur“ fanden wir in der Cité Universitaire das griechische Studentenmaison, wo Gutsios Freund wohnte. (120)
Ce jeu entre les langues simule à l’occasion les problèmes de compréhension lorsque les protagonistes ne maîtrisent pas complètement toutes les langues de leur environnement. Dans des interactions avec un jeune homme grec, le mot « turcala » (Brücke, 115-118), qui veut dire « turque » au féminin en grec, s’applique à la protagoniste, ce qu’un lecteur comprend sans traduction ni connaissance du grec. Mais il subsiste çà et là quelques ilots linguistiques mystérieux qui créent un petit étonnement, comme la fin du chapitre qui présente une formulation grecque « yasu pedakimu yasu » (Brücke, 118), une routine de salutation. On peut y voir l'imitation des difficultés communicatives que connaît un/e migrant/e dans un autre pays, ou un pied de nez de l’auteure, qui a choisi une langue minorée probablement inconnue de la majorité du lectorat pour cette interaction plurilingue dont elle ne livrera pas les clefs.
Le plus souvent, l’auteure glose les séquences en d’autres langues sous la forme d’une paraphrase ou d’une traduction. Un premier type est une traduction littérale non commentée, qui présente un proverbe turc ou une expression idiomatique directement en allemand, ce que le lecteur repère au caractère étrange de la séquence. Par exemple, le premier chapitre de la deuxième partie qui met en scène le retour de la protagoniste en Turquie, commence par la phrase: « Wir kamen in Istanbul an, wo viele Leute Geld aßen. » (Brücke, 169). « Geld essen » est une métaphore turque signifiant « être dépensier », qui correspondrait à l’expression française « jeter l’argent par les fenêtres ». La page ne décrivant aucune scène de repas, encore moins de scène de consommation de billets de banque, le lecteur non turcophone interprète la formulation de manière métaphorique ou poursuit sa lecture en espérant une résolution par la suite. Cette démarche imite une stratégie d’interaction polyglotte, lorsqu’on fait semblant de comprendre pour ne pas perdre la face en espérant voir le sens s’éclairer plus tard.
Le second type de contact de langues est une traduction matérialisée par la co-occurrence des deux langues côte à côte dans le texte, comme dans la première page du roman: « Jemand fragte zum Beispiel “Niye böyle gürültüyle Yürüyorsun ?” (Warum machst du soviel Krach, wenn du läufst?), und ich antwortete mit einer deutschen Schlagzeile: “wenn aus Hausrat Unrat wird”. (Brücke, 11)
Qu’il s’agisse de l’étrangéisation de l’allemand par interférence avec le turc, du montage de séquences de turc dans l’oral allemand ou de l’irruption de titres de journaux réels dans la fiction romanesque, la cohérence entre la langue parlée par tel ou telle protagoniste et son environnement est rarement harmonieuse, symbolisant les difficultés de communication dans le monde réel lorsque une compétence imparfaite se heurte aux imprévus du quotidien. De façon dynamique cependant, la protagoniste se sort de situations parfois dangereuses par ses pirouettes linguistiques : lors d’une sortie en boîte de nuit, elle serait presque kidnappée par des hommes croyant l’avoir droguée, mais elle les met en fuite en proférant des slogans politiques dans une sorte de délire absurde : « Ich goß das Getränk, das komisch roch, heimlich auf den Boden und tat so, als ob ich eingeschlafen wäre. “Sie schläft schon. Hol ein Taxi”. Ich sprang auf und schrie: “Ihr seid das Produkt des amerikanischen Imperialismus. Nein zur NATO, nein zu Vietnam! Es lebe die Solidarität der unterdrückten Völker!” ». (Brücke, 278)
Le roman ne passe pas sous silence les difficultés de l’adulte à acquérir une nouvelle langue dans une culture étrangère et à en maîtriser l’usage adéquat dans diverses situations : le lecteur suit la protagoniste dans son cercle d’action limité au début du roman, réduit au groupe des autres travailleuses turques et de ceux qui les fréquentent, la protagoniste elle-même verbalise un sentiment de grande prudence linguistique lorsqu’elle se décrit en cicogne marchant précautionneusement (11) et en donne un exemple d’anthologie dans la scène partiellement surréaliste où elle ne cesse de s’excuser, dont nous ne citons que l’amorce :
Einmal saß ich im Wohnheimbüro, eine Hand unter dem Kinn, es war dunkel im Büro, und Madame Gutsio kam herein. Sie schaltete das Licht an, und ich sagte: “Ach, Entschuldigung.” Gutsios Hand blieb am elektrischen Schalter, und sie sagte: “Warum entschuldigst du dich?” — “Ja, richtig, Entschuldigung”, sagte ich.
“Warum entschuldigst du dich, Zuckerpuppe?”
“Ja, richtig entschuldige.”
“Entschuldige dich doch nicht.”
“Okay, Entschuldigung.” (Brücke, 107)
Le suremploi du mot « Entschuldigung » peut aussi bien être une routine de politesse remplaçant des explications pour lesquelles lui manque le vocabulaire, que la marque d’une insécurité comportementale due à d’insuffisantes connaissances linguistiques. De tels épisodes construisent progressivement une sociabilité intermédiaire entre ses habitudes linguistiques et comportementales d’ « étrangère » et son environnement, ici majoritairement germanophone, là majoritairement turcophone.
2. Choc des cultures et incompréhension migratoire chez Zaimoğlu
2.1. Biographies ou fictions ?
L’ouvrage de Zaimoğlu commenté ici s’intitule Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. Les 24 « dissonances » sont 24 interviews mises en mots par l’auteur, dans lesquels de jeunes hommes à arrière-plan migratoire turc (en allemand « mit türkischem Migrationshintergrund ») racontent leur biographie et majoritairement, leur impossibilité d’intégrer la société allemande. La question à laquelle répondaient ces interviews était formulée de façon provocante sous la forme « Wie lebt es sich als Kanake in Deutschland? » (15), « Kanake » étant un terme stigmatisant utilisé parfois en Allemagne dans une volonté d’insulter les immigrés turcs et leurs descendants. Les récits biographiques sont tous marqués du sceau de l’auto-dépréciation chez des individus qui s’efforcent de puiser une dignité inversée dans leur situation marginale et marginalisée, dealer, travailleur du sexe, brocanteur, - s’il s’agit bien de leur situation sociale réelle et non d’une fiction stéréotypisante de l’auteur. Les histoires personnelles ne présentent pas tant de contenu évènementiel qu’un fort contenu émotionnel et des appréciations dévalorisantes de leur vie et de celle des autres. Les détails documentaires de ces récits esquissent une trame de parcours migratoires aboutissant à des échecs, du moins ressentis comme tels : « Den wechsel vom ackerland zum fliessband haben wir nicht verdaut », raisonne un poéte impécunieux (95). Diverses critiques ont régulièrement douté de la réalité de ces interviews, comme Bodenburg (2006), mettant en relation le grossissement de la misère et de la marginalisation des figures avec la brutalisation assumée de la langue par l’auteur dans ce qu’il a appelé une « Nachdichtung », les deux relevant de la fiction et non de la réalité des vies ou de l’expression des individus. Mais le paratexte de Zaimoğlu a toujours présenté ces textes comme autobiographies orales, et malgré une réputation discutée ((Le roman Leyla de Zaimoğlu a été considéré par certains comme un plagiat de – justement – la grande trilogie de Özdamar dont est issu le roman Die Brücke vom Goldenen Horn. L’éditeur des deux auteurs et Özdamar elle-même ont refusé de commenter publiquement ce soupçon ou d’engager des poursuites.)), les prix littéraires et invitations par la presse ou dans des salons du livre ont légitimé a posteriori cette construction narrative.
2.2. La langue de l’auteur
L’auteur Zaimoğlu revendique son attachement à la langue allemande comme étant sa langue personnelle et essentielle. Il déclarait dans un entretien : « Deutsch ist auch die Sprache meiner Seele. Ich kann nicht anders, wenn ich wirklich intensiv sein will und wenn ich ehrlich sein will und wenn ich dann an einem Buch schreibe, tief hineingehe in den Stoff, ich kann nicht anders, als es auf Deutsch zu machen. » (Zaimoğlu, 2017, 1)
Il plaisante sur son arrière-plan migratoire turc, affirme ne savoir manier qu’une langue turque fautive et hésitante et explique que la culture turque n’est pour lui qu’un décor en arrière-plan. Justement parce qu’il se considère membre de plein droit de la communauté germanophone, il veut pouvoir, comme tout écrivain allemand, utiliser les divers registres de la langue sans qu’ils soient rapportés à son origine familiale non native, qui pèserait de peu de poids : né en Turquie, il est arrivé à l’âge d'un an en Allemagne, où il a fait ses études et est devenu homme de lettres. Mais, symbole de la difficulté d'intégration des immigrés turcs, le terme de « dissonances » (« Misstöne ») du titre se réfère à celles de la langue utilisée, qui dissone par rapport à l’allemand standard. Cette dissonance a émergé lors du processus de transcription des interviews, que Zaimoğlu affirme avoir ensuite soumis aux narrateurs pour approbation: « Bei dieser „Nachdichtung“ ((Les quatre paires de guillemets de cette citation sont le fait de l’auteur.)) war es mir darum zu tun, ein in sich geschlossenes, sichtbares, mithin „authentisches“ Sprachbild zu schaffen. Im Gegensatz zur „Immigrantenliteratur“ kommen hier Kanaken in ihrer eigenen Zunge zu Wort. Die fertige „Übersetzung“ wurde den Befragten zur Einsicht vorgelegt oder vorgelesen und von ihm freigegeben. » (21-22)
Même en considérant que ces interviews relèvent du code oral, l’outrance des traits de l’oralité dans ces vingt-quatre auto-biographies agglomère sans répit des termes de dialecte berlinois, du milieu délinquant, du langage des jeunes, des anglicismes provenant du rap, des emprunts au turc et des altérations grammaticales comme les emploient certains habitants des cités en Allemagne, le kiezdeutsch. Le propos suivant cumule dans la même phrase deux anglicismes, un idiomatisme allemand, deux désignations grossières, l’une sexuelle, l’autre scatologique, et un mot de dialecte berlinois pour décrire les relations conflictuelles des « canaques » avec des personnes de leur entourage : « Die cashen dich, so sicher wie’n amen in der kirche, da kannst du die eier verwetten, dass du dich mit deiner scheisse ins olle aus kickst. » (Kanak Sprak, 26)
Ces altérations de la norme de l’allemand écrit rendent la lecture difficile, obligeant à repérer le lexique inhabituel derrière les élisions et la signification propositionnelle derrière les ruptures de construction. Cette langue fortement expressive se veut un allemand aliéné qui reflète la non-intégration des personnes réelles dans la société allemande. Elle est ainsi caractérisée par l’auteur dans son avant-propos : « Längst haben sie einen Untergrund-Kodex entwickelt und sprechen einen eigenen Jargon: die „Kanak-Sprak“, eine Art Creol oder Rotwelsch mit geheimen Codes und Zeichen. Ihr Reden ist dem Free-Style-Sermon im Rap verwandt, dort wie hier spricht man aus einer Pose heraus. Die Sprache entscheidet über die Existenz: Man gibt eine ganz und gar private Vorstellung in Worten. » (Kanak Sprak, 18)
Les déviations grammaticales par rapport au standard sont un gage d’authenticité communicative : l’absence occasionnelle de verbe conjugué dans les phrases ou l’omission d’articles déterminant les substantifs, la réduction des marques de cas ou de conjugaison ne simulent pas une mauvaise maîtrise langagière de non germanophones, mais un registre langagier qui va à l’essentiel communicatif, l’expression des difficultés de l’existence. La citation suivante décrit le processus « darwinien » que constitue la vie pour l’interviewé : « Ich sag dir bruder Gaarden is knochenbrecher gewesen von anfängen an. So’n oller wurm; nagt dir am gebein, und irgendwann willst du pein und scheiß tilgen und machst’n bißchen mobil, aber bei mir war’s so wie bei vielen jungs, daß ich zu fahlfalschen freunden stieß, die mit ner voll verkehrten rechnung im kopp dahinsiechen, die üben miese rache […] ». (Kanak Sprak, 39).
Quatre de ces interviews sont cependant rédigées dans un allemand de facture classique, comme celui de Mehmet, 29 ans, poète (Kanak Sprak, 91-95), ce qui constitue une discontinuité supplémentaire à passer du jargon underground majoritaire à une langue soutenue comprenant quelques archaïsmes littéraires.
L’ensemble constitue un hybridolecte (Hinnenkamp, 2005), terme se référant à un mélange de codes (diverses langues, divers registres de l’allemand, code écrit comme code oral) qu’unifie graphiquement l’absence de majuscules à tous les substantifs, autre petite rébellion contre la norme de l’allemand actuel. La phrase suivante, mélangeant du registre familier, de l’anglais et une place de groupe syntaxique non standard, le verbe de la relative étant remonté à l’intérieur de celle-ci alors qu’il devrait la terminer, est un bon exemple d’une avancée thématique par association d’idées, mimant les à-coups de l’oral : « […] pfoten weg von dem, was dich und die gemeinde schwächt, no drugs, no crime, und schutz nur in der gemeinschaft derer, die sich clean halten aus purer überzeugung » (Kanak Sprak, 30). Cette écriture accumule et pousse à son maximum certaines variations lexicales ou syntaxiques qu’on peut rencontrer dans divers registres germanophones contemporains, tels que l’oralité familière ou l’ethnolecte parlé dans les groupes de jeunes germano-turcs. L’hyperbolisation des écarts la rend difficile aussi bien qu’innovante.
2.3. Kanak Sprak comme discours de l’incompréhension migratoire
À sa sortie, l’ouvrage a été salué par les uns comme authentique et nécessaire et honni par d’autres comme artificiel et agressif. Sa place dans le champ littéraire contemporain est l’objet du même paradoxe : d’un côté, il n’a jusqu’à aujourd’hui fait l’objet d’aucune traduction ((Peu d’ouvrages de cet auteur ont été traduits : l’un ou l’autre en turc, et un roman de 1997 en français sous le titre de Racaille : la véritable histoire d’Ertan Ongun en 2004.)) dans aucune langue, tant la matière textuelle paraît difficile à transposer et correspondre à une « recherche d’effets » dont l’auteur s’est distancié depuis. Il a en effet qualifié a posteriori son écriture durant cette période ((Tel qu’il le formule dans une interview de l’année 2021, « Feridun Zaimoğlu im Gespräch mit Ulrike Timm », 09.02.2021, https://www.deutschlandfunkkultur.de/schriftsteller-feridun-zaimoglu-migrationshintergrund-das-100.html)) de « Lust auf grelle Effekte und Affekte ». D'un autre côté, le texte fascine toujours littéraires, sociologues et linguistes, et le flot de publications ne se tarit pas, se focalisant récemment sur la signification migratoire de son texte, comme le font Ezli (2022) ou Moraldo (2023).
L’agressivité ressentie dans ces vingt-quatre auto-présentations découle du fait que les lecteurs y discernent le refus virulent d’une identité collective qui serait assignée aux personnes d’origine turque vivant en Allemagne. Ceux-ci refusent d’adopter les façons d’être et d’agir du groupe surmajoritaire allemand et cultivent hargneusement un aspect irréductible de leur identité. En tant que personnes de seconde, voire de troisième génération de cet « arrière-plan migratoire », ils veulent être perçus comme des individus, et non par le filtre de leur appartenance à un groupe abstrait venant d’ailleurs, affublé de caractéristiques majoritairement négatives : « Der Weg in die endgültige Auflösung der Gruppe, die nie eine homogene « Ethnie » gewesen ist, ist vorgezeichnet. Als selbstbewusstes Individuum aber existiert der Kanake nur auf dem Passfoto. », affirme l’introduction (16). Dénigrés en Allemagne parce que d’origine turque – « Den Kanaken schiebt man Sitten und Riten zu wie einen schwarzen Peter » (Kanak Sprak, 17) –, ils dénigrent en retour les personnes de leur entourage.
La relation attendue entre langue et identité, ici ostentatoirement perturbée, met au jour le scepticisme de l’auteur quant à la capacité de la société à être accueillante envers les personnes venues d’ailleurs, en les faisant parler de façon diffractée. Elle est caractéristique de son opposition à ce qu’il appelle le « multiculturalisme romantique », vision idéalisée de relations harmonieuses entre toutes les cultures. Les choix linguistiques des individus étant en lien étroit avec la dimension économique et sociale de leurs situations, l’allemand discontinu et underground que parlent les différents narrateurs véhicule ce malaise dans la société allemande. Les biographies-reportages du recueil cherchent à effacer l’essentialisation des individus sous les stéréotypes en impulsant un contre-récit combattif. Mais la liste des activités censément exercées par ces différents personnages (dans l’ordre des récits, Rapper, Flohmarkthändler, Transsexuelle, Breaker, Packer, Zuhälter, Dervisch, Gelegenheitsstricher, Gigolo, arbeitslos, Kleinhehler, Streuner und Schüler, etc…) génère l’impression d’une caricature de rôles marginaux, pouvant expliquer la froideur sociale à leur égard.
3. De la communication de l’expérience interculturelle à sa transmutation
3.1. L’interculturalité d’Özdamar ou l’intégration humoristique
L’interculturalité d’Özdamar imite en les détournant certains épisodes de contacts entre langues et cultures de sa riche biographie polyglotte. Une tonalité farcesque transpose des problèmes de communication en échecs moqueurs. Il en va ainsi de l’immigré turc Hamza qui cherche une femme allemande pour combler sa solitude affective et sexuelle et met une petite annonce dans laquelle il affirme vouloir apprendre l’allemand : « Suche Sprachlehrerin, um Deutsch zu lernen. » (Brücke, 46). L’enseignante qui y répond ne donne pas le sens voulu aux énormes soupirs de l’apprenant peu studieux (47), qui, niaise jusqu’au bout, cache le soutien-gorge voulu aguicheur sous un coussin ou aère le parfum séducteur, répandu dans la pièce avant l’arrivée de la prof à domicile. Le malentendu n’est jamais levé entre les deux protagonistes, l’enseignante se lasse et abandonne, laissant ce protagoniste à sa solitude. Le réalisme à ras-de-terre (Froschperspektive) dépeint au premier degré le personnage stéréotypé du sot qui échoue dans ses tentatives de tromperie. À un autre niveau, il illustre aussi la difficulté des personnes d’origine étrangère à établir une relation dépassant le contact superficiel avec les Allemands de tous les jours. En se moquant de ses personnages, l’autrice projette des expériences socio-langagières d’immigré/e/s en Allemagne et décrit une satire sociale des rapports entre des acteurs qui ne se comprennent guère.
La migrante, qui est le personnage principal du roman, sortira victorieuse de ses difficultés avec la langue et les coutumes du pays d’accueil, comme l’illustre une scène trop humoristique et étonnante pour renvoyer à un évènement réel. Dans les premières pages du roman Brücke (18-19), la protagoniste se rend avec deux autres femmes turques dans un magasin de Berlin pour y faire des achats, et, comme aucune ne sait suffisamment l’allemand, elles désignent par onomatopées ce qu’elles veulent acheter, le sucre, en disant « Schak Schak », le sel, en faisant « eeee » et en tirant la langue, et les œufs, en disant « Gak gak gak », tout en se trémoussant du derrière. Le symbolisme des gestes et sons pour renvoyer aux objets à acheter est discutable, mais la légèreté distrayante de la scène renvoie à des expériences gestuelles de « parler avec les mains » qu’un lecteur aura pu faire dans une situation d'interaction plurilingue. Les jeunes femmes repartent dans le roman avec les biens convoités, signe que le dynamisme et l’inventivité sont les meilleurs garants du succès des interactions en situation de contacts de langues. La débrouillardise plurilingue et pragmatiquement adéquate est gage d’inclusion sociale ; dès la première page du roman, la protagoniste surmonte sa totale méconnaissance de l’allemand pour arriver à ses fins : « Es war schön, in diesen Brotladen hineinzugehen, weil man das Wort Brot nicht sagen musste, man konnte auf das Brot zeigen ». (Brücke, 11)
3.2. Zaimoğlu et l’interculturalité rebelle
Comme il l’explique dans son introduction, l’écrivain Feridun Zaimoğlu souhaite, quant à lui, partir en lutte contre une conception mièvre de l’interculturalité, qu’il appelle « Märchen von der Multikulturalität » (Kanak Sprak, 17). Il qualifie les citoyens compréhensifs de la société allemande de gentils promeneurs s’étonnant de la diversité des coutumes et des langues dans le « grand zoo des ethnies » (17). Il accuse les personnes accueillantes de se complaire dans leur compassion et bonne moralité personnelle, maintenant l’autre dans une altérité nostalgique du mythe du bon sauvage qui renvoie le miroir de la nature à l’être civilisé qu’ils sont. La multiculturalité que se représentent ces destinataires allemands devrait accommoder des motifs exotiques à la sauce germanophone. Un passage de l’avant-propos de Kanak Sprak semble critiquer de façon acerbe sa collègue Özdamar ((L’identification de l’allusion à Özdamar se fait par le biais de l’expression « Mutterzunge », qu’elle a rendue célèbre par le titre du recueil dans lequel se trouve le récit « Karriere einer Putzfrau ». Cependant, Zaimoğlu a prétendu, lors de l’étonnement du monde de la culture provoqué par les similitudes entre son roman Leyla et les romans d’Özdamar, n’avoir pas lu cette dernière.)), à qui serait reproché de conforter les préjugés bien-pensants sur la littérature de la migration : « Eine weinerliche, sich anbiedernde und öffentlich geförderte „Gastarbeiterliteratur“ verbreitet seit Ende der 70er Jahre die Legende vom „armen, aber herzensguten Türken Ali“. […] Die « besseren Deutschen » sind von diesen Ergüssen „betroffen“, weil sie vor falscher Authentizität triefen, ihnen „den Spiegel vorhalten“, und feiern jeden sprachlichen Schnitzer als poetische Bereicherung ihrer „Mutterzunge“. » (Kanak Sprak, 17)
On comprend mieux pourquoi la parution de l’ouvrage, sa préface ou ses commentaires médiatiques ont été et sont encore aujourd’hui reçus de façon très partagée. Car il expose une vision de la non-intégration des travailleurs immigrés turcs en Allemagne très dissenssuelle et est tout aussi sévère sur la littérature germano-turque, voyant les écrivains biculturels comme des sujets entre deux mondes dont aucun ne les reconnaît vraiment. Pour sa part, il refuse d’être mis dans un tiroir « écrivain de la migration », qui serait une façon paternaliste de le mettre dans une catégorie pour étranger, une forme de othering, pour employer ce terme issu des études décoloniales.
Mais il refuse également d’écrire dans la langue littéraire allemande, ce grapholecte cultivé, et choisit cette écriture dissonante, qui est sa conception d’une écriture interculturelle. Son plurilinguisme diffère de celui d’Özdamar : il utilise plus d’emprunts à l’anglais qu’au turc, ce qui détone moins en prose allemande, tant les Allemands utilisent d’anglicismes. Ses personnages parlent majoritairement un registre oral très cru, ponctué occasionnellement d'un allemand comportant quelques interférences avec le turc. Son interculturalité à lui renvoie à l’hétérogénéité intentionnelle de cette écriture, dont la diffraction reflète les vies difficiles de personnes aussi diverses que le travailleur du sexe trans ou le poète, l’employé du service des ordures ou le réfugié politique, le forain ou le mécanicien automobile. Un de ses personnages affirme, en commentaire sarcastique de la célèbre citation de Goethe : « Man sagt dem bastard, er fühle sich unwohl, weil zwei seelen, bzw. zwei kulturen in seiner brust wohnen. Das ist eine lüge. Man will dem bastard einreden, er müsse sich nur für eine einzige seele entscheiden, als ginge es um einen technischen handgriff, damit die räder sich verzahnen, als sei seine psyche ein lahmgelegter betrieb. » (92)
Ce mal-être provient de l’attribution automatique, quel que soit le parcours individuel, de caractéristiques turquisantes aux personnes par cet othering qu’on ne nommait pas encore ainsi à la date d’écriture du texte : dans une interview au titre emblématique « Den fremdländer kannst du dir nimmer aus der Fresse wischen » (26), un personnage affirme : « wir sind hier allesamt nigger ». Or les personnages recherchent leur identité non dans un groupe national, mais dans leur individualité propre : « Ich bin, der ich bin », affirme Hasan (78 et 79) en expliquant sa façon d’être. L’écriture, non plus gentiment polyglossique, mais particulariste, mime cette constitution d’identité. Le texte se situe à mi-chemin du documentaire et de la fiction, racontant le réel, mais altérisant la langue allemande, afin de problématiser l’altérisation de l’individu. Surtout, celui-ci refuse d’être défini par autrui comme hybride entre la culture turque et la culture allemande, il exige d’être reconnu en tant que sujet, à l’inverse des personnages marginalisés de son texte, qui n’en peuvent plus d’être exclus des représentations et du respect de leurs concitoyens allemands.
Conclusion : parcours d’intégration versus parcours de subversion
Özdamar joue de la pluralité des langues existantes de façon polyphonique et ludique dans ses biographies narrées. Elle étrangéise la langue allemande par l’ironie et le collage de séquences linguistiques de différentes origines. Son hétéro-linguisme reflète une cohabitation avec la société environnante qui permet à ses personnages une expression et un développement personnels. Le récit interculturel initie le lecteur par ses gloses coopératives, et par l'humour qui se développe dans les interstices des difficultés interactionnelles. Les auto-fictions ne proposent pas de réponses explicites aux conflits, mais dépeignent la société allemande avec les yeux de l‘étrangère, faisant surgir des perspectives variées, allant de la nostalgie des proches à l’autonomisation féministe et politique. Tout à la fois « témoignage, journal intime, transcription de récits oraux, document historique » (Lacoue-Labarthe I. & A., 2020, 181), les deux textes évoqués dépeignent un « tableau intersubjectif de la réalité migratoire » (Lacoue-Labarthe I. & A. 2020, 182). Mais, si l’on en croit une déclaration de l’auteure dans son discours de remerciement à l’obtention du prix Chamisso, le bonheur s’est bien trouvé au carrefour des langues : « Seit 22 Jahren habe ich in Deutschland in vielen Theatergarderoben meine deutschen Wörter liegengelassen und sie am nächsten Abend wiedergefunden. Mein Lektor Helge Malchow sagte mir einmal: „Vielleicht schreibst du in Deutsch, weil du in der deutschen Sprache glücklich geworden bist.“ » (Özdamar, 2005, 128)
Chez Zaimoğlu, la pluriculturalité est immanente au texte, hyperbolisant des traits marginaux de la langue allemande. Il se distancie de la langue littéraire en écrivant un idiome personnel et irritant, subversif ((D’après Yildiz (172 & sq.), la masculinité et la féminité jouent un rôle dans cette appropriation différente.)), dont le message est politique. Les « postmigrants » (terme de Yildiz, 2012) qu’il met en scène emploient les mots de leur entourage stigmatisé, dont les catégorisations implicites les privent de dignité. Ses interviewés parlent cette langue octroyée, non-adéquate aux modèles sociaux que lui propose son environnement. Le lecteur de Kanak Sprak est placé dans une position culturelle d’extériorité et contraint à déchiffrer des modes d’être non familiers. Le texte loge dans un entre-deux des concepts « littérature de la migration » et « littérature nationale de langue maternelle », faisant penser à la littérature de la troisième dimension de Homi Bhabha, dans laquelle le minorisé a hybridé la langue coloniale.
Les deux auteurs illustrent des stratégies différentes d’intégration. À partir d’un capital culturel commun, les deux proses transgressent le monolinguisme et la monoculturalité en expérimentant dans les marges de la langue par une expression esthétique différente. Les deux idiolectes sont des indicateurs de déracinement, traitant cependant de façon distincte l’interrogation sur l’imaginaire social de l’altérité. Malgré l’hospitalité toute relative manifestée par la société d’accueil dans ces autofictions, la langue allemande, par sa réalité plurilingue et transculturelle, devient langue-refuge pour ces écrivains à la recherche d’une société plurielle.
Notes
Sources et références bibliographiques
Textes-sources
ÖZDAMAR, Emine Sevgi. 2013 (1990). « Karriere einer Putzfrau. Erinnerungen an Deutschland », in Mutterzunge. Erzählungen. Berlin: Rotbuch Verlag, S. 111-127.
ÖZDAMAR, Emine Sevgi. 2011 (1998). Die Brücke vom Goldenen Horn. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
ÖZDAMAR, Emine Sevgi. 2005. « Meine deutschen Wörter haben keine Kindheit. Eine Dankrede. », in Der Hof im Spiegel. Erzählungen. Köln: Kiepenheuer & Witsch, S.125-132.
ZAIMOĞLU, Feridun. 2011 (1995). « Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft », in Kanak Sprak // Koppstoff. Die gesammelten Misstöne am Rande der Gesellschaft. Köln: Kiepenheuer & Witsch, S. 1-113.
ZAIMOĞLU, Feridun. 2017. « Feridun Zaimoglu über die Muttersprache. „Ich kann nicht anders, als es auf Deutsch zu machen“ », Interview von Anja Reinhardt am 21.02.2017, Archiv Deutschlandfunk. Consulté le 13. 04. 2024 https://www.deutschlandfunk.de/feridun-zaimoglu-ueber-die-muttersprache-ich-kann-nicht-100.html.
Références bibliographiques
BHABHA, Homi K. 2007 (1994). Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale. Traduit de l’anglais The location of culture. Paris : Payot.
BODENBURG, Julia. 2006. « Kanaken und andere Schauspieler », Germanica [En ligne], 38, consulté le 23 août 2024, http://journals.openedition.org/germanica/418.
EZLI, Özkan. 2022. Narrative der Migration. Eine andere deutsche Kulturgeschichte. Berlin / Boston: Walter de Gruyter.
HINNENKAMP, Volker. 2005. « Vom Nutzen einer hybriden Sprache », in Volker Hinnenkamp, Katharina Meng (Hg.), Sprachgrenzen überspringen? Hybridität und polykulturelles Selbstverständnis. Tübingen: Narr, S. 175-199.
LACOUE-LABARTHE, Isabelle / LACOUE-LABARTHE, Alice. 2020. « La trilogie Istanbul Berlin d’Emine Sevgi Özdamar. Genre et écriture entre deux mondes », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 51, p. 169-183. En ligne https://journals.openedition.org/clio/18204.
MORALDO, Sandro M. 2023. « Postmigrantische literarische Konstruktionen. En Versuch über Feridun Zaimoğlu », in Natascia Barrale & alii (Hrsg.), Menschen und Handeln im Zeichen transkulturellen Denkens. Jahrbuch für internationale Germanistik, Bd. 148. Lausanne: Peter Lang, S. 137-147.
NEELSEN, Sarah. 2018. « Promouvoir le transculturel comme « typiquement allemand » ? Retour sur cinquante ans de littérature de la migration et sur sa promotion. », TTR, volume 31, numéro 2, p. 195–217. https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2018-v31-n2-ttr04947/1065574ar/.
YILDIZ, Yasemin. 2012. Beyond the Mother Tongue. The Postmonolingual Condition. New York : Fordham University Press.
Pour citer cette ressource :
Odile Schneider-Mizony, Plurilinguisme et interculturalité dans l’autofiction : Özdamar et Zaimoğlu, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2025. Consulté le 22/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/langue/linguistique-textuelle/plurilinguisme-et-interculturalite-dans-l2019autofiction-ozdamar-et-zaimoglu



 Activer le mode zen
Activer le mode zen