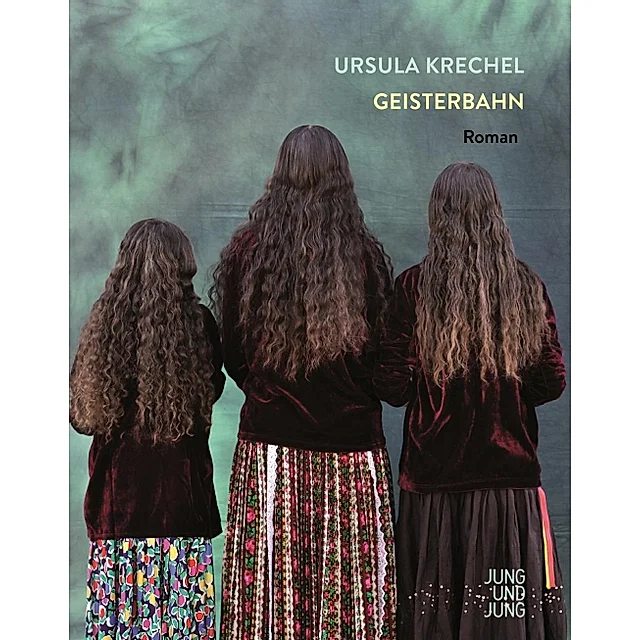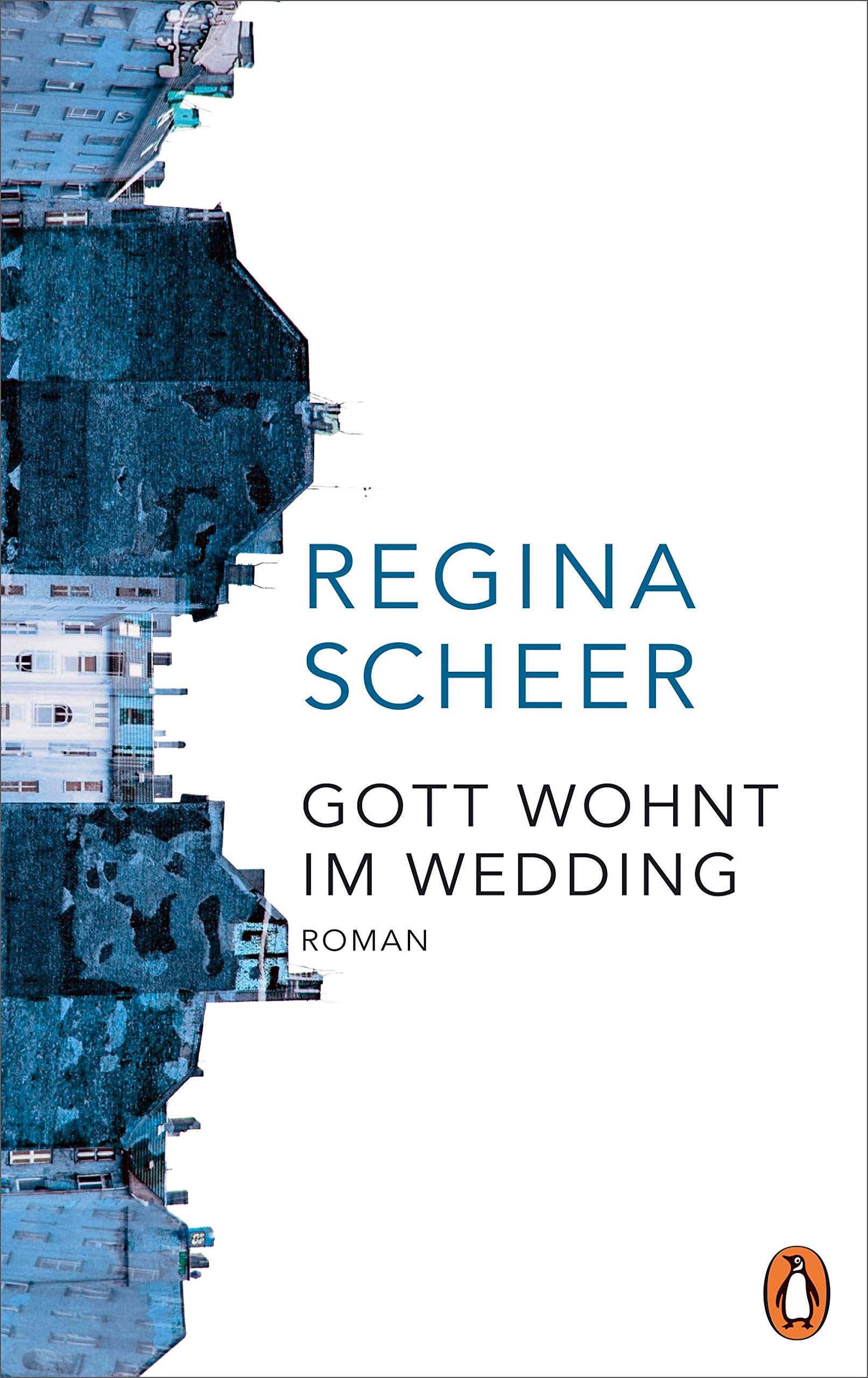"Wir begreifen manches nur durch Kunst " : les romans « Geisterbahn » et « Gott wohnt im Wedding »
« Wir begreifen manches nur durch Kunst. » ((Pour reprendre une phrase prononcée par Ursula Krechel, à l’occasion d’une lecture de son roman Geisterbahn, « Wir begreifen manches nur durch Kunst. », Trierischer Volksfreund, 07. 02. 2019. Je remercie Mme Jung des éditions Jung und Jung qui m’a fourni l’ensemble des articles parus à l’occasion de la parution de Geisterbahn.)) Geisterbahn de Ursula Krechel et Gott wohnt im Wedding de Regina Scheer: deux romans entre histoire et littérature
|
KRECHEL, Ursula. 2018. Geisterbahn. Salzburg : Jung und Jung Verlag. 650 Seiten.
|
SCHEER, Regina. 2019. Gott wohnt im Wedding. München : Penguin Verlag. 416 Seiten.
|
A propos des deux auteures
En 2018 et 2019, paraissent deux romans abordant l’histoire des Sinti ((En allemand le terme « Roma » (Roms) est le terme global pour désigner les populations tziganes, le terme « Sinti » désigne les Roms d’Allemagne en partie sédentarisés. Le terme « Zigeuner », terme employé par les nazis, est un terme discriminatoire qui n’est pas employé par les Roms eux-mêmes pour se désigner, mais par ceux qui veulent les stigmatiser.)) des années 1930 à la période contemporaine, Geisterbahn (désormais abrégé G) d’Ursula Krechel et Gott wohnt im Wedding (désormais abrégé GW) de Regina Scheer. Les deux auteures, nées respectivement en 1947 et en 1950, ont fait des études littéraires, mais elles se sont l’une et l’autre beaucoup intéressées à l’histoire de l’Allemagne, notamment à celle des Juifs d’Allemagne. Ursula Krechel qui s’était fait connaître jusque-là surtout par la publication de recueils de poèmes a en effet publié, ces dernières années, deux vastes romans portant l’un sur la communauté des émigrés juifs de Shanghai ((KRECHEL, Ursula. 2008. Shanghai fern von wo. Salzburg : Jung und Jung Verlag.)), l’autre sur le difficile retour en Allemagne d’un juge juif émigré à Cuba ((KRECHEL, Ursula. 2012. Landgericht. Salzburg : Jung und Jung Verlag.)). Regina Scheer, quant à elle, journaliste, auteure de reportages et essayiste, a notamment écrit des ouvrages portant sur l’histoire de grandes familles juives comme les Mendelssohn ((SCHEER, Regina. 2006. Mausche mi-Dessau Moses Mendelssohn. Berlin : Hentrich & Hentrich.)) ou les Liebermann ((SCHEER, Regina. 2006. „Wir sind die Liebermanns“. Berlin : Propyläen.)). Elle a également fait des recherches sur l’histoire d’un bâtiment de Berlin qui abritait, dans les années 1960, le lycée qu’elle fréquentait, mais avait été auparavant un foyer pour enfants juifs ((SCHEER, Regina. 1992. AHAWAH, das vergessene Haus. Berlin : Aufbau. Cf. AURENCHE-BEAU, Emmanuelle. 2016. «Ahawah. Das vergessene Haus de Regina Scheer, un exemple d’enquête historique à propos d’une institution juive oubliée», Le texte et l’idée, n°30, pp. 3-17.)) et a publié un livre d’interviews avec une survivante de la Shoah, Regina Steinitz ((STEINITZ, Regina et SCHEER, Regina. 2014. Zerstörte Kindheit und Jugend. Mein Leben und Überleben in Berlin. Leonore Martin et Uwe Neumärker (eds.). Berlin : Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.)). Son premier roman Machandel ((SCHEER, Regina. 2014. München : Knaus. Cf. AURENCHE-BEAU, Emmanuelle. 2017. «Machandel de Regina Scheer. D’un conte de Grimm à la période du Tournant », in E. Aurenche-Beau, M. Boldorf, R. Zschachlitz (dir.) RDA, Culture-Critique-Crise. Nouveaux regards sur l’Allemagne de l’Est. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, pp. 89-100.)) interrogeait notamment la place de la mémoire de la période national-socialiste en RDA et dans l’Allemagne réunifiée.
Deux romans inspirés par des faits réels
Il est frappant de les voir toutes deux s’intéresser, dans leur dernier livre, à l’histoire encore largement méconnue et occultée d’une autre minorité discriminée et persécutée par les nazis, les Sinti. Cette histoire a cependant commencé à sortir de l’ombre ces dernières années, avec des travaux d’historiens, de psychologues ((Le livre publié par Silvia Wolf à l’occasion de l’inauguration du monument commémoratif de la ville de Trêves contient une bibliographie très complète: WOLF, Silvia. 2012. Überleben- das war für uns nicht vorgesehen ! Lebensgeschichten rheinland-pfälzischer Sinti-Familien, Jacques Delfeld (ed.), Landau : Verband Deutscher Sinti und Roma.)), la publication d’ouvrages fondés sur des témoignages de Sinti survivants ((GUTH, Karin Guth. 2009. Z 3105. Der Sinto Walter Winter überlebt den Holocaust. Hamburg : VSA-Verlag. https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/VSA_Guth_Z3105_Winter.pdf, HAUMANN, Heiko. 2016. Die Akte Zilli Reichmann. Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag.)) et l’inauguration en 2012 de monuments commémoratifs, notamment à Berlin et à Trêves, pour ne citer que les villes présentes dans les romans des deux auteures qui s’inscrivent probablement en partie dans ce contexte. Ils sont aussi à relier à une actualité marquée par des « faits divers » qui témoignent d’une persistance des préjugés anti-rom et même d’actes ouvertement racistes inspirés par une idéologie d’extrême-droite clairement néonazie ((Regina Scheer explique dans une interview qu’elle s’inspire pour écrire de ce qu’elle « voit et vit »: « Das Material für mein Schreiben, ist das, was ich sehe und erlebe » (Buchjournal 10. 04. 2019, p.11) et cite dans cette même interview l’exemple d’un article à propos d’un immeuble de Schöneberg « envahi » par des Roms qui l’a fait réagir. Ursula Krechel a, quant à elle, vraisemblablement été marquée par les attaques subies par un restaurant de Trêves tenue par une famille de Sinti et rappelées dans l’un des discours tenus lors de l’inauguration du monument commémoratif déjà évoqué : cf. https://www.agf-trier.de/wp-content/uploads/2018/06/Artikel-Christian-Pfeil.pdf et archiv.16vor.de/man-kann-verzeihen-darf-aber-nicht-vergessen/.)).
Outre la concomitance de la parution de leurs romans et leur intérêt commun pour l’histoire de minorités discriminées et persécutées, les deux auteures ont comme point commun d’écrire des livres qu’elles qualifient pleinement de fictions, de « romans » tout en précisant l’une et l’autre, dans le péritexte de leurs livres, qu’elles s’appuient sur des éléments empruntés à la réalité. Le roman de Regina Scheer est ainsi précédé de ces quelques phrases qui décrivent bien son statut à la croisée de l’histoire et de la littérature, entre référence à des faits historiques et liberté d’invention : «Ce livre est une œuvre de fiction, les personnages et l’action sont librement inventés. Pour autant que le roman fasse référence à des faits historiques, il ne prétend en aucune manière les représenter de manière objective ». ((« Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Personen und Handlung sind frei erfunden. Soweit der Roman sich auf historische Begebenheiten bezieht, erhebt er keinerlei Anspruch, diese ‘objektiv’ darzustellen. ». Elle explique également dans des interviews avoir fait beaucoup de lectures et de recherches pour écrire son livre (Buchmagazin, 5/19, p. 30) et que chacun de ses personnages s’inspire de personnes réelles (Buchjournal, 10. 04. 2019, p. 11). Je remercie Mme Leibl des éditions Penguin de m’avoir envoyé l’ensemble des articles publiés à l’occasion de la parution du livre.)) Ursula Krechel, pour sa part, donne, à la fin du livre, une liste alphabétique d’auteurs précédée de la mention : « sont cités », invitant le lecteur curieux à découvrir ses sources qui s’avèrent être notamment des ouvrages d’historiens spécialistes de la persécution des minorités sous le national-socialisme ((Karola Frings auteure de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment de Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen, 1933-1945. 2012. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh et de Sinti und Roma. 2016. München : Beck.)), de la période de l’immédiate après-guerre ((de l’Allemagne occupée comme Atina Grossmann auteure notamment de Jews, Germans and Allies. Close Encounters in Occupied Germany. 2007. Princeton University Press ; des relations entre vainqueurs et vaincus, notamment de la dénazification comme Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands. 1995. München : Oldenbourg.)), de l’histoire de Trêves, sa ville natale, où se situe le roman ((ZENZ, Emil. 1983. Trier in Rauch und Trümmern, Trier : Verlag der Akademischen Buchhandlung.)). Elle indique également les archives où elle s’est documentée ((les archives fédérales, les archives de Berlin et celles de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle cite en outre également des noms d’écrivains auxquels elle emprunte de diverses manières - on rencontre ainsi dans le roman des allusions au récit de Kafka « Vor dem Gesetz », au poème de Lenau « Die drei Zigeuner »…)), précisant dans une interview qu’elle préfère les textes « froids » (témoignages écrits, articles de journaux, dossiers juridiques, médicaux…) déposés dans les archives aux entretiens avec des témoins ((« Mit der Zeit habe ich davon Abstand genommen, Zeugen zu befragen und mich der Methoden der oral history zu bedienen. Zeugen haben notwendigerweise einen stark fokussierten, subjektiven, aber eingeschränkten Blick. (…) Aus diesem Dilemma habe ich den Schluss gezogen, möglichst mit schriftlichem Material zu arbeiten: in Archiven niedergelegten Zeugenaussagen, Zeitungsberichten, die an entlegenen Stellen erschienen sind, Justizakten, Krankenakten. Die Schriftlichkeit dieser Erinnerungselemente (die häufig in den offiziellen Dokumenten auch von einer Negation des individuellen Leids geprägt sind), scheint mir für meine Arbeit wesentlich zu sein. Ich muss das vorgefundene Material „kalt“ halten, damit ich die mir eigene Sprache, meinen Zugang zu den Figuren in meinen Texten finde ». 2017. Mémoires en jeu, n°5, 12, p. 3.)). Elle insiste en outre sur le fait que ses romans sont fondés sur des « noyaux de réalité » et que tous ses personnages ont des fondements réels ((Dans un article paru après qu’elle a obtenu le Prix des libraires allemands pour son roman Landgericht, le journaliste de Die Zeit cite les propos suivants : « Es gibt immer reale Kerne (…) alle Personen haben reale Hintergründe. » Die Zeit, 09. 10. 2012.)) et récuse l’assimilation de l’art à la fiction ((« Kunst wird irrtümlicherweise mit Fiktion gleichgesetzt » explique-t-elle dans une interview, Mémoires en jeu, ibid., p. 7.)).
On peut donc, à partir de ces deux romans, s’interroger sur la manière dont leurs auteures « tissent ensemble ce qui relève du documentaire et ce qui relève de la fiction » ((Pour reprendre une expression du critique Ulrich Rüdenauer à propos du roman Landgericht qui nous semble bien définir le projet d’écriture de Ursula Krechel: « das Dokumentarische und Fiktionale auf kunstvolle Weise (…) zu verknüpfen, zu verweben, so dass die Übergänge noch kenntlich sind, aber das Gefundene vom Erfundenen davon getragen wird und das Erfundene vom Gefundenen. », Die Zeit, 09. 10. 2012.)). Comment les deux livres sont-ils « portés » par les recherches documentaires de leurs auteures ? Comment les deux auteures intègrent-elles le matériau documentaire à leur roman ? Comment le retravaillent-elles, comment composent-elles leurs romans, à quelle perspective narrative ont-elles recours ?
Entre travail de documentation et travail de fiction
En ce qui concerne la manière dont les deux romans sont « portés » par des faits réels, il apparaît très clairement, à la lecture des deux livres, que les deux auteures se sont documentées avec une grande précision sur l’histoire des Sinti.
Le Troisième Reich
Elles font tout d’abord toutes deux une large place à la période du Troisième Reich. Ursula Krechel évoque ainsi, dans le premier chapitre de son roman, la manière dont le régime nazi, dès les années 1930, stigmatise les Sinti, les considérant comme asociaux (G 12), leur interdisant comme aux Juifs tout mariage avec des Allemands (G 15), effectuant sur eux des études pseudo-scientifiques (G 51-54). Elle aborde également l’arrestation en juillet 1936, avant les Jeux Olympiques, de tous les Sinti et Roma de Berlin qui sont parqués à Marzahn pour éviter de donner au monde une mauvaise image de la ville (G 33-41; 42-43 ; 46-47) ((Regina Scheer y fait également allusion, les grands-parents de Laila y sont internés (GW 290).)). Elle évoque enfin la réalité des stérilisations forcées dans le but d’éteindre la minorité rom: La fille aînée de la famille Dorn, Kathi, y est contrainte (G 60-65), ainsi que son frère Josef (G 199). La déportation est bien sûr présente dans les deux romans. Les grands-parents de Laila, un des personnages principaux du roman de Regina Scheer, sont déportés à Auschwitz-Birkenau, puis envoyés dans d’autres camps (GW 292), tandis que tous les membres de la famille Dorn (sauf le fils aîné) se retrouvent à Lublin (G 405) ((Pour écrire l’histoire de la famille Dorn, Ursula Krechel s’est manifestement inspirée de très près du témoignage de Christian Pfeil, Silvia Wolf, op. cit., pp. 114-126.)).
L'après-guerre
Les deux romans évoquent ensuite tous deux la période de l’après-guerre. Dans le quatrième chapitre de son roman, Ursula Krechel décrit ainsi les difficultés des Sinti à voir reconnaître par la RFA les persécutions et les traumatismes subis sous le national-socialisme et à obtenir des indemnisations au prétexte qu’ils auraient été déportés en tant que criminels et non pour des raisons raciales (G 403-411). Regina Scheer n’aborde pas cette question, elle évoque, quant à elle, la situation des Sintis se trouvant sur le territoire polonais et contraints par le gouvernement polonais à quitter la Pologne pour l’Allemagne. C’est ainsi que les grands-parents de Laila et leurs enfants se voient contraints de quitter Chrzanow et se retrouvent dans des trains qui leur rappellent ceux de la déportation. A la frontière, on les informe cependant que les Allemands refusent de les accueillir, son grand-père et deux de ses fils réussissent à sauter du train, tandis que sa grand-mère et son père retournent en Pologne (GW 284-287). Elle évoque aussi les pogroms qui ont lieu dans la Pologne des années 1980 (GW 31) et 1990 (GW 65) ((En 1981, des maisons de Sintis sont incendiées ; en 1991, un pogrom a lieu suite à un accident de voiture mortel provoqué par un Rom. Au sujet de la situation des Sinti et Roma en Pologne cf. https://www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/197233/die-polnischen-roma-zwischen-tradition-und-aufbruch-wie-sollt-ihr-leben-hier-auf-dieser-welt.)) et décrit les difficultés d’intégration de Laila et de sa mère Flora dans l’Allemagne des années 1990 (GW 109, 146-8).
L'époque contemporaine
Toutes deux évoquent enfin la période contemporaine et montrent que, même si elles sont le fait d’une minorité, les discriminations à l’encontre des Sinti n’ont pas disparu : Regina Scheer montre, par exemple, la persistance des préjugés à l’œuvre contre les Roms, considérés comme voleurs (le jeune Rom qui crée des sculptures est ainsi accusé par la police d’avoir volé le métal qu’il utilise), tandis qu’Ursula Krechel décrit les attaques dont est l’objet le restaurant tenu par deux des membres de la famille Dorn en s’inspirant de faits réels (cf. note 12). Si Ursula Krechel n’en fait quasiment pas mention, Regina Scheer montre, quant à elle, également le combat mené par les Sinti depuis les années 1980 pour faire reconnaître leur histoire et leur culture, de la pose d’une plaque commémorative à Marzahn en 1986 sans que les Sinti eux-mêmes ne soient invités à la cérémonie (GW 198-200) à l’inauguration en 2012 du monument du Tiergarten déjà évoqué. Elle aborde aussi la question des tensions entre les différentes communautés roms, notamment entre les Sinti qui vivent depuis longtemps en Allemagne et les Roms d’Europe centrale qui sont arrivés plus tardivement, suite à l’éclatement de la Yougoslavie.
L'intégration de discours réels
Si les deux romans sont donc nourris d’une grande érudition historique, s’appuient de très près sur la réalité historique et si leur lecture apporte donc des informations extrêmement détaillées et précises sur la douloureuse histoire des Sinti, on peut en outre souligner la manière dont Ursula Krechel intègre aussi subtilement qu’efficacement, en les signalant par des italiques, des bribes de discours réels ((Regina Scheer, quant à elle, ne pratique pas la citation directe, préférant sans doute proposer au lecteur un texte plus « homogène ».)). En citant des textes aussi divers que des textes officiels (textes de décrets, de lois : G 15, 35, 62), des articles de journaux sur le « nettoyage » de Berlin (G 38), des expressions courantes de la langue quotidienne, en intégrant à son texte des documents comme le questionnaire que devaient remplir les Sinti au moment de leur arrestation (G 82-83) ou la liste de leurs biens avant leur déportation (G 85-86), elle permet au lecteur de se représenter très concrètement, par petites touches significatives, la réalité de l’époque des années 1930.
Les quelques extraits d’un règlement de police des années 1950 à propos de la « lutte contre le fléau tsigane » afin de trouver « une solution définitive au problème tsigane » (G 364) sont eux aussi éloquents et montrent en quelques mots la continuité entre le régime nazi et la jeune RFA où la dénazification n’a été que très superficielle, comme le mettent en évidence des exemples de réponses au questionnaire que devaient remplir les personnes suspectes d’avoir collaboré avec le régime nazi avant de pouvoir être embauchées comme professeurs (G 267-270). Un exemple de formulaire à remplir par les victimes du régime nazi demandant réparation pour les préjudices subis suffit, quant à lui, à montrer l’absurdité du système (G 404). On leur demande en effet outre l’adresse de leur banque en 1943, le dernier solde de leur compte et leur dernier relevé de compte… Et la réponse qui suit laisse sans voix (G 406), tout comme les extraits du dossier de Kathi qui ne reconnaissent en rien les souffrances subies et jugent même que pour « les personnalités du type de la requérante », le fait de ne pas pouvoir avoir d’enfant est moins douloureux que pour « la moyenne des femmes normales dans une situation comparable » (G 465). L’évocation des attaques contre le restaurant d’Ignaz et Anna, maculé de croix gammées, montre enfin à quel point il reste difficile encore actuellement de faire reconnaître le caractère raciste d’actes clairement inspirés par une idéologie d’extrême-droite ((À Anna qui affirme que ce sont des actes commis par des néonazis, le policier répond : « In unserer Stadt gibt es keine Neonazis » (G 624) ; là non plus, Ursula Krechel n’invente rien et s’inspire manifestement de l’expérience de Christian Pfeil cf. : http://archiv.16vor.de/man-kann-verzeihen-darf-aber-nicht-vergessen/ et https://www.agf-trier.de/wp-content/uploads/2018/06/Artikel-Christian-Pfeil.pdf.)).
Le travail de fiction: la création d'un microcosme autour d'un lieu central
Si les deux auteures s’appuient donc chacune à leur manière sur de solides recherches documentaires et sur des faits historiques, elles retravaillent néanmoins l’une et l’autre leur matériau pour construire des œuvres de fiction. Toutes deux intègrent ainsi l’histoire de la famille sinti autour de laquelle est centré leur roman au sein d’un ensemble plus vaste ((Comme le dit Ursula Krechel : « Das Gedicht evoziert, während der Roman seinen Gegenstand umkreist, bestenfalls eine Totalität bildet », Mémoires en jeu, op. cit., p. 4.)). L’univers du roman de Regina Scheer est ainsi un immeuble du quartier de Wedding à Berlin où habitent de nombreux autres habitants. La doyenne est une vieille dame allemande de 87 ans, Gertrud Rombach qui, dans les années 1930, a accueilli et caché deux jeunes résistants juifs. L’un des deux a été arrêté et déporté tandis que l’autre, Leo, émigré en Israël, revient à Berlin avec sa petite-fille qui découvre un aspect du passé de son grand-père jusque-là complètement ignoré d’elle. Mais l’immeuble est habité aussi par des étudiants et des immigrés de fraîche date, des femmes russes avec leurs enfants, puis des familles roumaines. Ce dispositif qui crée un centre, une unité de lieu permet de mettre en perspective l’histoire de Laila, la jeune Sinti, et de sa famille, entre discrimination, déportation, difficulté et volonté d’intégration. Les personnages, en effet, se croisent, font connaissance, tissent des liens. Laila aide ainsi les familles roumaines, dont elle comprend la langue, dans leurs démarches administratives, s’identifie et se prend d’affection pour une jeune Roumaine qui a l’âge qu’elle avait quand elle est arrivée à Berlin et l’aide à trouver une bourse pour continuer ses études en Allemagne. Stachlingo, le beau-père de Laila, et Leo qui font connaissance par l’intermédiaire de Laila, relisent ensemble l’histoire de leurs minorités respectives, entre divisions et combat pour obtenir reconnaissance et réparation.
Le roman d’Ursula Krechel, quant à lui, a pour centre la ville de Trêves, plus précisément la classe de CE1 fréquentée par Annchen Dorn, la benjamine de la famille Dorn, dans les années 1950 ((Cette idée lui a manifestement été inspirée par la lecture du roman The group de Mary McCarthy qui fait partie des auteurs de la liste qui se trouve à la fin du livre.)). Cette classe, où se côtoient des élèves de milieux sociaux extrêmement divers, remplit une fonction similaire à celle de l’immeuble de Regina Scheer, celle d’être une sorte de microcosme de la société allemande. On y trouve aussi bien une fille de communiste, Aurelia Torgau ((La famille Torgau est une famille de résistants communistes inspirée par la famille de Willi et Aurelia Torgau alias Orli Wald. Les noms de Bernd Steger et Peter Wald auteurs d’un livre sur Orli Wald, 1989. Der dunkle Schatten (Leben mit Auschwitz; Erinnerung an Orli Reichert-Wald), Marburg : SP-Verlag Schüren sont également cités dans la liste.)) qu’un fils de patron d’une usine de vinaigre, une fille de mère célibataire, Iris Berghausen, qu’une fille de catholiques convaincus, Cecilia Neumeister, la petite Sinti Annchen Dorn donc et un fils de policier, Bernhard Blank. C’est à partir de ce centre en partie autobiographique que semble se construire le roman ((Cecilia semble être l’alter ego d’Ursula Krechel, dont le père était psychologue pour enfants, comme elle l’évoque dans In Zukunft schreiben où elle raconte comment, enfant, elle aimait lire en cachette les dossiers de son père ! KRECHEL, Ursula. 2003. In Zukunft schreiben. Handbuch für alle, die schreiben wollen. Salzburg : Jung und Jung, pp. 75-78.)). Avant que n’apparaissent les enfants dont la naissance est évoquée à la fin du chapitre 3, le roman raconte d’une certaine manière leur pré-histoire en introduisant d’abord leurs parents et frères et sœurs plus âgés. Tout le chapitre 1 est ainsi consacré, comme on l’a déjà évoqué, à la famille Dorn jusqu’à sa déportation en 1940. Le chapitre 2 qui couvre la même période des années 30 ((Il est fait allusion au fait que les Dorn sont « encore là » (G 134).)) introduit le père de Cecilia et décrit sa carrière et son ascension sociale, symbolisée par le « Paternoster » qui donne son titre au chapitre. Occupant d’abord un poste de conseiller d’orientation au sein de la Hitlerjugend (G 110 ; 115-116), il devient plus tard fonctionnaire du ministère du travail du Reich et échappe à la mobilisation (G 181). Ce même chapitre évoque en outre, parallèlement, les figures de la tante et du père d’Aurelia, Willi et Aurelia dite Orli, résistants communistes, déportés l’un à Esterwegen (G 105-108 ; 112-114), l’autre à Ravensbrück et Auschwitz (G 186) après avoir passé plusieurs mois à la prison de Ziegenhain (G 168-172). Il présente également la mère d’Iris, Grit Bergenhausen, qui renonce à reprendre le grand hôtel tenu par ses parents pour suivre son fiancé, médecin à l’hôpital de Trêves, qui ne reviendra pas du front (G 179 ; 203). Quant au père de Bernhard Blank, il fait son travail de policier sans se poser de questions…
Le chapitre 3 est consacré à la période de la guerre et de l’immédiate après-guerre et montre la manière dont les différents personnages tentent de trouver leur place dans l’Allemagne en reconstruction. Les difficultés des survivants des camps nazis, dont Josef Dorn, le fils aîné de la famille Dorn, qui, s’il n’avait pas été déporté en 1940 avec le reste de sa famille car il avait réussir à fuir au Luxembourg, a tout de même été arrêté et envoyé quelques années plus tard, en 1943, au camp de Buchenwald (G 198) et celles d’Aurelia Torgau contrastent avec la facilité avec laquelle Grit Bergenhausen s’adapte à la nouvelle situation en se faisant embaucher par l’occupant français (G 245-248) ((Le père de sa fille Iris n’est d’ailleurs autre qu’un officier français qui rentre ensuite en France retrouver sa famille et ses enfants.)), avec la manière dont Franz Neumeister trouve un poste dans une organisation caritative catholique ou avec celle avec laquelle Eberhard Blank poursuit sa carrière au sein de la police. Quant à Willi Torgau, le père d’Aurelia, il se résout, devant l’insistance de ses camarades de Parti, à faire partie d’une commission chargée du recrutement des nouveaux professeurs (G 265-272).
Le chapitre 5, quant à lui, fait se retrouver les enfants plusieurs décennies plus tard et nous fait découvrir ce que chacun a fait de sa vie. Aurelia, qui voulait devenir orfèvre, travaille dans l’import-export (G 549). Iris a retrouvé son père français et est interprète (G 550). Gerwin, dont le père avait une usine de vinaigre, s’est lancé dans la viticulture et se passionne pour l’œnologie (G 595-607). Cecilia vit à New York et est devenue réalisatrice de films (G 577-590). Bernhard Blank vient de prendre sa retraite de professeur des écoles (G 542-543). Quant à Anna Dorn, elle a ouvert, avec son frère Ignaz, un restaurant très prisé (G 564-572).
Ces destins croisés ((À plusieurs reprises, les personnages se retrouvent, se croisent ou auraient pu se croiser.)) forment donc de manière synchronique, à différents moments de l’Histoire qui sont comme autant de moments-clé choisis par l’auteure (les années 1930, la guerre et l’immédiate après-guerre, la période contemporaine), une sorte d’échantillon de la société allemande, des victimes des discriminations et des persécutions (les Dorn, les Torgau) au représentant de la force qu’est le policier Eberhard Blank en passant par les opportunistes qui réussissent, quel que soit le régime politique, à tirer leur épingle du jeu (Grit Bergenhausen, Franz Neumeister), tandis que la construction chronologique du roman permet une sorte de coupe diachronique dans les histoires des différentes familles.
Si les deux auteures composent donc toutes deux leur roman autour d’un centre, autour d’un lieu central (l’immeuble/la classe) et entourent leurs personnages principaux d’autres personnages qui gravitent autour d’eux et les mettent en perspective, reconstituant ainsi un microcosme, elles ont recours à des moyens littéraires bien différents pour donner à saisir au lecteur la réalité de ce qu’ont vécu les familles de Sinti dont elles relatent l’histoire.
Des dispositifs narratifs complexes
La problématisation du témoignage
Regina Scheer fait ainsi le choix de donner directement la parole à Frana, la grand-mère de Laila, qui, dans un long monologue ((Ce monologue occupe six pages du chapitre 14 (pp. 284-290) et près de quinze pages du chapitre 16 (pp. 311-327).)), à peine entrecoupé de questions ou de commentaires de sa petite-fille, raconte à cette dernière son histoire ainsi que celle de sa famille : comment elle a survécu après avoir quitté le camp (GW 311-327), comment ils ont été chassés de Pologne en 1959 (GW 284-290). La partie de l’histoire concernant son arrestation et sa déportation est, quant à elle, rapportée au subjonctif I et présentée comme le résumé d’une interview donnée par Frana à une radio (GW 290-294). Cette façon de présenter au plus près la parole du témoin en la citant au style direct ou en la rapportant à partir d’un entretien enregistré semble certes louable, elle n’en est pas moins problématisée à l’intérieur même du roman. Suite à l’expérience faite avec la journaliste qui l’a interrogée au sujet du camp de Marzahn ((Elle dit avoir eu l’impression que ses propos avaient été tronqués et déformés (GW 318).)), Frana refuse, en effet, la proposition de Laila d’enregistrer son témoignage, en insistant sur le fait que la transmission ne peut se faire qu’à l’intérieur d’une relation de confiance ((« Dir vertraue ich, Laila » (GW 318). Frana n’a par contre jamais voulu parler en présence de Jonas, l’ex-mari de Laila (un gadjo) qui a fait un doctorat sur « les stratégies de survie de familles de Sinti berlinoises sur trois générations » (GW 207). Lorque Laila découvre après-coup qu’il a utilisé l’histoire de sa famille, notamment celle de son beau-père, sans lui en demander la permission, elle se sent blessée et a l’impression d’avoir été flouée (GW 207-209).)) et de cœur à cœur ((« Ich erzähle dir meine Geschichte, Laila, aber dir in deine Augen und in dein Herz hinein, nicht in so ein Mikrophon. » (GW 318).)). Est-ce à dire qu’un roman dont la lecture ne fait pas seulement appel aux capacités cognitives du lecteur, mais aussi à sa sensibilité s’y prêterait mieux qu’un livre d’histoire ?
La multiplicité des points de vue
Ursula Krechel adopte, pour sa part, un autre mode d’écriture. Son roman fait très peu de place au discours direct, mais la façon dont elle recrée certaines scènes en offrant au lecteur un accès au monde intérieur des personnages nous semble fournir un exemple de ce que la littérature peut apporter à l’Histoire. Ursula Krechel permet en effet ainsi au lecteur de saisir de l’intérieur les pensées et les sentiments des personnages. Ainsi par exemple, lors de la stérilisation forcée de Kathi, où elle fait ressentir au lecteur aussi bien la fureur de Lucie, la mère de Kathi ((« Es wurde finster vor ihren Augen, und im Finsteren forschte sie nach ihren Gedanken, aber sie fand sie nicht. Was sie fand, war blanke Wut. Die Wut vertrug keinen einzigen Gedanken » (G 61).)), que la force de son amour pour sa fille dont elle est prête à prendre la place (G 63) et qu’elle va ensuite attendre tous les jours devant l’hôpital (G 64). Ou lorsqu’elle fait vivre au lecteur l’insondable souffrance de Kathi qui aurait tant aimé avoir des enfants en la montrant dévorant des yeux les enfants dans leur poussette:
Bei jedem Kinderwagen hält Kathi den Atem an, sie muß stehenbleiben, die Augen schließen und sehr langsam wieder öffnen […] Kathi starrt das Kind an, in jeden Kinderwagen muß sie starren […] Kathi will weiter, sie kann nicht weiter, Füße wie Blei, ein klopfendes Herz, Arme, die das Kind aufheben, Hände, die das Kind liebkosen wollen, Augen, die es anlächeln. Dunkle, feuchte Augen, die den Blick des Kindes trinken […] Kathi kann den Blick nicht lösen, geh, geh, sagt sie zu sich selbst, und dann reißt sie sich mit aller Macht los. (G 464)
L’attachement viscéral de Lucie Dorn à sa benjamine, Annchen ((À l’étonnement des autres enfants, Lucie va en effet tous les jours la chercher à l’école (G 414) dans un besoin viscéral de la protéger, mais, comme le note, le narrateur, peut-être aussi « parce qu’Annchen la protège, tant qu’elle est un enfant, tant que l’une a besoin de l’autre » (G 405).)), fait également ressortir en creux le traumatisme irréparable que représente pour elle la perte de ses enfants morts au camp de Lublin qui continuent à être le centre de son existence, comme le montrent également le fait que la seule chose pour laquelle elle demande réparation est la perte des vêtements de ses enfants ((« Lucie hatte dem Rechtsanwalt nur einen einzigen Verlust angezeigt : die Kleidung ihrer fünf toten Kinder.» (G 406).)) ou bien les moments où, folle de douleur, elle passe ses journées dans l’obscurité à appeler ses enfants morts (G 411-412 ; 425).
À l’aide de quelques notations très concrètes elle fait également saisir au lecteur ce que représente pour Alfons Dorn, le père de famille, le fait de devoir aller quémander, dans des bureaux où il retrouve des fonctionnaires qui lui semblent être les mêmes que ceux du camp de Marzahn, ceux de la déportation ou ceux du camp de Lublin, l’indemnisation à laquelle il a droit:
Angstschweiß, Herzrasen. Er konnte den Geruch nicht ertragen, er schneuzte sich. […] Alle, alle kannte er, davon war er nicht abzubringen. Er kannte den Geruch der Männer, es roch nach Lager. (G 405).
Ou ce que vit Ignaz, qui se revoit, enfant, accompagner son père dans ces bureaux, quand il va faire sa déposition à la police, après les dégradations dont a été l’objet son restaurant maculé de croix gammées et qu’on lui dit qu’il n’y a pas d’extrême-droite dans la ville (G 624). Grâce à une écriture extrêmement plastique et précise qui fait appel à tous les sens, Ursula Krechel permet ainsi au lecteur de se représenter, de se figurer les expériences traumatiques vécues par les différents membres de la famille Dorn.
Si la perspective narrative choisie par les deux auteures est une perspective auctoriale avec une narration à la troisième personne qui leur permet de construire un univers qui « entoure » leurs personnages, conformément à la définition du roman d’Ursula Krechel déjà citée, cette perspective laisse cependant aussi la place, par moments, à une focalisation interne, comme on le voit par exemple dans les passages du roman d’Ursula Krechel qui viennent d’être évoqués. Regina Scheer, quant à elle, fait alterner des chapitres centrés autour des trois personnages principaux du roman, Gertrud (chapitres 3, 6, 10, 13, 15, 20), Leo (1, 5, 8, 12, 17, 19, 21) et Laila (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18) dans lesquels le narrateur omniscient adopte, par moments, le point de vue du personnage en question. Ce dispositif narratif permet au lecteur non seulement d’accéder au monde intérieur des personnages, mais aussi de croiser les points de vue, de montrer les personnages vus les uns par les autres et d’éviter ainsi toute pseudo- objectivité.
Le rôle de la narration à la première personne
Les deux auteures introduisent cependant aussi un narrateur à la première personne. Dans le roman de Regina Scheer, il n’est autre que l’immeuble lui-même qui prend la parole à sept reprises, dans sept brefs chapitres en italiques. Il y raconte son histoire et celle de son quartier, le Wedding, à partir de sa construction, au début du 20è siècle, en reprenant ce qu’il a entendu dire (GW 8 ; 39 ; 85). Il est finalement détruit par un incendie juste avant d’être racheté par un promoteur qui avait de toutes façons l’intention de le raser. Ce choix qui n’a pas toujours convaincu les critiques est justifié par l’immeuble lui-même qui affirme ne pas être juste de la matière, mais avoir aussi une vie, faite de celles de ses habitants:
Die meisten denken, ein Haus sei nichts als Stein und Mörtel, totes Material. Aber sie vergessen, dass in meinen Wänden der Atem von all denen hängt, die hier gewohnt haben. […] All ihre Leben habe ich in mich aufgenommen, durch sie lebe ich selbst, auf meine Weise. (GW 5).
En donnant en même temps à ces derniers un contenant plus vaste qu’eux, qui les précède et leur survit, ce dispositif narratif vise à mettre en perspective et à contextualiser leurs destins si divers ((« Ich stehe hier auf meinem Platz, da sieht man mehr und kann die Zusammenhänge erkennen. » (GW 42). Il n’est bien sûr pas sans rappeler La vie mode d’emploi (1978) de Perec ou, plus récemment, Heimsuchung (2008) de Jenny Erpenbeck ou encore 209 rue Saint Maur. Paris Xè. Autobiographie d’un immeuble (2020) de Ruth Zylberman.)).
Le narrateur à la première personne du roman d’Ursula Krechel, quant à lui, est tout autre. En optant pour Bernhard Blank, le fils du policier Eberhard Blank, qui s’interroge, pour chacune des périodes évoquées dans le livre, même pour celle des années 1930 qui précède sa naissance en 1947, ce qu’a pu faire son père en bon exécutant des ordres du pouvoir quelle que soit l’époque, elle introduit une autre perspective, complétant ainsi le tableau et apportant une sorte de contre-point à la perspective des « victimes ». Ursula Krechel explique ainsi, dans une interview, que cette « station relais » sert d’« intermédiaire entre la perspective des victimes et un mode de narration auctorial », et « empêche toute identification simple avec les victimes ». Un critique souligne ainsi à juste titre que la lecture du livre exige du lecteur un travail de réflexion qui doit lui permettre une « prise de conscience » ((« So unterläuft sie [Ursula Krechel] eine simple identifikatorische Lesart. Es geht um einen Erkenntnisprozess. », 2018. Cicero, 10, p. 94.)). L’alter ego de l’auteure dans le livre, la réalisatrice de films qu’est devenue Cecilia, est d’ailleurs saluée dans un article comme une artiste qui allie « intuition » et « intelligence » ( « Ihr filmisches Werk zeige, daß Intuition intelligent sei und Intelligenz intuitiv » (G 578-579) ) et dont les œuvres « complexes », qui se situent entre films de fiction et films documentaires, sont, comme les romans d’Ursula Krechel elle-même, toujours à la recherche de la bonne distance, du juste point de vue ((« War das ein Spielfilm, war das ein Dokumentarfilm ? » se demande Bernhard Blank qui est allé voir un de ses films et de citer un article sur la technique cinématographique de Cecilia : « Kamera und Montage erzählen. (…) Die Kamera hält Distanz […]. Sie bleibt nah bei den Dingen, aber immer gibt es einen Zwischenraum […] Ein komplexes Werk über die Achtsamkeit und die Würde des Menschen. » (G 580).)).
Les deux romans montrent donc bien, chacun à leur manière, ce que la littérature peut apporter à la connaissance de l’Histoire. Par une recréation du passé aussi précise, aussi concrète, aussi documentée que possible, par l’accès qu’elle permet au monde intérieur des personnages, la fiction enrichit la compréhension des événements. Par le croisement des points de vue, par l’introduction de dispositifs narratifs complexes, elle interdit toute lecture simpliste du passé.
Notes
Pour citer cette ressource :
Emmanuelle Aurenche-Beau, "Wir begreifen manches nur durch Kunst " : les romans Geisterbahn et Gott wohnt im Wedding , La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2021. Consulté le 05/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/litterature/litterature-contemporaine/wir-begreifen-manches-nur-durch-kunst-les-romans-geisterbahn-et-gott-wohnt-im-wedding



 Activer le mode zen
Activer le mode zen